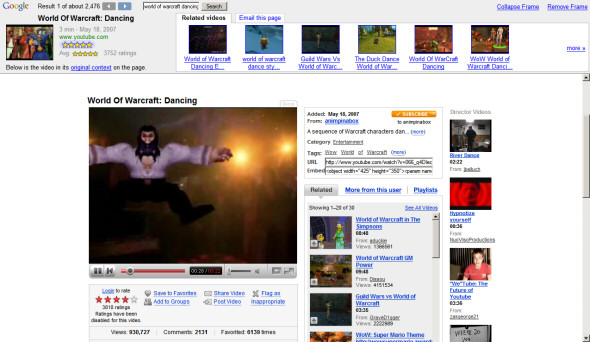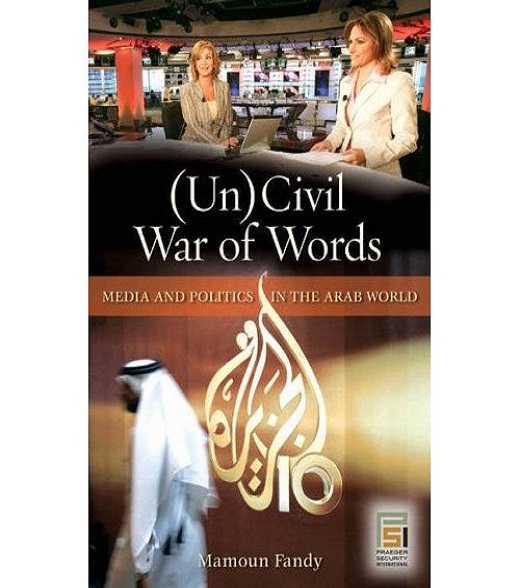Introduction
Une chaîne indispensable pour Washington
Entre finances et organisation interne
Al-Hurra prisonnière de sa fonction ?
Du BBG à Al-Hurra : vers une plus grande efficacité ?
Une partie loin d’être gagnée pour les Etats-Unis

Norman J. Pattiz, qui fut à l’origine d’al-Hurra et de Radio Sawa, dira à ce titre : « Notre mission est journalistique (…). Nous avons pour mission de promouvoir auprès des audiences internationales la liberté et la démocratie, en faisant usage du flux ouvert [nous permettant de relayer des] informations et actualités exactes, fiables et crédibles sur l’Amérique. Nous avons pour mission d’être un exemple de presse libre, dans la droite lignée de la tradition américaine. Il serait idiot de ne pas tirer bénéfice de ces choses que nous faisons mieux que quiconque au monde » .

George W. Bush annoncera le lancement de la chaîne Al-Hurra, ainsi que d’un média persanophone, dans son discours sur l’état de l’Union de 2004, la justifiant par la nécessité pour les Etats-Unis de « briser les barrières de la propagande haineuse » ainsi que de fournir « des informations fiables » aux habitants du Moyen-Orient. Voir le discours

Ce succès paraît confirmé par les observations faites par différents observateurs sur le terrain plus que par des statistiques officielles. Cela étant dit, un nombre important d’auditeurs n’est pas pour autant synonyme d’une force d’impact pour les médias concernés. Voir notamment Peter Krause, Stephen Van Evera, “Public Diplomacy; Ideas for the War of Ideas”, Middle East Policy, Vol. XVI, No.3, Fall 2009.

Cette même expérience avait d’ailleurs été accompagnée du lancement de Hi! Magasine, une publication ayant vocation à toucher les jeunes en leur parlant mode et vies de stars. L’expérience durera deux ans seulement, le magazine ayant été suspendu en 2005 après avoir échoué à atteindre son objectif.

Al-Hurra revendique 25 millions de téléspectateurs quotidiens en audience cumulée. Les sondages établis auprès des opinions publiques du Moyen-Orient soulignent cependant leur attrait extrêmement limité pour cette chaîne. Voir notamment ce sondage , duquel il ressort que la chaîne All-Hurra est loin de compter parmi les sources d’information privilégiées par les Arabes du Moyen-Orient.

Après l’invasion de l’Irak en 2003, nombre de ressortissants arabes du Moyen-Orient développeront une conviction : celle selon laquelle les Etats-Unis avaient pour projet de redessiner les frontières politiques du Moyen-Orient sur des bases ethno-communautaires, de manière à affaiblir les pouvoirs en place et, toujours selon eux, à favoriser ainsi les intérêts d’Israël. L’un des éléments les confortant dans cette hypothèse résidait dans une note d’analyse établie en 1996 par un ensemble de néo-conservateurs, dont un certain Richard Perle, devenu depuis conseiller du président Bush. Cette note, établie à l’adresse du Premier ministre israélien de l’époque, Benyamin Netanyahu, faisait en effet la promotion d’une redéfinition des frontières de la région au départ d’un renversement du régime du président irakien Saddam Hussein. Voir le texte publié sur IASPS.org.

Ibid. Une autre singularité peut d’ailleurs être citée dans le cas de Tom Dine, consultant de la chaîne Al-Hurra qui sera licencié par la suite. En effet, celui-ci avait exercé précédemment des fonctions qui étaient loin de le rendre apte à ce poste dans une chaîne s’adressant au monde arabe. Si M.Dine avait officié auparavant à la tête de Radio Free Europe, il avait aussi été directeur de l’AIPAC, un lobby pro-israélien basé aux Etats-Unis et inconditionnellement engagé en faveur de la défense des intérêts de l’Etat hébreu. Voir Dafna Linzer, "Alhurra Targeted for Review by State Dept. Inspector General", ProPublica, 17 septembre 2009.

Mohammed El-Oifi va jusqu’à parler à ce titre de « dérive confessionnelle », rappelant que « en-dehors du chiite M. [Mouafaq] Harb, le reste de l’équipe dirigeante est exclusivement libanais et chrétien, notamment maronite » ; voir Mohammed El-Oifi, « Al-Hurra, la nouvelle voix de l’Amérique », Confluences Méditerranée, n° 69, printemps 2009.

Un rapport très critique publié par le Broadcasting Board of Governors en décembre 2008 soulignait parmi autres particularités, dont certaines sont d’ordre financier et gestionnaire, le fait que la chaîne Al-Hurra avait, depuis sa création, échoué dans 60% des cas à mettre en perspective des débats et opinions contradictoires. Cette attitude partisane paraissait avoir prévalu en particulier lors de la couverture des questions relatives aux droits de l’Homme aux Etats-Unis (0% d’opinions contradictoires), à l'Afghanistan (9,52% d’opinions contradictoires), à l’Irak (22% d’opinions contradictoires sur les questions de sécurité, et 11,76% sur les thématiques autres), et à la guerre contre le terrorisme (18,52% d’opinions contradictoires). Voir le rapport

Parmi ceux-ci, Alberto Fernandez, arabisant officiant au Département d’Etat, pour qui l’ouverture de l’antenne à des opinions diamétralement opposées aux orientations de l’Administration américaine revenait à faire le jeu des ennemis des Etats-Unis. Voir [3] Dafna Linzer, “Lost in Translation: Alhurra- America’s Troubled Effort to Win Middle East Hearts and Minds”, op. cit.

Rapport disponible ici . A noter que ce rapport s’en prend à la stratégie du BBG de manière générale, et non aux seules décisions pour lesquelles celui-ci a opté au Moyen-Orient. Parmi les critiques les plus fortes, transparaissent ainsi les failles exprimées par ce corps en terme de stratégie médiatique, à un moment où les concurrents les plus évidents des Etats-Unis – en l’occurrence, la Russie et surtout la Chine – ont plutôt tendance à mettre les bouchées doubles en la matière.

The Washington Post, 30 juin 2010. S’ajoutent à ces noms, outre la secrétaire d’Etat américaine Hillary Clinton qui y figure ex nihilo : l’Ambassadeur Victor H. Ashe ; l’ancien président d’AOL Europe Michael Lynton ; le président de la Blue Line Strategic Communications Inc. Michael P. Meehan ; le fondateur de la Commonwealth Partners Inc. Dennis Mulhaupt ; et le vice-président du Hudson Institute, S. Enders Wimbush.

Cette amélioration, qui passe aussi pour une relative amélioration de l’image des Etats-Unis, est aussi à nuancer, tant l’américano-scepticisme des Arabes reste fort. Voir à ce titre le rapport du Pew Research Center du 17 juin 2010 intitulé Obama More Popular Abroad than at Home, Global Image of U.S. Continues to benefit.

Un fait qui ne semble pas acquis pour l’heure, le président Barack Obama ayant lui-même fait savoir que le but du BBG continuerait à passer par « la supervision de radios et de [chaînes de] télévision soutenues par le gouvernement et qui visent à étendre la liberté et la démocratie » ; Asharq al-Awsat, 22 juillet 2010.
À lire également
Médias dans le monde arabe : une question géopolitique ?
Est-ce pertinent d'affirmer que les médias et les chaînes satellitaires sont uniquement des instruments politiques et diplomatiques ? C'est en tout cas ce qu'avance Mamoun Fandy dans son dernier ouvrage. Retour sur une nouvelle manière d'analyser les médias dans le monde arabe.
Médias et élections, piège à comm’ - épisode 3/10
Présidentielle : une régulation du temps de parole à contretemps des usages
Le penchant français pour l’encadrement du travail des journalistes s’affirme notamment lors des campagnes politiques avec le comptage du temps de parole à la radio et la TV des candidats à la présidentielle. Une obsession à rebours de l’évolution des médias et des pratiques du public.