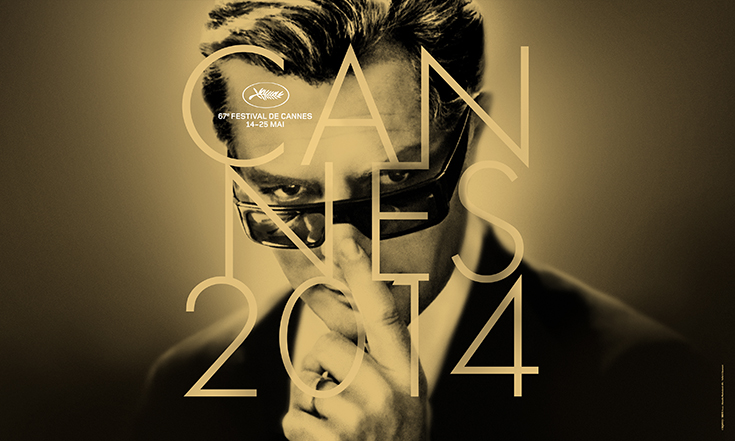L’industrie américaine vs l’artisanat français
Aux États-Unis, dès les années 1940, la grille des programmes de la télévision s’est calquée sur celle de la radio, avec des programmes commençant à l’heure fixe ou à la demi-heure. Les soirées ont été immédiatement occupées par du divertissement et, dès les années 1950, le principe de la fiction à épisodes, destinée à fidéliser les téléspectateurs et à leur vendre 16 minutes de publicité par heure (contre 44 minutes de fiction), était devenu la règle d’une industrie audiovisuelle en plein essor. En produisant plusieurs centaines d’heures de fiction par an, selon un calendrier d’une extrême régularité (de septembre à mai, avec une interruption en décembre) et des formats immuables (22 minutes pour les comédies, 44 minutes pour les drames), Hollywood était devenue le « robinet à séries » pour la population américaine d’abord, et le reste du monde ensuite.
En France la fiction audiovisuelle à épisodes a, dès le départ, été méprisée par les pionniers de la Radio Télévision Française
En France, en revanche, la fiction audiovisuelle à épisodes a, dès le départ, été méprisée par les pionniers de la Radio Télévision Française : dans une grille des programmes uniquement scandée par les rendez-vous de 13h et 20h pour les informations télévisées et qui fait la part belle aux programmes éducatifs (documentaires, reportages, débats, jeux) ou culturels (théâtre, cinéma, variétés et concerts filmés), le « télé-feuilleton » fait figure de parent pauvre, au mieux diffusé juste avant ou après le journal télévisé.
Les deux premiers feuilletons télévisés français, Agence Nostradamus et Les Aventures de Télévisius ont été tournés pratiquement « en douce » par Claude Barma et Christian Delanault dans les studios déserts de Cognac-Jay pendant l’été 1949, et la durée des épisodes était aussi aléatoire que leur montage.
Agence Nostradamus, « Double enquête chez l’astrologue », 11 octobre 1950
Au cours des deux décennies suivantes, les fictions françaises à épisode ont gardé cet aspect « artisanal » : peu de moyens, souvent confiés à des débutants, elles faisaient parfois preuve d’une réelle inventivité (ex :
La famille Anodin et ses décors peints ;
Juliette détective privé diffusée en direct depuis une capitale européenne différente chaque semaine), voire de grandes qualités esthétiques (
Belphégor) ou narratives (
Les Cinq Dernières Minutes).
Les fictions françaises de la RTF se caractérisaient surtout par un grand soin accordé au son
Mais les fictions françaises de la RTF se caractérisaient surtout par un grand soin accordé au son : génériques aisément reconnaissables, voix remarquables des acteurs (Jean Topart, Raymond Souplex), importance de la musique car les écrans étaient encore très petits et les défauts de l’image (grains, vibrations) fréquents, surtout dans les zones rurales. La différence était frappante avec les séries américaines et britanniques qui, à la même époque, remplissaient les grilles des jeudis et samedis après-midi dans le cadre d’émissions destinées à la jeunesse : les cascades et les combats de
Hopalong Cassidy,
Zorro,
Ivanhoé et bien d’autres contrastaient avec un doublage souvent fait à la va-vite, par des acteurs au timbre très théâtral.