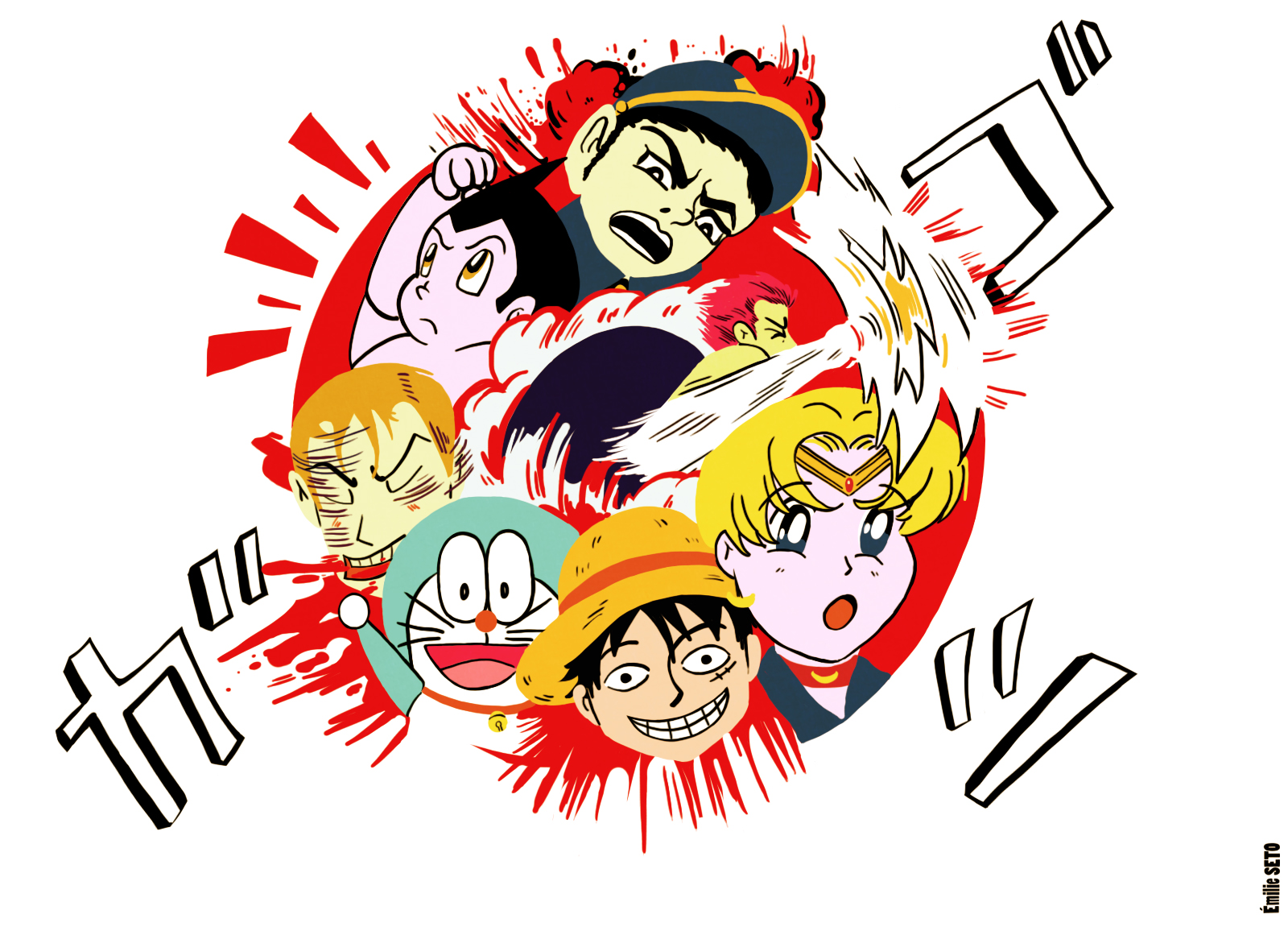Les leçons tirées du premier tour des élections
Dans la nuit du 3 octobre 2010, les résultats ont contredit les pronostics nationaux et internationaux. Dilma Rousseff a obtenu 46,91 % des votes, soit plus de 47 millions de voix, Serra 32,61 %, plus de 33 millions de voix ; et Marina, 19,35 %, près de 20 millions de voix. Un second tour devra donc départager les candidats Dilma et Serra le 31 octobre 2010.
Une lecture plus globale des résultats, prenant donc en considération les sénateurs, députés et gouverneurs élus, montre que le parti de la candidate Dilma l’a emporté dans 18 États du Brésil et dans 4 des cinq régions du pays tandis que celui de Serra a gagné dans 8 États et dans la région Sud. Marina Silva quant à elle ne l’a emporté que dans le District Fédéral de Brasilia.

Si le PT a ainsi obtenu une adhésion indéniable et plus importante qu’en 2006, il n’en reste pas moins vrai que le taux d’abstention et les votes nuls ou blancs ont représenté près d’un quart de l’électorat brésilien. Cette donnée nous semble être en lien direct, entre autres considérations développées plus loin, avec la campagne anti-Dilma menée par les médias adeptes de la distorsion communicationnelle et exploitant jour après jour des rumeurs afin d’affaiblir la candidate. Le score relativement élevé de Marina Silva peut également, selon nous, être considéré comme l’un des résultats de cette opposition médiatique. Néanmoins, tout ceci n’est pas sans soulever un certain nombre de questions qui ne peuvent se réduire uniquement à l’influence médiatique. La première d’entre elles concerne les instituts de sondage et leur incapacité à prévoir d’une part, et ce jusqu’à la veille du jour des élections, la possibilité d’un second tour, d’autre part l’estimation correcte du taux d’intention de vote pour Marina Silva. Les quatre principaux instituts de sondage, Ibope, Datafolha, Vox Populi et Sensus, se sont en effet tous trompés sur l’estimation des résultats des trois candidats et leurs prévisions concernant Dilma Rousseff nous plonge dans une certaine perplexité.
En ce qui concerne Marina Silva, la sous estimation dont elle a fait l’objet va de pair avec le peu de répercutions médiatiques des questions socio environnementales au Brésil. Si la
trajectoire personnelle de Marina Silva, issue des milieux les plus pauvres du Brésil, force l’admiration et fait penser à celle du Lula, il est important de rappeler que cette candidate d’opposition à Dilma et à Serra a été, entre 2003 et 2008, la ministre de l’Environnement de Lula dans une période marquée par différents scandales et prises de positions ayant entraîné l’indignation de bon nombre de militants et d’intellectuels : parmi elles, des politiques favorables à l’agrobusiness impliquant la légalisation commerciale du soja transgénique et la non application de la loi obligeant les industries à étiqueter les produits contenant plus d’1 % d’OGM. Il est également intéressant de relever un paradoxe dans la candidature de la candidate « écolo » : son vice-président n’était autre que Guilherme Leal, le fondateur et co-PDG de la multinationale Natura et la 13ème fortune du Brésil. Le
dimanche 17 octobre 2010, Marina Silva a annoncé ne pas donner de consigne de vote pour le second tour.
Une autre des questions soulevées par les résultats du premier tour concerne la popularité de Lula estimée, par de récents sondages à près de 79 % d’opinions positives. Nous considérons que le résultat de Dilma Rousseff ajouté au taux d’abstention et de votes nuls ou blancs nuancent quelque peu ce taux de popularité estimé et qu’une faille s’y dévoile. S’il est indéniable qu’une politique en faveur des plus pauvres a été menée sous les présidences de Lula, notamment au travers de programmes sociaux d’assistance comme Fome Zero ou Bolsa Familia, permettant à une classe très populaire d’accéder au marché, le Brésil reste, par des choix politiques de Lula, un pays profondément inégalitaire et possédant un taux de violence frisant ceux d’une guerre civile dans certaines favelas.
Ces indicateurs sociaux liés à un éloignement des grands projets du PT de 1989 (réforme agraire, réforme fiscale...) expliquent qu’une partie des militants, des intellectuels et des inconditionnels d’hier sont devenus
plus critiques sur les ambivalences de la gauche incarnée par Lula. Ces ambiguïtés idéologiques de la gauche brésilienne expliquent, en partie, la posture adoptée par les trois candidats du 1er tour et éclaire aujourd’hui la non consigne de vote de Marina Silva. Pour le sociologue Luis Fernando Novoa Garzon, enseignant-chercheur à
Universidade Federal de Rondonia,il existe une convergence des programmes des trois principaux candidats qui se caractérise par le fait que la possibilité de nouveaux choix économiques venant heurter les intérêts du système financier n’a pas été discutée. Il n’y a donc pas eu de confrontation réellement idéologique ou politique et, par conséquent, pas de débat de fond. Les candidats se sont davantage disputés la gestion du système, consolidée dans les années Lula, que la mise en place d’un système politique. Cette convergence idéologique des projets explique, nous semble-t-il, le fait que le débat politique s’est focalisé davantage sur les affaires : accusation d’accès illégaux aux dossiers fiscaux de la fille de Serra et d’autres membres du PSDB par le PT, trafic d’influence au ministère ou la démission de la ministre de la
Casa Civil. Ces affaires ont occupé le terrain alors qu’un véritable débat de fond sur les insuffisances du bilan Lula aurait pu permettre une mise en perspective des enjeux à venir : quid de la Réforme Agraire - présente dans le programme de Lula dès 1989 - et des Sans Terre ? Quid de la question indienne au Brésil dont les insuffisances politiques ont fait l’objet d’un récent rapport d’
Amnesty International ? Quid de la gestion de l’Amazonie lorsque 67 millions d’hectares sont privatisés ? Quid de la réforme fiscale ?