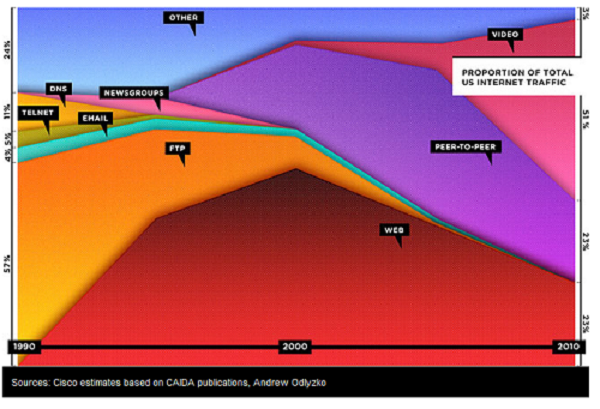Si l’on se penche un peu plus précisément sur les chiffres, le constat peut être plus nuancé. Certes les ventes augmentent, mais le montant des exportations baisse de 15,9 % car il prend en compte les ventes, mais aussi les préventes (investissements dans les programmes à venir). Comme ces dernières subissent une baisse de 63,7 % par rapport à 2012, la fiction est le seul genre à ne pas connaître de hausse.
Outre la crise économique encore présente sur le marché international, d’autres facteurs peuvent expliquer ces chiffres. « Le volume d’heures vendues a augmenté mais le prix de vente a baissé », explique Laetitia Recayte. Par exemple, la première saison des
Revenants, que les médias citent en exemple de succès mondial, ne s’est vendue que
80 000 euros au Royaume-Uni. Un prix de vente relativement faible comparé au
1,4 million d’euros nécessaire pour produire chaque épisode. « De plus, de nombreux pays comme
Israël ou la
Corée du Sud ont rejoint un marché mondial de la fiction qui a explosé, précise la productrice, et chacun doit se démarquer, l’enjeu se trouve au niveau du marketing. »
La concurrence étrangère est en effet très forte. Si l’on observe la production de nos voisins européens, on comprend vite que la France souffre encore d’un retard conséquent. On parle souvent de la Scandinavie qui, grâce à des coproductions, se taille également une bonne part du gâteau.
Real Humans, dernier grand succès en date, a été vendue dans 53 pays, dont la Corée du Sud et sera adapté aux États-Unis. Même l’Allemagne fait mieux que la France avec
environ 100 millions d’euros de ventes à l’étranger pour ses seules fictions.
Plus étonnant,
un rapport de Médiamétrie affirme que la Turquie, qui avant 2005 ne produisait presque pas de séries, s’élève au rang du
pays numéro un en matière d’exportation, devant les Américains, du moins en volume. Près de 36 % des séries importées dans le monde sont originaires de Turquie, contre 32 % pour les États-Unis et 13 % pour la Corée.Et pourtant les budgets de ces séries turques sont très faibles, loin des millions parfois dépensés par TF1 ou Canal+. « Là encore il faut relativiser ces chiffres, la France s’est concentrée sur les fictions de prime time alors que la Turquie peut fournir des centaines d’épisodes de type
soap opéra. », nuance Matthieu Bejot, de TV France International. Le rapport explique par ailleurs que ce sont surtout la Scandinavie, Israël et Royaume-Uni, qui s’imposent aussi comme des « fournisseurs incontournables de séries locales au succès international. »
Et en effet,
les chiffres du Royaume-Uni sont impressionnants. 1,2 milliard de livres (956 millions d’euros) de ventes à l’étranger pour les programmes télévisés en 2012,
selon une étude de la Pact. C’est huit fois plus que les ventes de l’audiovisuel français, qui s’élèvent à 127 millions d’euros la même année (137 millions en 2013). Et bien sûr, la fiction anglaise est au cœur de ce succès avec des séries comme
Sherlock, Downton Abbey, Broadchurch, Parade’s End… Si les critères qui rentrent en jeu dans le calcul des ventes sont différents entre la France et l’Angleterre, le fossé reste bien réel.
C’est ici qu’apparaît, en toile de fond, l’un des handicaps des séries françaises à l’international, et surtout dans les pays anglo-saxons : la langue. « La langue est le principal problème, explique Alessandra Stanley, du
New York Times, les Américains commencent à peine à accepter les sous-titres, mais cela concerne encore qu’une certaine élite de téléspectateurs. » Il faut néanmoins préciser que ce facteur de la « langue anglaise » n’est pas non plus rédhibitoire. Certes la filiation entre l’Angleterre est l’Amérique est culturellement et historiquement évidente. Mais les Américains doublent régulièrement les séries anglaises, de façon à inclure leur accent.
Certains médias expliquent par exemple que l’acteur David Tennant, qui jouait déjà le rôle principal dans la version anglaise de
Broadchurch, travaille son accent américain pour jouer dans le remake de cette série aux États-Unis. Et en Europe, de nombreux pays se contentent de sous-titrer les séries étrangères en lieu et place d’un doublage comme on le voit en France.
Autre problème récurrent, le format. Le succès de séries comme Julie Lescaut dont, par le passé, les épisodes duraient 90 minutes, n’est plus envisageable aujourd’hui. Une étude NPA Conseil de septembre 2013 a étudié le phénomène chez TF1, France 2, France 3, M6 et Arte lors des prime times. En 2012, 150 soirées diffusaient des séries contre 100 pour les téléfilms. Progressivement, le format de 52 minutes, plus adapté à la grille des programmes et à l’exportation, a pris le dessus. Si ce modèle souffrait au début des comparaisons avec les séries américaines du même format, il commence enfin porter ses fruits dans l’Hexagone. Le nombre d’épisodes de 52 minutes a presque doublé entre 2011 et 2012, passant de 53 à 94 épisodes diffusés sur les grandes chaînes gratuites.
Le 90 minutes est devenu quant à lui simplement « événementiel », même s’il n’est pas totalement rédhibitoire. On peut citer la série anglaise
Sherlock qui, malgré des saisons de trois épisodes de 90 minutes chacun, connaît un succès mondial, devenant le plus gros succès de la BBC actuellement. En France, le problème de l’industrialisation de la fiction demeure, et ce sur deux points principaux : le temps de production et le volume par saison. « La France, contrairement aux États-Unis, ne fonctionne pas en flux tendu, explique Julie Salmon,
de la société High concept. C’est à dire que là-bas, l’écriture des épisodes et leur tournage se chevauchent pour accélérer la production. Pour l’instant en France, seule la série
Plus Belle La Vie fonctionne ainsi. » C’est l’une des raisons pour lesquelles la seconde saison des
Revenants sera diffusée « en 2014/2015 »,
selon Canal+, deux ans après la première.
C’est pour remédier à ces retards que le CNC a mis en place, depuis 2012,
un plan d’aide pour la fiction française. En plus de favoriser le format de 52 minutes, l’objectif est simple : « inciter les chaîne à produire des séries plus longues, en terme de volume, à savoir une dizaine d’épisodes, explique Benoît Danard, directeur des études des statistiques et de la prospective, car en France comme à l’international, il faut un nombre d’épisodes importants pour s’inscrire dans la durée. » Pour l’instant une saison ne compte qu’entre six et huit épisodes, quand les grands networks américains commandent souvent une vingtaine d’épisodes (les chaînes câblées comme HBO en comptent souvent moins de dix). De plus, il n’est pas rare en France que deux épisodes soient diffusés par semaine, ce qui réduit l’espace de diffusion. C’est le cas de la série à succès
Fais pas ci, fais pas ça sur France 2, qui compte seulement huit épisode par saison. Difficile dans ces conditions de fidéliser un public international, plus habitué à retrouver ses shows favoris de manière plus régulière et plus étalée dans l’année.
Mais les chaînes et les productions sont bien décidées à accélérer le rythme et « s’américanise » peu à peu. « Si le marché local reste la priorité, il est évident que le rythme des productions s’accélère, avec plus de volume, pour faciliter la vente à l’étranger », explique Mathieu Béjot.
Autre moyen de financer des fictions et de s’ouvrir des portes sur le marché international : les coproductions, souvent tournées en langues anglaises. Les chaînes européennes l’ont compris : si elles veulent faire face à l’hégémonie américaine, il faut multiplier les coproductions pour partager les coûts. Mais en 2013, les devis de coproductions d’initiatives françaises ont vu les apports étrangers baisser de 46,3 millions d’euros. L’Union européenne a de son côté décidé de relever ses subventions pour la production, à près de 100 millions de dollars. Un des derniers exemples en date est la série
Taxi Brooklyn, coproduction franco-américaine de la société EuropaCorp, lancée par TF1 justement pour être exportée. Avec deux millions d’euros dépensés par épisode, un tournage en langue anglaise, un showrunner*, une actrice américaine reconnue (Chyler Leigh, de la très populaire série
Grey’s Anatomy) et un réalisateur de blockbusters (Olivier Megaton, à qui on doit les films
Taken). Si le succès critique et public n’a pas été au rendez-vous en France,
Taxi Brooklyn a tout de même été diffusé à 22h sur la chaîne américaine NBC avec des chiffres plus concluants. Cette série, et d’autres comme
Crossing Lines ou les
Borgia avant elle, sont emblématiques d’un mouvement de production porté vers l’international. « Il y a 10 ans, explique Louis Gauthier du CNC, ce qui s’exportait n’était pas forcément conçu pour l’international, contrairement à aujourd’hui. » Preuve de ce virage vers l’international :
l’annonce de la mise en production de la série Versailles par Canal+. Cette nouvelle série historique, qui suivra le parcours du Roi Soleil, aura certes un réalisateur français en début de saison (Jalil Lespert) mais sera tournée en anglais et showrunnée par deux anglais, Simon Mirren (
FBI-Portés Disparus, Esprits Criminels) et David Wolstencroft (
MI-5, The Escape Artist).
Pour que les fictions françaises décollent vraiment à l’étranger, tous les acteurs de la profession s’accordent sur une chose : le contenu devra toujours primer sur les techniques de production. Mathieu Béjot, de TV France International, qui travaille aux côté des producteurs, le répète : « les séries françaises devront être encore plus audacieuses et diversifiées pour s’imposer à l’étranger. »