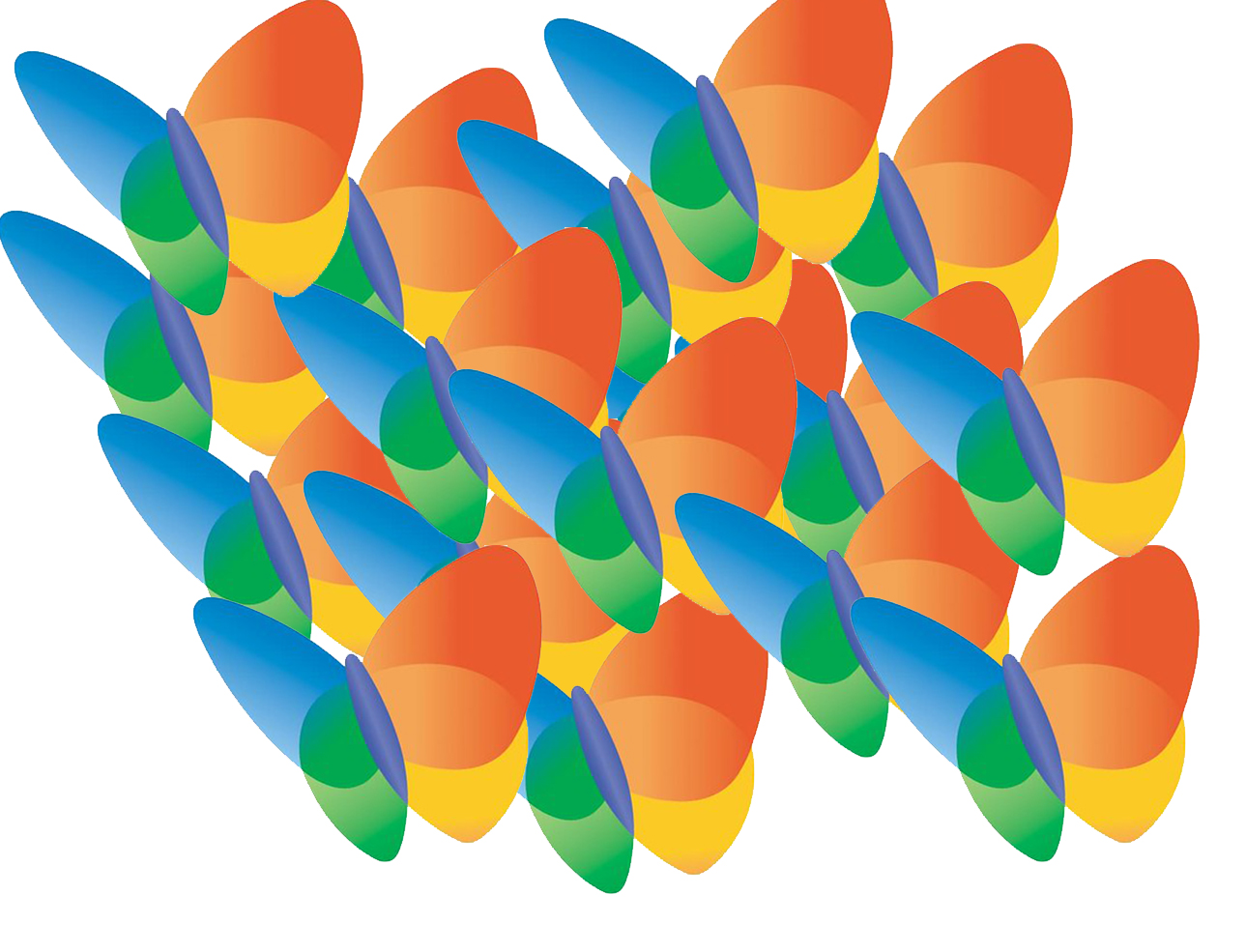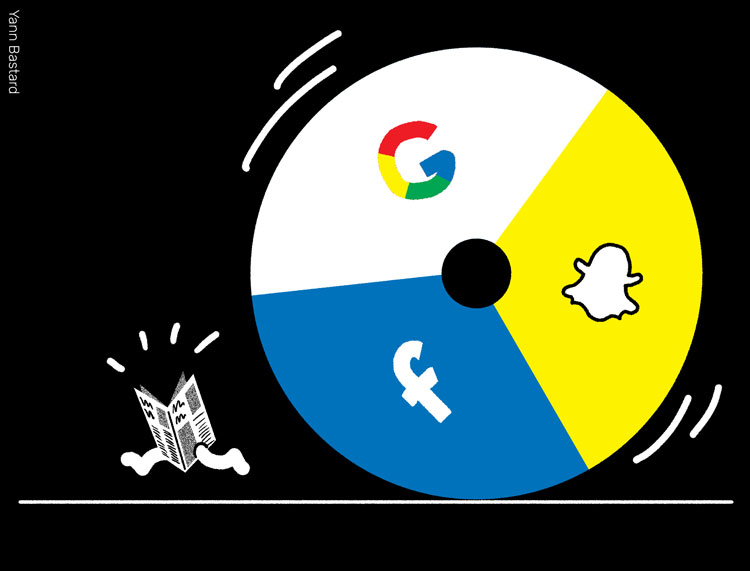Références
Roland BARTHES, Mythologies, Éditions du Seuil, 1957.
Vincent BASTIEN, Jean-Noël KAPFERER, Luxe Oblige, Paris, Eyrolles, 2017 [2008].
Bernard ECK, « Le pharmakos et le meurtrier », in Véronique LIARD (dir.), Histoires de crimes et société, Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, 2011, p.15-29.
Eileen FISCHER, Marie-Agnès PARMENTIER, « How Athletes Build their Brand », International Journal of Sport Management and Marketing, 11, 2012, pp.106-124
Nathalie HEINICH, La Gloire de Van Gogh. Essai d’anthropologie de l’admiration, Paris, Les Éditions de Minuit, 1991.
Edgar MORIN, L’Esprit du temps, Paris, Éditions Grasset Fasquelle, 1975.
Nathalie NADAUD-ALBERTINI, 12 ans de téléréalité… au-delà des critiques morales, Bry-sur-Marne, Ina Éditions, 2013.
--
Crédit :
Illustration Ina -
Guillaume Long