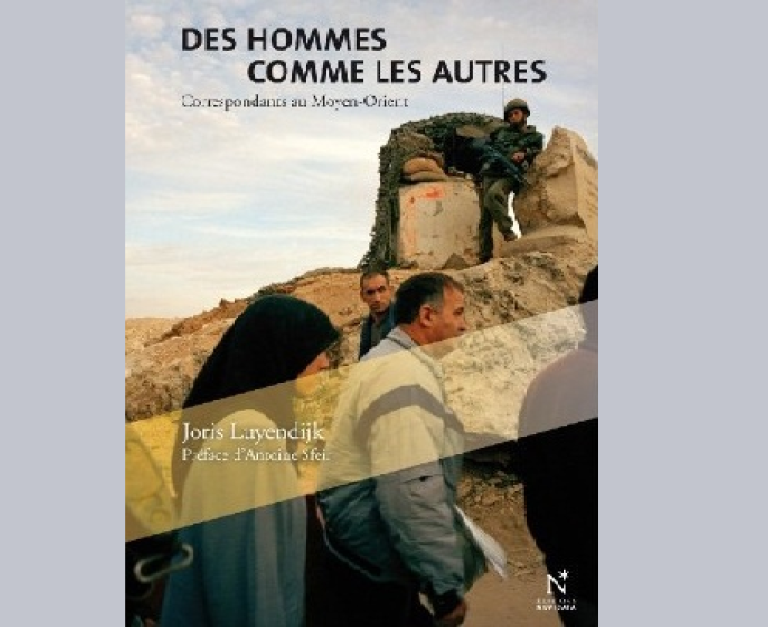Avec lui, il y avait toujours quelque chose à fêter. Un scoop, un bouclage, le retour des beaux jours — tout était prétexte à sabler le champagne. La tête qu’il a fait quand le règlement de la cafétéria du journal a été réformé : désormais, il fallait obligatoirement acheter de la nourriture si on voulait consommer de l’alcool. Mon collègue a crié au scandale. Puis il s’est mis à manger des pommes. Une pomme, c’est de la nourriture, non ?
Au cours de ces pots improvisés, il ressassait le bon vieux temps, les heures de planque, les copains flics qui l’avaient mis sur « des faits-div en or ». C’était un excellent conteur, et comme personne ne l’attendait chez lui, il savait faire durer les réjouissances. Le défilé d’anecdotes conduisait immanquablement à la guerre. Il en avait couvert une, quinze ans plus tôt, et une part de lui-même était restée là-bas. Tout, depuis, lui semblait dérisoire.
À ce stade de la soirée, il s’en prenait en général à l’évolution de la presse, et au « mauvais coton » qu’elle filait, crachant tout son mépris pour les magazines qui encombraient son bureau avec leurs palmarès des grandes écoles, leurs enquêtes sur les francs-maçons, les foires au vin, et leurs dossiers sur les psys. Jamais il ne serait allé consulter, et c’est peut-être pour cette raison que je pensais à lui en entrant dans le cabinet de Jessica Zabollone-Hasquenoph, psychologue et psychosociologue à Paris.
De plus en plus de journalistes viennent la voir pour discuter de ce que leur métier leur fait. Il lui arrive aussi d'intervenir dans des rédactions. Elle n’est pas la seule. Ce n'est plus tabou. Est-ce dû au rôle croissant des départements de ressources humaines dans les entreprises de médias ? À la constitution d’équipes dédiées à des enquêtes au long cours sur des sujets lourds, qui amènent à partager certaines difficultés ? À l’avènement d’une nouvelle génération de journalistes plus attentive à ses propres fragilités ? Il faudra un jour écrire cette histoire. Pour Jessica Zabollone-Hasquenoph, tout a commencé en 2015.
On m'a dit que vous vous étiez spécialisée dans l'écoute des journalistes…
Jessica Zabollone-Hasquenoph : Les psys ne sont pas spécialisés par métiers mais j'ai été amenée à intervenir dans certaines rédactions après l’attentat contre Charlie Hebdo. Puis des groupes de presse ont fait appel à moi au moment du Bataclan pour prendre en charge toutes leurs rédactions. Dans ce contexte, j'ai rencontré beaucoup de journalistes. Depuis, mon nom circule dans ce milieu et beaucoup de journalistes d’autres rédactions viennent me voir, envoyés par des collègues qui leur disent : « Arrête de voir des psys, va voir Jessica ».
Jessica Zabollone-Hasquenoph, psychologue. Illustration : Alice Durand.
Qu’est-ce que ça veut dire ?
Cette formulation pourrait être comprise comme une remise en cause de ma profession, mais elle a le mérite de gommer le côté parfois stigmatisant de la rencontre avec le psy. Elle met l’accent sur la nécessité de créer un lien. D’autre part, je pense que cela vient de ma posture professionnelle, qui est parfois en rupture avec le positionnement de certains psys, et avec la représentation que l’on peut avoir des psys. J'ai une approche un peu plus pragmatique. Et certaines expériences me permettent de comprendre ce que vivent parfois les journalistes.
J’ai fait de la gestion de crise dans des pays en guerre. Sur ces terrains-là, tout ce qu'on peut apprendre dans les bouquins, sur l'effroi, sur le sens de la vie, on l’expérimente concrètement, charnellement. Le superflu s’envole complètement. Il n'y a plus qu'une question de vie ou de mort et on voit là l'importance du lien à l'autre, et comment ce lien se construit même quand on n'a pas le même langage. On touche quelque chose d’essentiel. C’est une expérience que vivent beaucoup de journalistes, notamment les reporters de guerre, et qui n’est pas palpable, pas nommable non plus. Entre personnes qui ont vécu ça, on se reconnaît avec nos tripes.
Vraiment ?
Oui, même si on ne fait pas le même métier, il y a là une proximité qui rend la rencontre possible. Souvent, les psychologues restent cloisonnés dans ce qu'ils connaissent, dans ce quotidien un peu confortable, avec des patients qui viennent à eux avec une problématique déjà nommée... Le travail d'approche et de construction du lien n'est pas le même.
Quand on va sur le terrain, à la rencontre de ceux qui vont mal et qui n'ont pas forcément demandé à être pris en charge, il ne faut pas être intrusif, il faut repousser cette espèce de fascination morbide, de curiosité un peu malsaine, que l’on peut avoir inconsciemment. Quand une personne échappe à un attentat ou à un grave accident, elle n’a pas du tout envie de se confier à la première blouse blanche qui s’approche et lui dit : « Ça a dû être atroce, vas-y, raconte-moi ». C’est pareil pour un journaliste qui a couvert un événement traumatisant. Cette attitude ne fonctionne pas.
Qu’est-ce qui fonctionne ?
Dans cette situation-là, déjà, je ne dis pas : « C'est atroce, vas-y, raconte-moi ». J’essaye de souligner la force dont chacun a fait preuve. Je cherche à valoriser les ressources qui ont été mises en œuvre. Et surtout, à ce moment-là, je ne vais pas leur dire qu'ils vont mal. Parce qu'ils le savent et que c'est difficile : à côté d’eux, c’était la mort.
Quand vous êtes sollicitée par des rédactions après un événement dramatique, comment cela se passe-t-il ?
Il faut commencer par s’apprivoiser. Une communication préalable prévient que je suis sur site, donne mon numéro de téléphone… mais ça, ça ne suffit pas. Lorsque toute la rédaction est réunie à l’occasion d’une réunion, je prends quelques minutes pour me présenter, leur dire que je suis à leur disposition, qu’ils peuvent passer me voir, m’appeler, ou me rencontrer hors de l’entreprise, à mon cabinet, selon les contraintes de chacun…
D’emblée, je leur donne les premiers conseils et je les invite à reconnaître qu’ils ont vécu quelque chose qui sort de l’ordinaire mais qui est terminé, ça va aider le cerveau à cloisonner, à « finir » l’événement. Je leur dis aussi que certains d’entre eux vont se sentir un peu moins bien que d’habitude, que d’autres vont se sentir bien, et qu’ils peuvent aussi venir me voir pour me dire qu’ils vont bien et me raconter des blagues pour que moi-même j’aille mieux. Mais je préviens qu’il peut arriver que des petites choses les perturbent, perturbent leur sommeil, et que si ça leur arrive, on peut peut-être en discuter…
Quels sont ces quelques symptômes auxquels il faut prêter attention ?
Les premiers jours, il est probable qu’ils dorment mal, c'est normal — disons plutôt « habituel », parce que sinon les gens qui dorment très bien imaginent qu'ils ne sont pas normaux. Ils peuvent ressentir une intense fatigue parce que leur organisme a été soumis à un stress intense, or le stress est très énergivore.
Après, on peut observer des reviviscences. Les reviviscences, c'est quand on a des images qui reviennent, qui nous envahissent, que ce soit par cauchemar ou en journée, et associées à ces images, on a exactement les mêmes sensations qu'au moment de l'événement.
Autre symptôme du stress post-traumatique : l'hyperactivité neurovégétative. On est aux aguets en permanence, un petit bruit ou une odeur va nous faire sursauter, on est hyper vigilant par rapport à un danger potentiel.
Et puis il y a l'évitement. Le cerveau n’a pas du tout envie de revivre ce qu'il a vécu, donc il va faire en sorte d'éviter absolument tout ce qui lui rappelle cet événement-là. Des lieux, des odeurs, des personnes… Et si quelque chose risque de m’y faire penser, j’évite de penser.
« Autre symptôme du stress post-traumatique : l'hyperactivité neurovégétative. Un petit bruit ou une odeur va nous faire sursauter, on est hyper vigilant par rapport à un danger potentiel. » Illustration : Alice Durand.
Que produit l’association de tous ces éléments ?
Au moment de l'événement, l'organisme a été soumis à un stress intense. En gros, une partie du cerveau l’a vécu, une autre s'est déconnectée. Donc, il y en a une qui dit : « Bah non, c'est pas arrivé » et l'autre « Bah si, regarde, je te renvoie la reviviscence ». Et l'autre dit : « Mais moi, je ne peux pas, c'est trop dur. » Et plus j'évite, plus il y a des reviviscences.
C'est comme lorsque vous avez quelque chose à dire à quelqu'un. S'il n'entend pas, vous allez le lui répéter de plus en plus fort. C'est de plus en plus envahissant. Or ce conflit entre reviviscence et évitements s’agite en parallèle de l'hypervigilance : on se dit qu’on est peut-être encore dans le même danger, on ne sait donc pas si on peut ranger l’événement dans les souvenirs ou si c’est encore réel.
Du coup, il faut tout remettre bout à bout, refaire le puzzle, et une fois qu'on voit la scène dans sa globalité, on peut enfin s'en détacher, la ranger dans la case souvenirs. À ce moment-là, on n'a plus besoin de reviviscences, il n'y a plus d'évitement, ni d'hypervigilance.
Et si ça ne marche pas ?
Quel que soit le trouble, état de stress post-traumatique ou autre, notre boulot de psy, c’est de nous adapter — au terrain, à l’environnement, au patient qui est en face, à ses troubles, sa pathologie, son vécu, son ressenti du moment… On a un socle de connaissances, un seau d’outils, et on va construire une stratégie qui conviendra à la personne qui est en face. Je dis souvent : « On va essayer ça, si ça ne marche pas, c’est pas grave, mais il faut me le dire, et on trouvera autre chose. »
Un patient qui ne va pas mieux n’ose pas forcément le dire, et ça le conforte dans sa douleur d’isolement et de solitude. Il se dit : « J’ai un traitement, des conseils, des outils, des exercices à faire, et ça va pas mieux, donc c’est vraiment moi qui suis intraitable, plus personne ne peut rien faire pour moi. » Alors que ce n'est juste pas le bon truc. Quand vous avez mal et que le médecin vous donne un antidouleur, si vous continuez à avoir mal, vous faites quoi ? Vous le dites au médecin, qui peut adapter la molécule de l’antidouleur ou le dosage. Nous, c’est pareil. On ajuste.
À quelle génération appartiennent les journalistes qui viennent vous voir ?
Les plus jeunes ont 25 ans, les plus âgés environ 40-45 ans. Au-delà, on a cette génération qui dit « faut vite retourner sur le terrain et passer à autre chose ». Parce que sinon ils n'y retourneront jamais, parce que ce n’est pas si grave, parce que plein de trucs… Mais ils n’admettent pas leur mal-être.
Ou alors c'est de l'addiction ?
Les addictions sont souvent liées à un mal-être — plus encore quand on n'arrive pas à l'exprimer. Si on est dans un stress post-traumatique, on va avoir des addictions encore plus fortes parce que l'effraction psychique liée au stress post-traumatique est terrible à élaborer. L’addiction sert à atténuer des symptômes. En réalité, ça ne les atténue pas, mais ça les cache, et ça permet de penser à autre chose.
Et le fait de partir en reportage dans une zone dangereuse peut jouer ce rôle-là ?
Je ne parlerais pas d’addiction au danger ou à la peur, mais d’addiction à cette saveur qu’on ne trouve pas ailleurs. Quand on est dans un pays en guerre, on ressent les choses avec une intensité incroyable. Ce n’est pas le danger en soi qui les attire ; mais dans le danger, ils ont éprouvé quelque chose qu’ils voudraient retrouver encore et encore : l’impression de ressentir la vie. Évidemment, ce sont des sensations impossibles à retrouver dans un pays stable, et en rentrant, il faut réussir à remettre le curseur.
C’est-à-dire ?
Il faut être clair sur le fait qu'on a vécu quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc, il ne faut pas s'attendre à retrouver dans l'ordinaire ce qu'on a ressenti là-bas, ni les questions qu'on a pu se poser. Il faut s'asseoir aussi sur cette espèce de fierté qu'on a pu ressentir. On a pu être félicité par les confrères d’avoir bravé des dangers, se sentir important, valorisé, et puis on rentre à la maison et notre compagnon ou notre compagne nous rappelle qu’il faut sortir la poubelle et songer à tondre la pelouse. C'est très difficile pour plein de monde de revenir de mission et de remettre ce curseur parce qu'on n’y est pas préparé.
« Avant de partir en reportage, il faudrait se rappeler qu’on va porter le costume de journaliste pendant tout le temps de la mission, mais qu’il faudra l’ôter dans la vie privée [...] » Illustration : Alice Durand.
Quels conseils donnez-vous pour y parvenir ?
Le premier conseil, c'est d'en parler. Avant de partir en reportage, il faudrait se rappeler qu’on va porter le costume de journaliste pendant tout le temps de la mission, mais qu’il faudra l’ôter dans la vie privée, au moment de revenir à la vie normale. En rentrant, cela peut être bénéfique de débriefer avec des collègues, de parler de ce qu’on a vécu, et de clore cette séquence. Verbaliser la nécessité de remettre le curseur aide à distinguer l’ordinaire de l’extraordinaire.
Le deuxième conseil, c’est de se dire qu'au-delà du journaliste, on a l'être humain. Le journaliste peut ne pas se sentir mal en tant que fonction, mais en tant qu'être humain, il a le droit aussi, à un moment, d'être touché par des choses. Ce n'est pas parce que c'est ton métier que tu ne peux pas être touché comme tout le monde.
Quelles difficultés expriment les journalistes qui viennent vous voir à titre individuel ?
J’ai vu beaucoup de psycho-trauma, des personnes qui ont passé du temps dans des pays comme l'Irak, par exemple. Donc, en rentrant, c'est compliqué.
J'ai vu aussi des journalistes qui disaient, notamment après le Bataclan : « Moi, j'ai l'impression que je vais bien, mais je viens vous voir parce que je ne suis pas sûr d'aller bien du coup. »
J'ai vu des personnes qui, du fait de leur métier, ont été harcelées, non pas par des collègues ou leur hiérarchie, mais par le public.
Au-delà du trauma, j'ai vu pas mal de problèmes d'addictions. L'addiction est très très très présente chez les journalistes.
Le vieux cliché des journalistes alcooliques ?
Moi, j'ai surtout des cas de consommation de drogues dures. Beaucoup, beaucoup, beaucoup... Surtout de la cocaïne. C’est tellement répandu que les journalistes qui en prennent ne voient pas trop le problème. Souvent, c'est pour s'extérioriser, pour penser à autre chose, pour avoir la pêche, faire la fête, s’oublier un peu. Ça désinhibe tellement qu'on oublie de penser à soi. C’est une fuite de ce qui se passe en soi.
Si ce n’est pas un problème pour eux, pourquoi viennent-ils vous voir ?
Ils viennent parce qu'ils ont été alertés par leur entourage. C’est aussi le cas des journalistes qui vivent avec un trauma. Souvent, ils ont une peur très particulière : ils craignent, en allant voir un psy, d’oublier ce qu'ils ont vécu.
Ils ont peur d'oublier ?
Ils ont peur qu'on efface ce truc très important qu'ils ont vécu. C'est une effraction, quelque chose qui est très douloureux, certes, mais qui est fondateur à leurs yeux. Moi, la première chose que je leur dis, c'est qu'il ne faut surtout pas oublier. Au contraire, il faut bien s'en souvenir.
Ce n'est pas anodin d'avoir été confronté à la mort. Souvent, ça bouscule notre vie. Ça nous rappelle notre propre mort, et plein de choses vont changer : on réfléchit différemment, et un décalage se creuse avec l'entourage. Leur conjoint, leurs enfants, leurs amis, leurs parents ne les comprennent plus. On est dans le « Mais de toute façon, tu n'as pas vécu, tu ne peux pas comprendre. »
Ce n’est pas vrai ?
Si, c’est vrai, mais ça éloigne terriblement. Il y a parfois une incapacité à ressentir à nouveau quelque chose de l'ordre de l'amour. Le risque est là : il est dans la coupure, la rupture des liens, voire le suicide.
Il y a un très bon bouquin, très beau, du journaliste Jean-Paul Mari : Sans blessure apparente. Il y parle de son trauma. En tant que psy spécialisée dans le trauma, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur le trauma, évidemment. Et je trouve que ce livre-là illustre parfaitement ce que c'est, ses conséquences sur l'entourage, ce qu'on ressent en termes de violence contre soi, et possiblement contre l'autre.
J'aimerais que tous les journalistes puissent lire ce bouquin aussi parce que Jean-Paul Mari a eu le courage de s'exposer de cette manière alors que dans sa génération, ça ne ne se disait pas du tout. Quelque part, lui aussi a ouvert un peu la porte à un changement d’état d’esprit : un journaliste doit pouvoir admettre que son métier, pour lequel il a une passion, est en train de le dévorer.
En quoi consiste votre travail, face à ce genre de situations ?
Notre travail de psy, c’est de mettre des mots sur quelque chose qu’eux-mêmes n'arrivent pas à nommer, faire en sorte qu'ils puissent en faire un souvenir et qu'ils arrivent à recréer du lien avec leur entourage. Enfin, il s’agit de les amener à faire de ce qu’ils ont vécu quelque chose pour eux, qui leur correspond vraiment.
Que peuvent-ils en faire, par exemple ?
Un tas de choses. Dans ce qu’ils ont vécu, je leur conseille de trouver l'essentiel : ce truc qu'on n'arrive pas à nommer, mais qui est peut-être le sens ou la saveur de la vie. Je leur dis qu’ils n’ont pas le droit d'oublier cette chose-là. Quand on a touché de près ce que signifie vraiment le lien à l'autre, on n’a plus le droit de le maltraiter. Sans aller sur des considérations très philosophiques ou très spirituelles, une bienveillance du quotidien s’impose - même si le mot est galvaudé, j'en ai conscience.
Pour se rappeler ce devoir, certains ont gardé une photo d'un sourire, de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas forcément mais qui symbolise cela, et qu’ils regardent régulièrement. D’autres l’encrent par un symbole dans leur peau.
« Certains ont gardé une photo d'un sourire, de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas forcément [...] et qu’ils regardent régulièrement. » Illustration : Alice Durand.
Il y a aussi pas mal de personnes qui changent de vie pour se rapprocher de leurs valeurs, de ce qu'ils ont ressenti à ce moment-là. S’ils ne changent pas forcément de métier, ils changent de rédaction, d'environnement de travail. Parfois ce n’est pas pour des questions de valeurs mais pour ne plus être perçu comme quelqu’un qui a eu un problème. Quand on sait que vous avez vu des psys, même si on y est plus ou moins invité, vous restez parfois le maillon faible...
La peur du stigmate est-elle plus répandue chez les journalistes que dans d'autres professions ?
Elle est très répandue chez les journalistes. Si vous prenez un RH, un webmaster, un ouvrier et un journaliste, les autres ont beaucoup moins, voire pas peur du stigmate professionnel, concernant l’état de stress post-traumatique.
Par contre, si vous prenez un militaire, un soignant et un journaliste, il y aura la même peur du stigmate. Même dans le milieu soignant, pourtant sensibilisé à la question. Il y a cette notion, je crois, dans ces professions-là, de devoir être forts, et plus forts que les autres.
À quelles conditions le fait de prendre le temps de s’analyser pourrait-il être perçu de façon positive ?
Il faut commencer par casser les tabous autour du psy, le démystifier, et s’inscrire dans un rapport d'être humain à être humain. La vulgarisation des troubles psy est essentielle aussi. À cet égard, par exemple, le psychiatre Christophe Debien, qui a créé la chaîne YouTube Le PsyLab, fait un travail formidable.