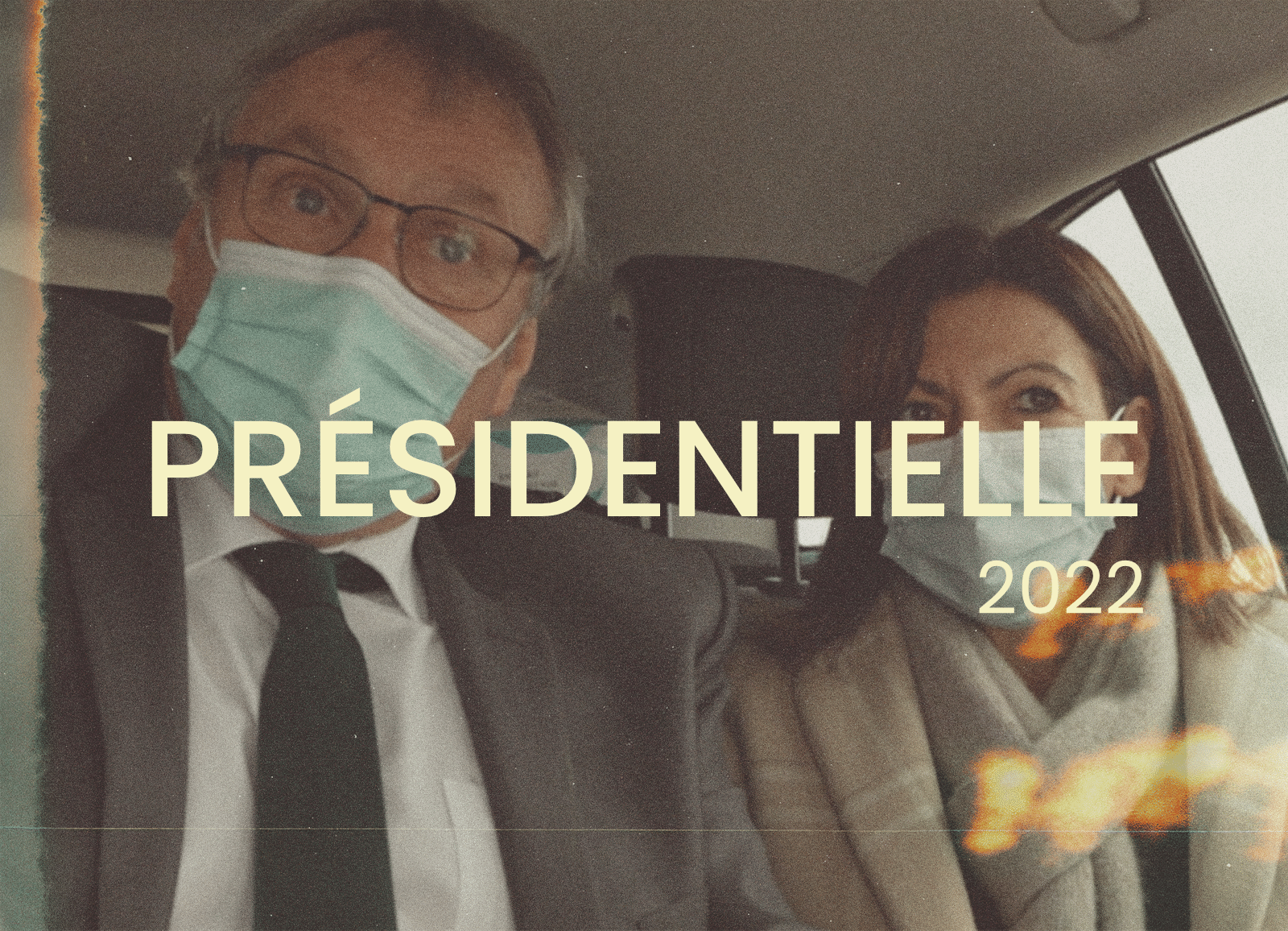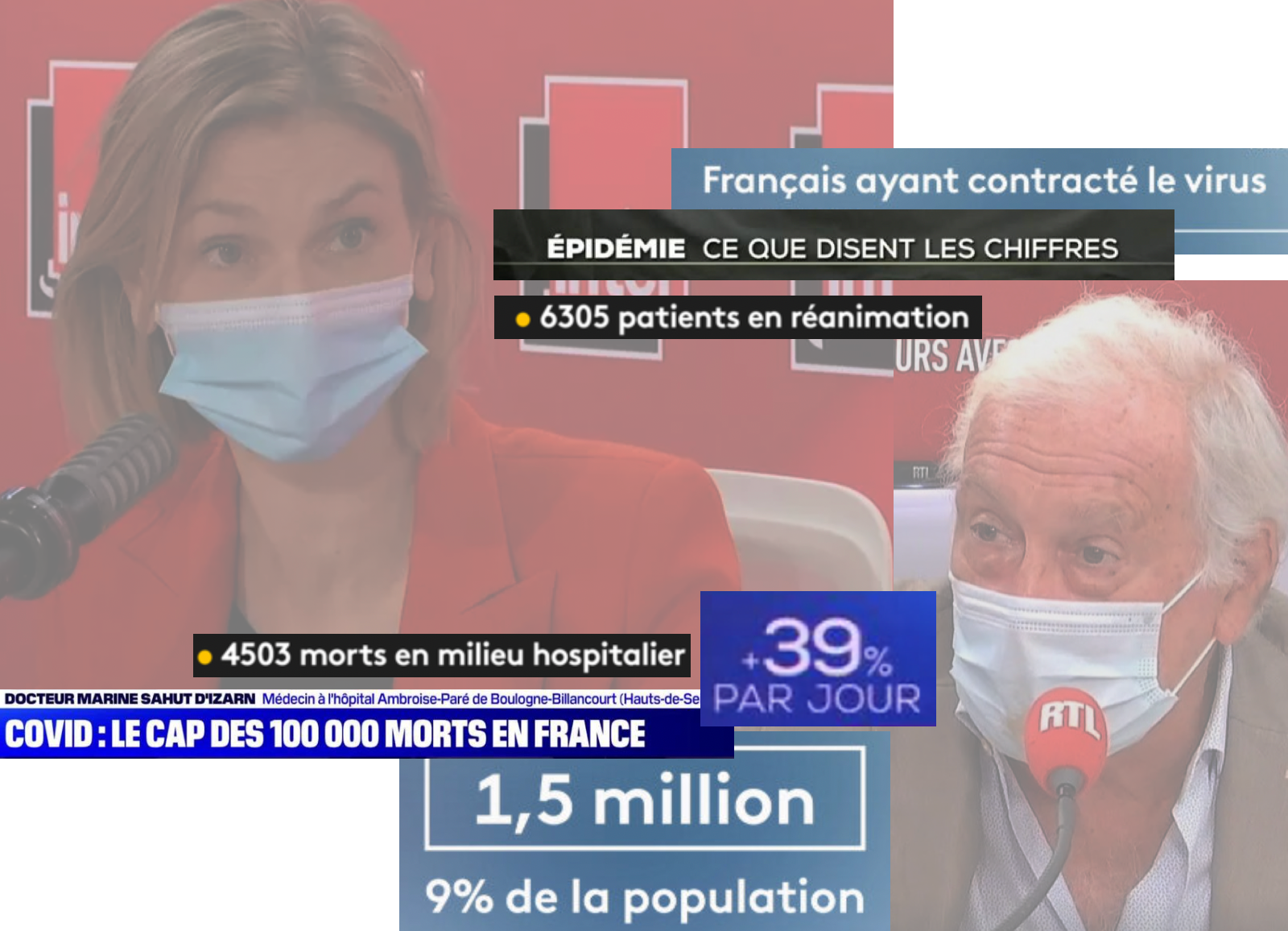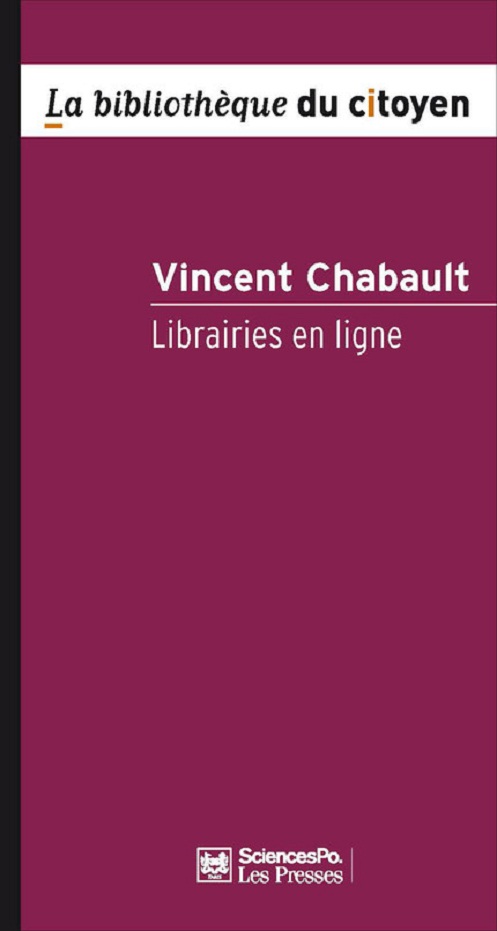La Commission européenne, acteur international de la diversité culturelle ?
Depuis les négociations internationales visant l’adoption de la Convention sur la diversité des expressions culturelles, la Commission européenne est clairement reconnue comme un acteur de la diplomatie internationale de la diversité culturelle aux côtés des États-membres. Elle affirme à cet égard davantage qu’une présence diffuse en plaçant la diversité culturelle et la coopération culturelle parmi les priorités de son action comme l’illustrent l’agenda européen de la culture en 2007 , le programme Media Mundus , l’année européenne du dialogue interculturel de 2008, et plus spécifiquement le protocole de coopération culturelle qui prétend soutenir la mise en œuvre efficace de la Convention.
Ce protocole fait partie des accords de libéralisation commerciale conclus par la Commission européenne et se fonde sur un mode d’action courant de l’UE, nommé « conditionnalité démocratique » de ses relations économiques extérieures. Cela signifie que la Commission européenne cherche à conclure des accords commerciaux de libre-échange sous condition de respect des principes de la Convention sur la diversité culturelle et de la promotion de ses objectifs. En cela, elle tente de concilier des intérêts contradictoires. Il est clair que cette stratégie constitue un mode d’action extérieure dominant de la Commission et procède d’un idéal d’influence sans recours à la force, conforme au modèle de la puissance douce (soft power) , fondé sur l’attractivité, la persuasion et l’imitation.
En ce sens, depuis l’entrée en vigueur de la Convention de l’UNESCO, la Commission européenne est invitée à étudier la possibilité de négocier des dispositions sur la coopération culturelle avec certains partenaires. Alors que les accords commerciaux précédents de l’UE prévoyaient une exclusion totale des services audiovisuels, depuis 2007, la Commission change ses orientations stratégiques, en proposant que les services culturels soient traités en annexe dans un cadre de coopération audiovisuelle et culturelle spécifique. Dans le contexte des négociations sur les accords de partenariat économique avec les quinze pays de Caraïbes (CARIFORUM) – conclu le 15 octobre 2008 -, la Commission européenne négocie un protocole de coopération culturelle qui reprend les principales dispositions de la Convention sur le traitement préférentiel accordé aux biens et aux services culturels. Ensuite, il s’agit de proposer également un tel protocole dans le cadre de l’ALE avec la Corée du Sud.
Le 21 janvier 2009, Catherine Ashton, Commissaire au Commerce extérieur, affirme que ce type de protocole est un instrument innovant de mise en œuvre de la Convention de l’UNESCO et notamment au vue de son objectif de rééquilibrage des échanges culturels, et plus particulièrement de son article 16 sur le traitement préférentiel, lorsque les pays partenaires sont des pays en développement , ou de son article 12 sur la coopération internationale dans les autres cas . Ce protocole s’inscrit dans le droit fil de l’approche visant à assurer aux services audiovisuels qu’ils ne soient pas abordés dans le cadre du volet des engagements de libéralisation commerciale mais dans un cadre adapté de coopération culturelle .
Après huit séries de négociations formelles, l’UE et la Corée du Sud sont parvenues à un ALE qu’elles ont paraphé le 15 octobre 2009 . L’accord inclut ainsi en annexe un protocole de coopération culturelle. Ce dernier prétend mettre en œuvre les dispositions de la Convention de l’UNESCO, tout en renforçant les échanges culturels. Il s’agit de toucher autant tous les secteurs de la culture, notamment l’audiovisuel, la musique, le spectacle vivant que toutes les professions de création artistique, à savoir les producteurs, les distributeurs, les auteurs, les techniciens. L’inclusion du protocole permet également d’insérer un préambule dans lequel il est stipulé que les États qui n’ont pas encore ratifié la Convention de l’UNESCO consentent à le faire rapidement, mentionnant l’intention des parties d’appliquer la Convention . Le protocole partage les définitions de la Convention de 2005 sur les notions de diversité culturelle, d’industrie culturelle et d’expression culturelle . Il s’agit de reconnaître explicitement la nature spécifique des biens et services culturels et exclut les services audiovisuels du corps principal de l’accord – et spécialement du Chapitre 7 qui traite du commerce des services et du commerce électronique – en les abordant à cet égard de façon spécifique et distincte. Son objectif consiste à faciliter la coopération culturelle entre l’UE et la Corée du Sud, en tenant compte du développement des industries culturelles de chaque Partie et des asymétries structurelles de leurs échanges culturels.
De plus, il prévoit la mise en place d’un Comité de coopération culturelle, composé d’experts de chaque Partie sur les questions culturelles, qui sera chargé de la mise en œuvre efficace et équitable du Protocole. Conformément à la législation respective de chaque Partie, le protocole vise en particulier à favoriser la circulation des artistes, ainsi qu’à encourager les coproductions audiovisuelles, permettant de tirer des bénéfices financiers considérables .
En ce sens, après l’accord de partenariat économique entre l’UE et le CARIFORUM, c’est la deuxième fois que la Convention de l’UNESCO est invoquée dans un accord commercial pour justifier que les biens et services culturels soient traités de manière distincte, s’appuyant principalement sur des principes de coopération culturelle. L’esprit du protocole se fonde sur une complémentarité des règles, culturelles et commerciales, et sur la concertation entre ces deux logiques. Son objectif vise à concilier la norme de libre-échange avec celle du respect de la diversité culturelle. Ainsi, dans leurs activités commerciales, les acteurs impliqués dans le secteur culturel doivent prendre en compte autant les préoccupations de coopération culturelle que la logique du marché.
Pourtant, les questions de la promotion de la diversité culturelle et de la coopération culturelle restent ambigües et contradictoires et sont susceptibles de soulever des débats politiques et des interprétations diverses. Dès le début des négociations, les professionnels de la culture restent fort réticents sur l’inclusion du protocole de coopération culturelle et son impact sur l’industrie culturelle européenne, et en particulier sur l’économie de l’audiovisuel européen.