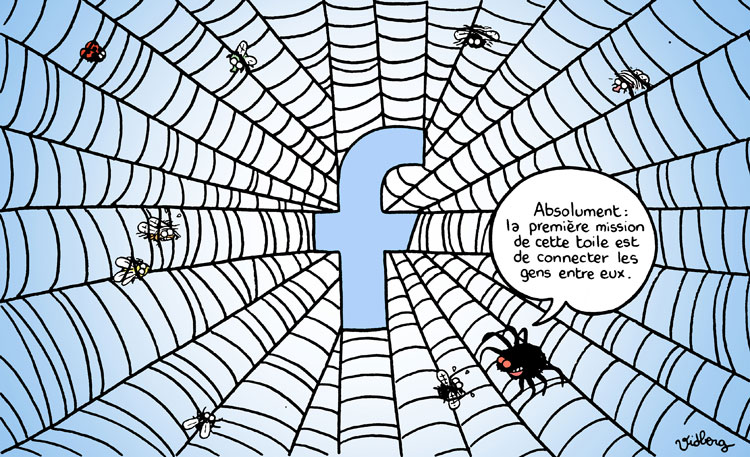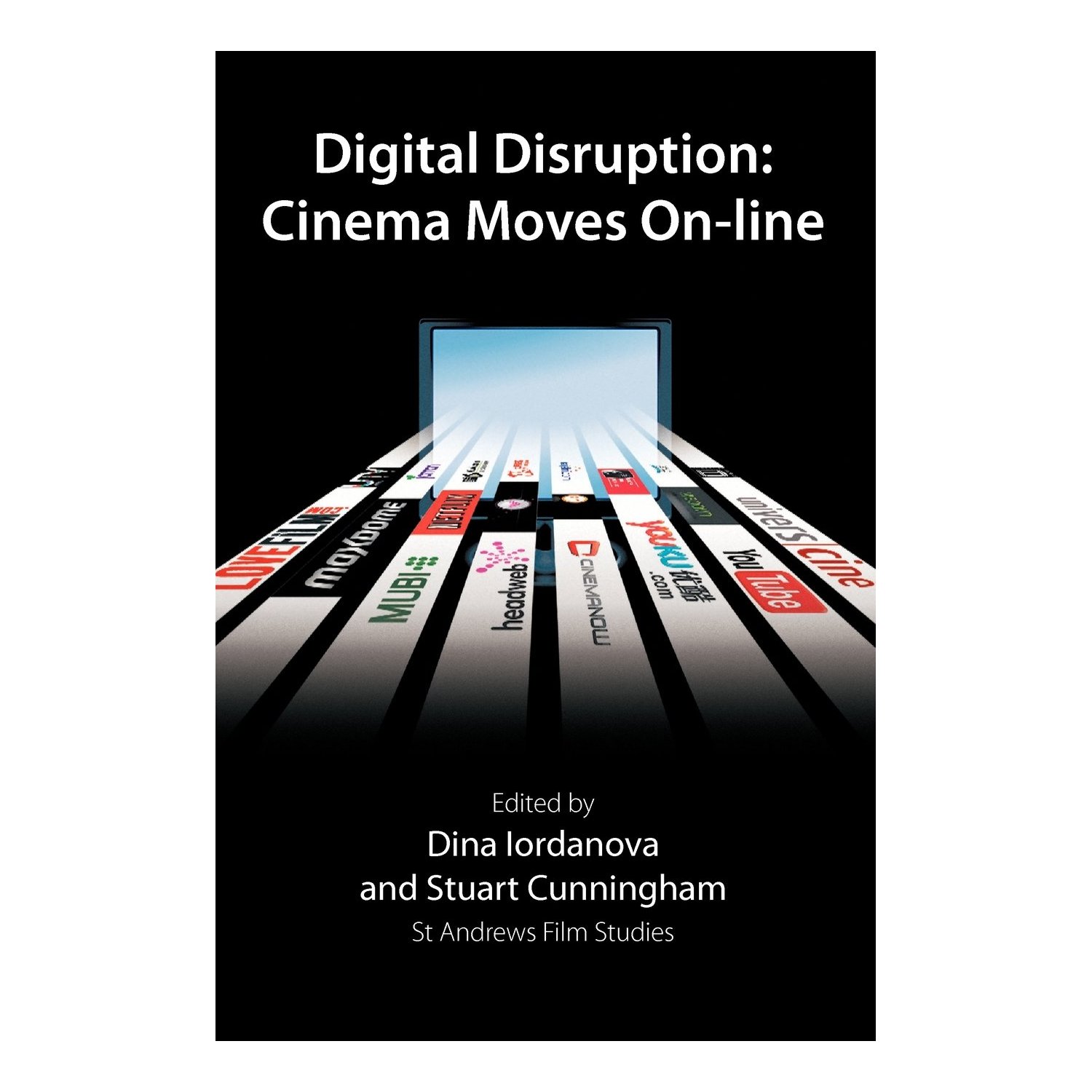Le Fonds international pour la diversité culturelle : un mécanisme de solidarité non-contraignant
Le Fonds international pour la diversité culturelle constitue le principal instrument en vue de favoriser, de manière concrète et pratique, l’essor des industries culturelles des pays en développement et la coopération dans ce domaine. Il s’agit d’un moyen institutionnel essentiel, au sens où les pays en développement ont souvent des politiques culturelles peu élaborées et leur mise en application demeure déficiente, faute de volonté politique, d’expertise et de moyens financiers. Toutefois, le fonctionnement efficace du Fonds repose sur la bonne foi et la loyauté des États plutôt que sur un engagement strict, dans la mesure où les Parties n’ont pas l’obligation de contribuer au Fonds, contrairement à d’autres instruments normatifs de l’UNESCO, comme les Conventions sur le patrimoine culturel matériel (1972) et immatériel (2003). Ainsi, les ressources du Fonds proviennent des contributions volontaires des Parties ainsi que de celles d’autres États, d’organisations régionales ou internationales, d’organismes publics ou privés ou de personnes privées. Celles-ci s’élèvent en janvier 2011 à plus de 3 millions et demi de dollars. Les contributions réunies du Canada-Québec, de la Finlande, du Norvège, de la France et de l’Espagne atteignent à elles seules près de 3 millions de dollars. Par ailleurs, le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Italie et l’Australie, parties prenantes à la Convention et pays fort développés sur le plan des industries culturelles, n’ont pas encore contribué aux ressources du Fonds.
Le caractère volontaire des contributions engendre une situation d’incertitude à propos du financement du Fonds et des difficultés d’élaboration d’une approche structurée, cohérente et globale en vue de soutenir les industries culturelles des pays en développement. D’un côté, même si les pays développés s’accordent sur la mise en place d’un fonds, satisfaisant ainsi les préoccupations culturelles des pays en développement, ils n’ont pas la volonté d’appliquer un mécanisme obligatoire concernant leurs contributions. D’un autre côté, le manque de caractère obligatoire peut être vu comme une occasion de développer de nouveaux mécanismes en matière d’aide financière, au-delà du simple financement et de proposer de nouvelles voies susceptibles d’assurer le fonctionnement du Fonds.
En deuxième lieu, il convient de souligner que la mise en œuvre de la Convention sera confrontée à la question des rapports du Fonds avec d’autres programmes de coopération culturelle, en particulier les programmes régionaux et étatiques en matière de coopération culturelle. Rappelons que l’Union européenne (UE), l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et le gouvernement français disposent de leurs propres mécanismes favorisant la coopération culturelle et le renforcement des industries culturelles des pays en développement. Ainsi, en matière d’audiovisuel, du côté français, on retrouve le Fonds Sud Cinéma et le Fonds d’investissement pour le cinéma d’Afrique francophone (FICAF). L’UE dispose de Media Mundus, un vaste programme de coopération internationale dans le secteur audiovisuel, doté de 15 millions d’euros pour la période 2011-2013, tandis que l’OIF a mis en place le Fonds francophone de production audiovisuelle du Sud, crée en 1988 et doté de 2,2 millions d’euros en 2008.
D’une part, la multiplicité des instances et des acteurs dans une autonomie relative croissante permet d’évoquer une véritable polycentricité des formes de coopération culturelle. D’autre part, cette dernière est effectivement soumise à des intérêts divergents et les acteurs ont des logiques d’action différentes quant aux orientations de leur politique de coopération. Ainsi, le texte de la Convention ne précise pas les rapports du Fonds avec les nombreux programmes impliqués dans la coopération culturelle et ne prévoit pas de les coordonner et de les mettre en réseau. En revanche, il est probable que d’un côté, le manque de coordination entraîne gaspillages et dysfonctionnements et de l’autre, dominent des logiques d’enchevêtrement et d’incohérence.