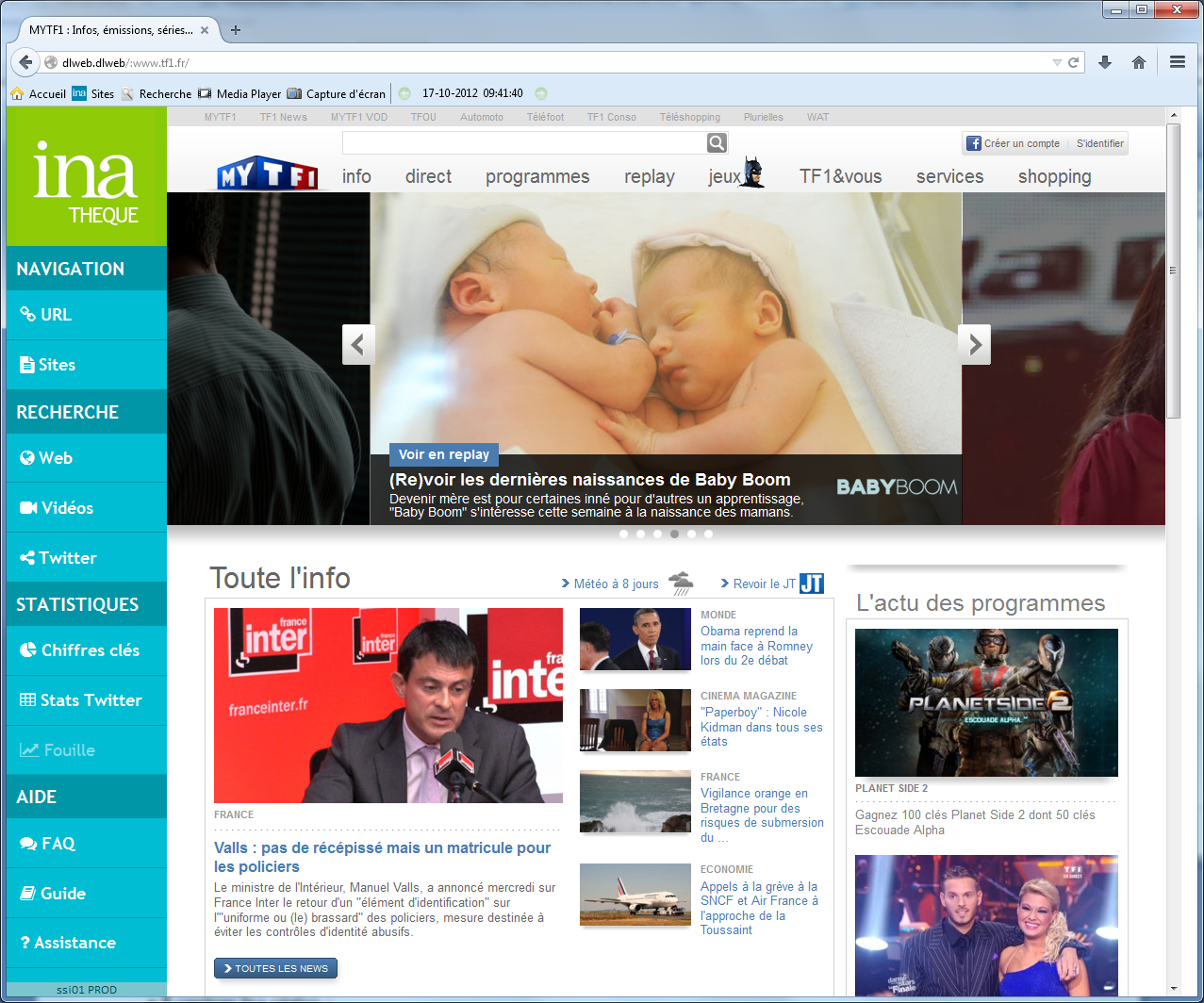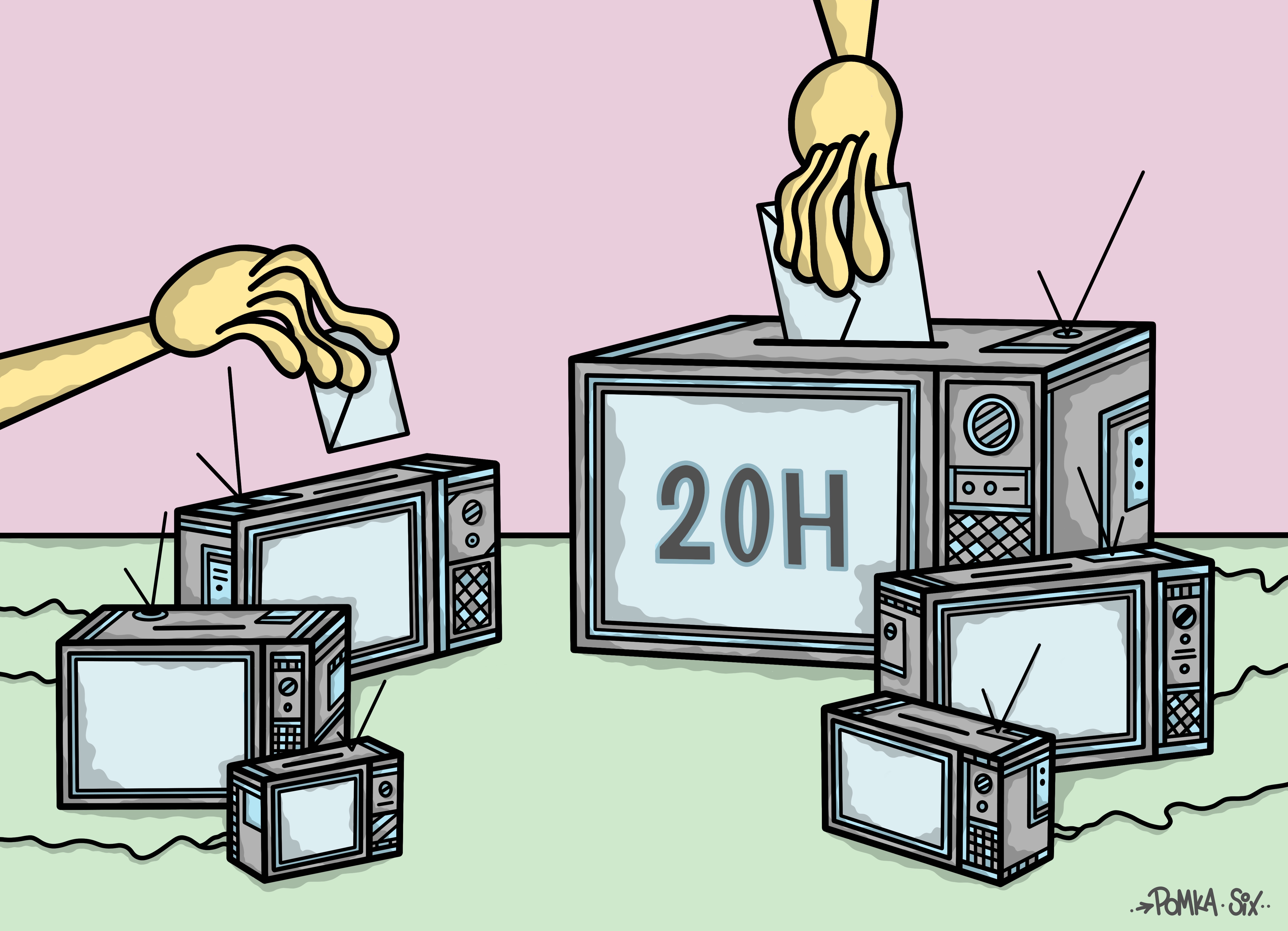Benjamin Ferron est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l’Université Paris-Est Créteil. Il est notamment co-auteur des Amateurs dans les médias (Presses des Mines, 2015) et travaille depuis une quinzaine d’années, selon différentes approches, sur les médias alternatifs. À l’occasion de l’édition 2017 des « Rencontres nationales des Médias Libres et du Journalisme de Résistance » , il nous éclaire sur ce phénomène.
Benjamin Ferron : Les membres de ce réseau privilégient ce terme plutôt que « média alternatif », par exemple, qui est déjà utilisé depuis la fin des années 1960. « Média libre » découle d’un long cycle historique.
À la fin du siècle, des militants issus des médias alternatifs estiment que la loi Trautmann sur l’audiovisuel va privilégier les « gros » médias – les chaînes de télévision publiques et commerciales – au détriment des petites chaînes locales ou associatives. Certains souhaitent alors que les mouvements sociaux et plus largement la société civile soient dotés de leurs propres organes médiatiques. C’est tout cela qui amène à la création de la première Coordination permanente des médias libres (CPML) en 1999.
Les « médias libres » de la CPML partagent aussi tous des valeurs de gauche…
Benjamin Ferron : Effectivement, aujourd’hui, ses membres se revendiquent de différentes sensibilités de gauche.
C’est une règle tacite : ils ne se laissent pas rejoindre sans résistance par des médias au positionnement opposé. En 2014, un média qui souhaitait intégrer le réseau a vu sa demande rejetée pour des soupçons de proximité avec l'extrême-droite.
Ils se revendiquent tous de gauche. C’est une règle tacite pour rejoindre le réseau
D’une manière générale, les « médias libres » privilégient leurs idéaux à la conquête de marchés publicitaires ou de records d'audimat. Leurs acteurs disposent davantage de capital culturel que de capital économique. Cela contribue à les positionner socialement du côté des professions intellectuelles intermédiaires : journalistes, enseignants, travailleurs sociaux, animateurs, salariés associatifs...
Outre leur positionnement politique à gauche, les « médias libres » partagent-ils d’autres traits communs ?
Benjamin Ferron : L’univers des « médias libres » est très composite sous tous les rapports, il tend à échapper à toute caractérisation définitive. Concrètement, au-delà des points communs déjà évoqués, les membres de la CPML sont aussi en désaccord sur beaucoup de points.
Il y a ce militant libertaire hors-norme, puriste, la soixantaine, qui est toujours là pour souligner, avec ironie, ce qu'il estime être la dérive des nombreux médias qui demandent et obtiennent des subventions. Une faible minorité vit même en partie de publicités commerciales – d’ailleurs, dans la loi, les radios associatives ont droit de financer jusqu’à 20 % de leur budget par ce biais. Loin du modèle « Pas de pub, pas de sub » prôné par d’autres titres, comme La Décroissance.
Les « médias libres » ne se professionnalisent pas tous non plus de la même façon, lorsque c’est le cas. Cette question reste un enjeu de différenciation majeur pour eux. Il y a les rédactions avec un rédacteur en chef et celles qui sont plus horizontales ; il y a les journalistes qui détiennent une carte de presse, comme chez Basta ou Reporterre, ceux qui se battent pour l’obtenir malgré leur statut associatif qui rend compliquée l'embauche de journalistes et ceux qui y ont droit et revendiquent de ne pas la demander.
Enfin, il n’y pas non plus de position unanime sur la déontologie professionnelle. Une «
charte mondiale des médias libres » a été signée au Forum mondial des médias libres, en 2015. Quelques membres de la CPML avaient été associés à sa rédaction. Et pourtant, en son sein, certains journalistes et militants ne s'y retrouvent pas lorsqu’on la leur présente.
Ces divisions forment-elles deux « camps » au sein de la CPML, les puristes militants d’un côté et ceux qui cherchent la professionnalisation de l’autre ?
Benjamin Ferron : Il y a selon moi environ 50 structures qui forment la CPML, des radios, des télévisions, des sites web, des titres de presse et des associations. Elles ne se scindent pas en deux blocs. Il y a effectivement plusieurs pôles, mais leur opposition n’est pas systématique : cela dépend des circonstances, des personnes engagées dans les échanges et des sujets évoqués. La « presse libre » est un idéal régulateur plus qu’un critère objectif. Chacun en interne développe sa propre définition.
La « presse libre » est un idéal régulateur plus qu’un critère objectif
Il y a un critère qui pourrait peut-être les réunir : globalement, les médias « mainstream » ne leur accordent pas beaucoup de légitimité…
Benjamin Ferron : Oui, les « médias libres » sont souvent délégitimés par les dominants – du moins lorsqu'ils en connaissent l'existence – mais, là encore, pas tous de la même façon.
Imaginez un large groupe qui serait le champ journalistique. Dans le sous-groupe des « médias libres », certains sont moins dominés que d’autres, car ils détiennent un peu plus de capitaux symboliques, techniques, etc. Cette « élite » des « médias libres » fait la jonction entre ce sous-groupe et des acteurs occupant des positions plus avantageuses dans le système médiatique. Par exemple,
des journalistes de Reporterre sont parfois invités sur des plateaux de télévision. C’est vrai qu’ils sont davantage présentés comme des « journalistes militants » que comme des confrères, mais ils peuvent par là transmettre leurs informations ou celles qui proviennent d’autres médias plus dominés, qui leur servent eux-mêmes de sources d'information.
La question de la légitimité se pose aussi pour le journaliste vis-à-vis de ses sources et des sujets qu’il observe. Quelle différence entre les journalistes des rédactions classiques et ceux des « médias libres » ?Benjamin Ferron : On est toujours légitime ou illégitime par rapport à quelqu’un d’autre. Les journalistes ont symboliquement un droit de regard sur les différents groupes sociaux. Ce droit leur est accordé, en général, par la carte de presse. Les journalistes des médias de la CPML profitent moins de ce droit. Par exemple, Acrimed serait bien en peine de décrocher une interview auprès des grands patrons de presse qu'elle critique et travaille principalement avec des sources secondaires, bien qu'ils aient des contacts à l'intérieur de certaines rédactions…
À l’inverse, ces journalistes ont une légitimité plus grande à enquêter sur certains milieux proches du leur ! Ils leur est plus facile de travailler sur ou avec d’autres groupes socialement dominés. Dans le secteur politique, ils traiteront des petits candidats, ils pourront pénétrer les luttes sociales du côté des travailleurs plutôt que des patrons ou encore discuter avec des associations peu institutionnelles plutôt que de très grandes ONG.
Vous proposez aussi dans vos travaux une analyse des trajectoires qui mènent les producteurs d’information aux « médias libres ». Quels sont les profils les plus récurrents ?
Benjamin Ferron : J’ai mené des séries d’entretiens qui me permettent d’identifier
différents profils types. Mais il est courant qu’un parcours individuel soit à mi-chemin entre plusieurs profils types.
Il y a les jeunes journalistes, diplômés des écoles idoines de plus en plus nombreuses, qui ne trouvent pas de place sur le marché du travail classique, qui est de plus en plus bouché. Pour eux, les « médias libres » peuvent fonctionner comme un sas d’accès aux rédactions classiques. Depuis le tournant néo-libéral des années 1980-90, les journalistes des médias dominants ont intégré comme des qualités professionnelles de nouvelles contraintes économiques : travailler vite, réaliser des formats accessibles… Aujourd’hui, certains sont désenchantés par leur rédactions « mainstream » et veulent revenir aux bases du métier.
En parallèle, il y a aussi d’autres catégories, issus d’univers militants ou associatifs (éducation aux médias, réseaux altermondialistes). Ils peuvent arriver aux « médias libres » par choix – certaines personnes investies dans des mouvements sociaux désirent que des médias existent pour couvrir ces luttes – ou par hasard – ils participent via le tissu associatif à un atelier ou bifurquent professionnellement et commencent comme petite main dans un « média libre » avant de devenir rédacteur ou reporter, par exemple.
Les « médias libres » donnent-ils vraiment plus la parole aux personnes défavorisées ? »
Benjamin Ferron : Il faut faire attention à la manière de présenter les choses : avoir un regard critique sur cette presse ne doit pas conduire à dire, par pur esprit de contradiction, le contraire de ce qu'elle fait ! S'il y a bien une presse qui donne la parole aux personnes défavorisées, c'est bien elle, tout de même.
Au début de la CPML, des médias issus des quartiers populaires ont rejoint le mouvement. Pour certains, comme
Médiacoop ou le
Ravi, la raison d’être est le
grassroot media, que les classes populaires dont on parle soient directement associées à la production de l’information. Dans les « médias libres », le coût d'entrée est plus faible que dans les médias traditionnels (en termes de critères sociaux, universitaires…).
Les journalistes des « médias libres » forment une intelligentsia précarisée
Mais de fait, on retrouve un peu la structure habituelle, avec des journalistes producteurs d’information et des citoyens consommateurs d’information, bien qu'il y ait une plus grande proximité entre les deux. Deux statuts relativement différents donc. Pour s’investir dans un média libre, il faut du temps libre et des compétences. Les journalistes des « médias libres » forment en quelque sorte une intelligentsia précarisée.
Que deviennent ces producteurs d’information quand ils quittent le monde des « médias libres » ?
Benjamin Ferron : J’ai moins étudié cette question. Mais j’ai remarqué que d’anciens participants aux « médias libres » irriguent, plus tard, les médias professionnels. Ceux-là auront alors un sens de l’honneur journalistique plus aigu. C’est bénéfique.
Tous ces éléments témoignent d’une grande perméabilité avec les médias dominants...
Benjamin Ferron : La CPML et les « médias libres » ont intérêt à afficher leur pleine extériorité vis-à-vis du champ journalistique « mainstream » et à inventer un capital spécifique. Or, plus je travaille sur la question, plus j’observe que ce n’est pas si évident.
Que pouvez-vous nous dire de l’audience des « médias libres » ?
Benjamin Ferron : À ce jour, il n’existe pas d'étude d’audience des médias qui composent la CPML. J’ai personnellement recueilli les déclarations de 22 représentants de «
médias libres », constaté l’accroissement de la diffusion de certains titres (comme
Fakir, aujourd’hui distribué en kiosque) et commencé l’analyse des réseaux sociaux de ces structures, tout en sachant que leurs comptes Facebook, Twitter ou Youtube ne représentent pas la réalité de leurs audiences. En tout état de cause, elles sont très diverses. Les cinq « superstars » sur les réseaux sociaux (comme
Fakir,
Politis ou
Basta) dépassent les 100 000
followers, alors que la majorité des titres en ont moins de 5 000. Sur le web, en termes de trafic, on peut signaler le cas exceptionnel de
Reporterre, dont un journaliste m’a affirmé lors d’un entretien que le site recevait début 2016 25 000 visiteurs uniques par jour, en moyenne. En presse imprimée également, on retrouve aussi bien
Politis qui vend 15 000 exemplaires par numéro et
Fakir qui en tire entre 10 000 et 20 000, qu’une myriade de petits journaux tirant à 1 500 exemplaires.
Mais attention, je n’ai pas encore terminé mes calculs. Pour l’instant, je peux estimer que ces médias cumulent des audiences qui ne sont pas aussi faibles qu’on pourrait le croire, elles ne sont pas négligeables. En revanche, on peut les qualifier de « marché » de marge, ou de niche.
Les audiences cumulées des « médias libres » ne sont pas négligeables. Mais c’est un marché de niche
Tout porte à croire que les abonnés ou lecteurs réguliers sont en majorité issus des classes moyennes, disposent a priori d’un fort capital culturel (bien qu’ils aient parfois des conditions de vie précaires) et sont très politisés. Outre le besoin d’information des lecteurs, les usages des « médias libres »répondent aussi à d’autres logiques : distinction sociale dans le cercle familial, professionnel ou militant, enjeux éthiques, identitaires… Mon hypothèse, c’est que l’acte d’achat ou de lecture de ces médias ressemble à ce que des confrères ont étudié dans le cas de la « consommation engagée » (produits bio, éthiques, etc.). Les structures en jouent : dans les courriers de fidélisation par exemple, on retrouve des slogans comme « Je finance la presse libre ! ». D’ailleurs, aux dernières rencontres de la CPML, l’idée a émergé de proposer des « paniers de la presse libre », comme un panier de légumes locaux et de saison !
Benjamin Ferron : Vous voulez dire, à part que nous ne sommes pas en guerre ? [Rires] Oui, il y a des spécificités françaises. Je vais dire une généralité, mais quoi qu'on en dise, nous restons dans un État de droit qui garantit, au moins formellement, la liberté d’expression. En comparaison avec d'autres pays, il y est en principe facile de se lancer dans une initiative de presse contestataire, voire même anarchiste.
Au sein de la CPML, une frange revendique la création d'un « tiers secteur médiatique ». L’objectif de ces militants, c’est d’institutionnaliser les « médias libres », faire en sorte qu’ils accèdent à un statut légal et à des subventions. Et ils souhaitent infléchir les lois pour qu’elles soient plus favorables à cette nouvelle catégorie de structures. Il faut dire qu’actuellement l’État français joue déjà un rôle important dans la structuration de la presse. Depuis les ordonnances du Conseil national de la résistance, et malgré le tournant néo-libéral survenu plus tard, l'impact du droit public reste positif sur les médias qui se revendiquent « libres ». En France, via les aides directes ou indirectes à la presse par exemple, l’action de l’État est censée garantir un certain pluralisme.
Cela étant, les cas de répression des « médias libres » sont fréquents. Souvent sous de faux prétextes, comme des procès en diffamation.