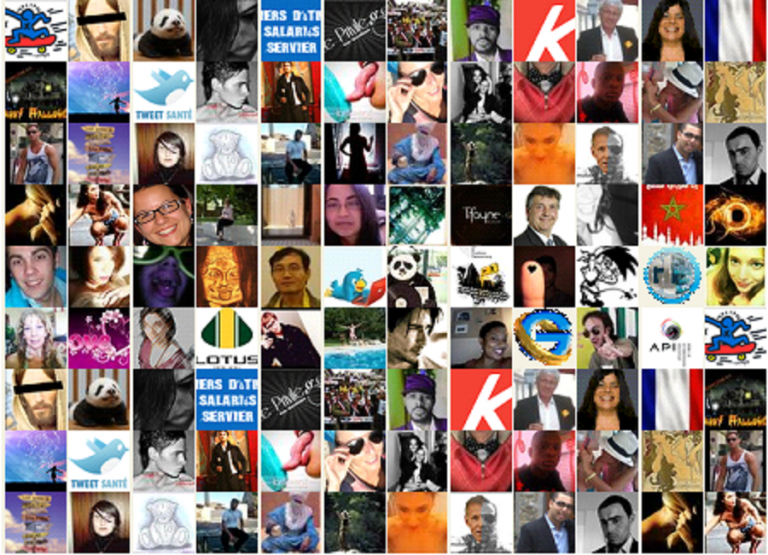Lors d’un cours dans une école de journalisme, un étudiant a demandé à Nabil Wakim, journaliste au Monde et auteur d’un livre sur l’apprentissage de la langue arabe, comment il faisait pour se protéger. « J’ai désinstallé Twitter de mon téléphone », a-t-il répondu, avant de détailler les risques que faisait peser le réseau social sur le travail du journaliste. Nabil Wakim n’est pas technophobe. Avant de couvrir le secteur de l’énergie, il a été directeur de l’innovation au Monde.
J’ai repensé à cet échange quelques jours plus tard, quand Joe Biden a été élu à la Maison Blanche. Sur CBS News, le journaliste politique Ed O’Keefe donnait une explication rarement entendue au succès de la campagne de Joe Biden : un point crucial de la stratégie de l’équipe du candidat démocrate avait consisté à « éteindre Twitter ». Un président élu quatre ans plus tôt grâce à son compte Twitter se faisait donc remplacer par un candidat dont les équipes s’étaient retenues de trop y prêter attention. Grâce à quoi, « nous savions que le pays était dans un autre espace que ce que les réseaux sociaux suggéraient », expliquait Ed O’Keffe, qui y est lui-même très présent. Se passer de Twitter, ou du moins en limiter l’usage, pourrait donc être une force.
Deuxième écran
Nabil Wakim s’est fixé d’autres règles : quand il se connecte depuis son ordinateur, il s’interdit de s’exprimer sur les sujets dont il n’est pas spécialiste. Il s’est fait des listes d’experts sur les sujets qu’il suit, s’abonne aux newsletters que génère Nuzzel, une pratique partagée par de nombreux journalistes qui veulent savoir ce qui se dit sur Twitter sans s’y salir. Toujours au Monde, Damien Leloup, journaliste créateur de la rubrique Pixels, m’a expliqué qu’il avait désactivé les notifications de TweetDeck pour ignorer les réactions et ne poste quasiment plus rien.
Un autre pionnier m’a confié qu’il ne répondait plus à personne en public sur Twitter. Emma Defaud, ex-rédactrice en chef de Lexpress.fr et à présent rédactrice en chef de Elle.fr, a déplacé l’appli Twitter sur le deuxième écran de son smartphone pour se retenir de l’utiliser mécaniquement. Luc de Barochez, ancien directeur du Figaro.fr et aujourd’hui au Point, essaie de suivre le moins de journalistes possibles pour ne pas tourner en rond dans une chambre d’écho. Plusieurs autres m’ont dit détruire leurs anciens tweets régulièrement. À titre personnel, j’ai aussi désinstallé Twitter de mon téléphone et le configure en mode chronologique pour ne pas voir en premier les tweets les plus partagés.
Un monde à notre image
Quatorze ans après la création de Twitter, ce ne sont plus les contraintes de la limite d’espace (140 caractères, puis 280) qui font débat chez les journalistes, mais toutes sortes d’autres effets pervers, à commencer par le risque de s’exposer à une représentation tordue du monde. Sur Twitter, les journalistes rencontrent surtout beaucoup d’avis de... journalistes. Et comme dit l’adage, citer un journaliste, pour un journaliste, c’est comme danser un slow avec sa sœur, c’est facile mais ça n’a aucun intérêt.
Le risque est bien sûr de confondre Twitter avec la société tout entière, comme ce rédacteur en chef répondant « Je ne vois rien sur Twitter » à quelqu’un qui l’alerte sur un mouvement social, d’oublier que le réseau social nous renvoie un monde à notre image (et à la sienne), écho des préoccupations des gens que l’on a choisi d’y suivre. « L’affaire Mila, par exemple, était un truc vécu par les gamins sur Snap. Twitter n’était pas le bon endroit pour apprécier ce que ça a créé chez les jeunes », se souvient Grégoire Lemarchand, rédacteur en chef investigation numérique à l’AFP.
« Ce n’est pas parce que c’est en “trend” que c’est important »
Le risque est aussi de ne plus savoir ce qui mérite l’attention, quand on entend « old » parce qu’une information a plus de trois heures, en oubliant que la plupart des gens n’en ont jamais entendu parler. Ou à l’inverse de se laisser absorber par un sujet parce que le tout-Twitter s’est indigné de provocations auxquelles personnes n’aurait dû faire attention. « Les techniques d’astroturfing [simuler un mouvement citoyen à partir de plusieurs comptes, NDLR] permettent de créer une tendance et on tombe dans le piège. » Entendu : « Ce n’est pas parce que c’est en “trend” que c’est important... Un journaliste regarde les “trending topics”, fait un article sur la polémique, ça devient un sujet chez Pascal Praud, puis une question aux matinales des radios le lendemain… »
Autre biais, la façon dont Twitter peut affecter le travail du journaliste sensible à ce qui se dira de lui. Et cela sans même parler du harcèlement. Peser chaque mot qu’on écrit, chaque mot qu’on dit en se demandant comment telle ou telle phrase extraite de son travail peut contribuer à se faire démolir sur les réseaux sociaux, c’est déjà signe que quelque chose ne va pas. « Dix ou quinze mentions et tu ne passes pas une bonne soirée », résume Nabil Wakim. Rares sont les journalistes à l’épiderme suffisamment épais pour ignorer sereinement les salves de « encore un journaliste qui comprend rien… » L’envie de plaire perturbe aussi la façon de travailler. Xavier de La Porte l’a expliqué dans son podcast Le Code a changé. « Les gens qui gagnent des followers sont des gens qui au fond disent toujours un peu la même chose. […] Dès qu’on sort de notre cadre, notre voix porte moins, on recueille un nombre assez faiblard de likes et retweets par rapport aux autres posts ; ça incite à toujours aborder les sujets sur lesquels notre voix porte et de la façon dont on sait qu’on est attendu, pour recevoir une sorte d’assentiment de la communauté. »
« Gaspillage d’énergie mentale »
C’est aussi cette tentation de donner son avis sur tout, que cela se passe sur un plateau télé ou sur les réseaux sociaux, qui contribue à déprécier l’image de ce métier. Entendu encore : « Si tu t’exprimes sur des sujets sur lesquels tu n’as pas travaillé, tu ne fais pas ton job… » Et puis passer son temps à s’expliquer, à défendre des collègues, à s’indigner, c’est chronophage.
Ce qu’aurait aimé Nabil Wakim, c’est que toute la rédaction du Monde raccroche Twitter en même temps ! Avec dans ses rêves une tribune pour expliquer que les effets pervers du réseau social l’emportent sur ses bénéfices pour le journalisme. Dans le portrait que lui a consacré Libération pour son départ de la direction du Monde, Luc Bronner explique, lui aussi, que dans un monde idéal, il aimerait qu’aucun journaliste de la rédaction ne soit sur Twitter.
C’est ce qu’a fait sans bruit la chroniqueuse judiciaire Pascale Robert-Diard. Plus souvent, ceux qui s’en vont sont plus bruyants. Un peu comme des alcooliques qui crient très fort au comptoir que celle-là, c’est la dernière. En juillet 2018, Maggie Haberman, la journaliste du New York Times qui couvrait Donald Trump depuis trois ans a expliqué qu’après « presque neuf ans et 187 000 tweets », elle ne tweeterait plus. Elle en était arrivée au point — que connaissent beaucoup de journalistes — où l’on commence à écrire un tweet, on se demande comment il va être reçu, on l’efface, où les critiques pèsent plus qu’on ne le voudrait… La voyant stressée, une amie lui avait demandé ce qui pourrait lui arriver de pire en quittant Twitter. Rien, s’était-elle dit, avant de « prendre ses distances ». Elle a raconté tout cela dans une tribune publiée par son journal : Twitter n’était plus un lieu où elle pouvait apprendre des choses, glaner des informations. Les échanges y étaient pollués par « la méchanceté », une « rage partisane toxique », la « malhonnêteté intellectuelle ». En bref, « un énorme et inutile gaspillage de temps et d’énergie mentale ».
Messages personnels
Jack Dorsey, le patron de Twitter, avait répondu par un thread à chacun de ses arguments, concluant que l’impossibilité d’avoir une conversation nuancée sur le journalisme sur Twitter était « ce que nous aimerions le plus réparer ». Il n’avait pas fini ses travaux de ravalement que la journaliste vedette du New York Times avait déjà repris son rythme de tweets frénétique (elle a écrit 62 000 tweets depuis qu’elle a pris ses distances, soit quelque 70 tweets par jour). Les informations à ne pas rater. Des gens à contacter. Un livre dont il faut assurer la promotion. Il y a toujours une raison impérieuse de revenir sur Twitter.
L’idée de claquer complètement la porte ne se pose plus. Mais beaucoup font leur cuisine, se fixent des règles pour en limiter les effets pervers, bricolent des antidotes. Un autre journaliste habituellement à l’avant-garde de tous les nouveaux outils (et qui ne veut pas être cité justement pour que son nom ne soit pas associé à une discussion sur Twitter), a décidé de ne plus répondre sur le réseau social. Il limite les conversations en public pour éviter les interactions, ne répond plus qu’aux messages personnels en DM. « Si je vois des erreurs, je le dis en privé. » Il n’a pas envie qu’une critique devienne un cri de ralliement. Les jeunes journalistes ont plus de chances d’avoir été exposés aux façons de limiter le cyberharcèlement (ne pas citer un tweet qu’on commente, enlever le nom de la personne…)
« La mémoire d’Internet »
Lui aussi s’est auto-ralenti en supprimant l’appli de son téléphone et il n’y est plus connecté de son ordinateur par défaut. Avoir à taper son mot de passe, ça empêche d’y aller trop facilement. Il utilise Nuzzel pour faire remonter les liens les plus tweetés par les gens qu’il suit. Il a l’impression d’avoir fait baisser le volume sonore des polémiques inutiles. « Depuis que je n’ai plus ce réflexe de regarder ce que les gens tweetent quand je m’ennuie, ça relativise certaines choses. J’arrive à passer au-dessus de vagues de polémiques sans intérêt sans en avoir jamais entendu parler... » Il reconnaît n’avoir cette possibilité que depuis qu’il ne travaille plus sur l’actu chaude. « La première fois qu’un collègue m’a oldé [fait remarquer qu’une information était connue depuis longtemps, disons deux heures, NDLR], ça m’a ennuyé mais ça n’a pas duré longtemps. Je suis content de ne plus être shooté à ça. Ne pas savoir qui est mort en premier, ne pas être le premier à en dire un truc drôle, ça ne me manque pas. » Le bruit ambiant n’est pas seulement celui des polémiques. « Quelqu’un meurt et tout le monde doit donner son avis sur John Le Carré ou sur Anne Sylvestre ? », s’étonne aussi Philippe Corbé, nouveau chef du service politique de BFM TV.
Il y a deux ans, alors qu’il était correspondant aux États-Unis de RTL, il a supprimé tous les comptes français qu’il suivait. « Avec le décalage horaire, j’ouvrais Twitter et je me prenais la polémique du jour, des gens qui s’insultaient entre eux. Ça ne m’apportait rien. » Lui aussi a tenté de se fixer ses propres règles : ne rien écrire qu’il ne pourrait dire à l’antenne, n’utiliser son fil Twitter que pour donner des éléments de contexte ou mettre en valeur ce qu’il trouve intéressant « plutôt que de pinailler ou d’être en permanence indigné » ; se retenir de commenter ce que disent d’autres journalistes ou même de plaisanter avec eux (pas de blagues sur l’A340 de la République à vendre à 80 000 euros qu’on devrait acheter pour se rappeler des souvenirs de voyages…). Il utilise le service TweetDelete plusieurs fois par semaine. « Tous les trucs vieux peuvent être retournés contre moi plusieurs mois plus tard. » « J’ai tellement peur que de l’humour ne soit pas compris ou que mes tweets soient ressortis sur un autre sujet plusieurs mois plus tard, je commence à me méfier de la mémoire d’Internet », m’a expliqué une autre journaliste qui utilise TweetDelete.
Chartes de bonnes pratiques
À l’échelle des rédactions aussi, certains freinent. À l’AFP, Grégoire Lemarchand s’aperçoit qu’après les années — disons 2012 à 2016 — passées « à convaincre tout le monde d’aller sur Twitter pour faire briller l’agence, on a un ralentissement de l’activité, disons plus de prudence ». Il met cela sur le compte d’une meilleure compréhension des risques que des tweets peuvent faire peser sur la rédaction, sur son image, sur le journalisme. Dans une atmosphère qu’il juge plus toxique et abrasive qu’avant, un guide d’utilisation des réseaux sociaux a été intégré au manuel de l’agencier. On y conseille désormais de se retenir de donner son avis, de commenter, de ne pas publier d’informations que l’AFP n’a pas encore données. À leur tour, d’autres rédactions ont élaboré des chartes de bonnes pratiques.
Moins d’informations qui sautent aux yeux, mais moins aussi de témoins professionnels et d’effets de bulles. « C’est un peu comme si je devais retrouver toute seule les chemins pour m’informer », m’a expliqué une autre journaliste qui a désinstallé l’appli. Elle n’a tenu qu’une poignée de semaines avant de la réinstaller sur son téléphone. C’est un arbitrage difficile à faire : s’extraire complètement de ce qui se dit, c’est compliqué, presque une faute journalistique. Voire dangereux dans un marché de l’emploi fragile (entendu d’un directeur de rédaction : « Un journaliste qui me dirait qu’il a fait le choix de ne jamais aller sur Twitter, j’aurais du mal. »)
Mais ce qui est frappant à écouter ces nouveaux bricolages, c’est qu’entre ceux qui ne veulent plus utiliser Twitter qu’en porte-voix (pour faire la promotion de leurs articles, médias, livres), ou ceux qui cherchent les façons d’obtenir les résumés de ce qui se dit sans avoir à y mettre les pieds, c’est un peu comme si tous s’accordaient à chercher à éviter ce que le réseau social avait mis le plus en avant : la conversation.