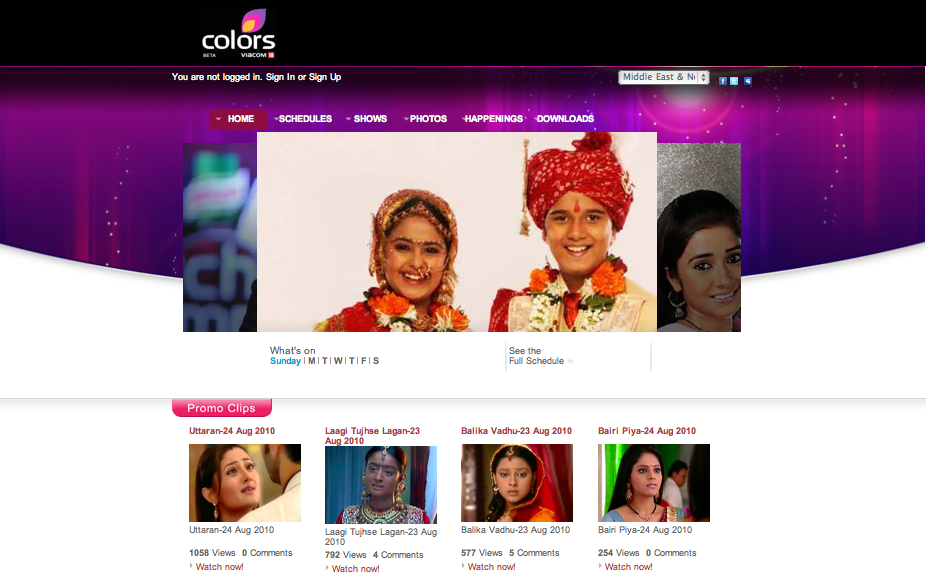Dans votre rapport, vous décrivez la mort d’un ancien modèle économique, la transformation complète du métier de journaliste, la concurrence d’acteurs qui ne font pas partie du monde des médias, donc le numérique pour la presse c’est une évolution, ou une révolution ?
Jean-Marie Charon : Je pense que le bon terme c’est une « réinvention ». Qu’il s’agisse effectivement du modèle économique, mais aussi qu’il s’agisse du rapport à son public, on a affaire à des données qui sont complètement nouvelles.
En termes de modèle économique c’est vrai que ce n’est pas la première fois que la presse est confrontée à l’arrivée d’un nouveau média, mais là il s’agit plus que d’un nouveau média, il s’agit à la fois d’un système de communication et d’activités diverses qui très tôt a eu un impact direct sur son modèle, enfin sur ses ressources.
En l’occurrence ça a été dans une première étape la disparition des petites annonces, aux États-Unis on peut dire qu’à la fin des années 1990 c’est déjà le cas, avec des sites comme Craigslist ou Monster qui vont complètement aspirer les petites annonces, même si la presse va réagir, mais quand elle créera ses propres systèmes de petites annonces, les tarifs seront tellement bas que les ressources sont devenues marginales, alors que c’était aux États-Unis une source de revenus très importante. En France peut-être un peu moins, mais je pense que pour un titre comme Le Figaro, c’est effectivement quelque chose de très significatif, et aussi pour la presse régionale. Ça c’est le premier aspect. Le deuxième aspect qui va intervenir plus progressivement, mais qui est vraiment très important c’est le recul des recettes liées aux lecteurs, dans la mesure ou l’Internet amène le modèle de la gratuité, et notamment - et c’est pour ça qu’on dit « réinvention », parce qu’il va irrémédiablement opérer une distinction dans l’information, entre celle qu’on va qualifier d’un peu banale et purement factuelle pour laquelle le public va considérer qu’elle a vocation à être gratuite, et c’est uniquement une information à valeur ajoutée qui pourra encore être rémunérée par le public, soit sur le papier, soit sur le numérique, mais ça veut dire un investissement éditorial. Là aussi, ça veut dire réinventer des types de traitements de l’information qui soient spécifiques parce que jusqu’à présent, il y avait une espèce d’interrelation normale entre l’information factuelle et cette information à valeur ajoutée.
Le troisième élément qui évidemment intervient, c’est la baisse de la publicité commerciale, en relation avec le fait que l’Internet amène de nouveaux intervenants qui sont
les intermédiaires qu’on a qualifiés plutôt « d’infomédiaires ». Ces intermédiaires ont la capacité de réaliser des audiences beaucoup plus importantes que celles des médias eux-mêmes, donc de les disqualifier en termes de supports publicitaires prioritaires : quand vous êtes comme aujourd’hui en France avec
un Google qui fait trois fois plus d’audience que le meilleur titre de presse écrite, évidemment le titre de presse écrite ne peut espérer que d’avoir un peu des miettes. Surtout ces infomédiaires ont d’emblée, et ça fait partie de leur métier et de leur compétences de base, une capacité à traiter les données concernant les usages, ce qu’on appelle maintenant les « datas », qui permettent du coup de s’adresser aux annonceurs, non pas pour vendre de l’espace en général, mais pour vendre des itinéraires qualifiés, donc là aussi, comme les médias ont mis beaucoup de temps à apprendre et à comprendre l’enjeu de ces données, et bien ils ont pris un temps de retard et ce n’est pas sûr qu’ils le rattrapent dans la mesure où ces grands opérateurs que sont Google ou Facebook, Twitter, etc. ont d’énormes moyens de développement. Dans une entreprise de presse on a quelques développeurs alors que chez Google c’est quelques milliers de développeurs.
Donc il y a un problème de taille.
Jean-Marie Charon : De taille oui tout à fait.
Vous avez rencontré donc beaucoup d’intervenants pour rédiger ce rapport, est-ce que les gens que vous avez rencontrés avaient une vue globale des bouleversements à l’œuvre dans le paysage de la presse mondiale?
Jean-Marie Charon :
On entend encore dire que la presse populaire britannique ou allemande se porte plutôt bien alors qu’en réalité elle est en pleine déconfiture
Alors ça fait partie des évolutions, qu’on peut remarquer par rapport aux périodes précédentes, notamment pour la presse écrite, c’est que l’Internet, enfin le numérique en général, incite davantage la presse à une activité de veille et notamment de veille internationale, ce qui n’était pas son point fort. C’est-à-dire que périodiquement, il pouvait arriver qu’on organise des missions pour regarder un peu ce qui se passait à l’étranger, mais il y avait une assez mauvaise connaissance de ce qu’était finalement le paysage de la presse dans le monde. Souvent, les gens découvraient avec beaucoup de retard des évolutions du secteur de la presse. Encore aujourd’hui d’ailleurs, puisqu’on entend encore dire que la presse populaire britannique ou allemande se porte plutôt bien alors qu’en réalité elle est en pleine déconfiture. En revanche, c’est vrai qu’aujourd’hui, parmi les évolutions significatives il y a certainement la prise de conscience de la nécessité d’être davantage dans une attitude de veille, même si, et ça c’est vraiment une caractéristique de la presse française, celle-ci a tendance à régler ces questions plutôt individuellement, alors que souvent à l’étranger, je pense notamment en Allemagne, c’est souvent la fonction des organismes syndicaux professionnels
Le deuxième élément qui me frappe, c’est qu’aujourd’hui , enfin, j’espère que je ne me trompe pas trop dans le diagnostic, on est au moment où après avoir eu le sentiment qu’ ils étaient en train de vivre une énorme crise, sachant que la notion de crise dans la presse française est quelque chose de récurrent, sans trop savoir s’il y aurait des retours en arrière ou si les choses allaient se stabiliser à un moment donné, il semble que chez beaucoup d’acteurs aujourd’hui, il y a le sentiment qu’il y a vraiment un enjeu de recherche, de développement, d’expérimentation, parce qu’aussi bien sur le numérique que sur l’imprimé, on va devoir complètement repenser les choses, qu’il s’agisse des contenus, des structures qu’on doit mettre en place en terme éditorial et en termes techniques, mais aussi à propos en de l’organisation plus générale.
Justement, ce qui frappe à la lecture de votre rapport c’est l’espèce de foisonnement et de bouillonnement inventif de la presse qui est à rebours du poncif qui dit « la presse est en crise, la presse va mal ».
Jean-Marie Charon : Ça dépend aussi de comment on met le projecteur.
Réfléchir pour ne pas mourir ou réfléchir pour se réinventer ?
Jean-Marie Charon : Ça dépend. Il y a toujours eu me semble-t-il dans la presse écrite, comme dans beaucoup de médias une certaine hétérogénéité entre des secteurs qui étaient beaucoup plus actifs, beaucoup plus inventifs, et d’autres qui au contraire avaient davantage d’habitudes de reproduction.
Tant qu’on était dans l’univers de l’imprimé, en France en tout cas, ce qui était particulièrement frappant c’était le dynamisme et la créativité qui s’exprimaient dans la presse magazine. C’est vrai qu’aujourd’hui c’est un secteur qui est tellement bouleversé et pris de cours parce que la presse magazine n’imaginait pas qu’elle serait à ce point impactée par le numérique, est qu’on est donc de nouveau devant cette hétérogénéité. Alors on peut prend une focale qui serait de dire « regardons tout ce qui va mal », et là il y aurait aussi beaucoup à écrire, mais précisément l’enjeu de ce rapport, c’est d’éclairer la ministre et ses collaborateurs, sur le fait que justement cette espèce de tonalité qui souvent leur est renvoyée, parce qu’on est dans des logiques de lobbying, de négociations autour des aides à la presse pouvait cacher des éléments de dynamique importants, sachant que pour l’État, il est plus intéressant, et aussi plus urgent et plus significatif, d’identifier là où il faut agir pour accompagner ces évolutions, plutôt que d’être simplement dans une logique où on essaye de retarder un peu des échéances.
Est-ce qu’il y a une spécificité de la presse française par rapport à la presse internationale ?
Jean-Marie Charon : Là, une fois encore, on ne peut pas parler de presse globalement : c'est-à-dire que la presse quotidienne est le segment qui a toujours davantage retenu l’attention parce qu’elle est rattachée à la notion de pluralisme, à la notion de démocratie etc. alors que pour la presse magazine on en retient plutôt la dimension divertissante, ce qui n’est quand même pas tout à fait juste, parce qu’il y a un très grand spectre de presse magazine.
C’est vrai que la presse quotidienne, depuis très longtemps est confrontée à des difficultés. Je crois que c’est Patrick Eveno qui dit, et il a tout à fait raison, que les problèmes de la presse quotidienne en France paradoxalement ça remonte à la Première Guerre mondiale, alors qu’elle a été, une pionnière, en termes d’invention de la presse populaire parfois avec des résultats plus importants que ce qu’on pouvait trouver dans la presse anglo-saxonne. Mais c’est vrai qu’après la Première Guerre mondiale, on commence à avoir une espèce d’essoufflement de cette dynamique, de cette inventivité qui s’étaient exprimées dans la presse quotidienne.
En presse quotidienne, on est face à une activité qui attirait peu les capitaux
Et on a là une spécificité française, peut-être aussi parce que le cadre institutionnel était assez contraignant, notamment avec les ordonnances de 1944 qui ne facilitaient pas l’arrivée de grands investisseurs, mais c’est vrai que du coup on a une presse qui est très capitalistique dans la presse magazine, avec des grands groupes comme Prisma Média ou Mondadori et puis Lagardère, et d’autres aussi, qui sont moins importants mais qui sont aussi très significatifs, alors qu’en presse quotidienne, on est face à une activité qui finalement attirait peu les capitaux. Lorsque les capitaux intervenaient, je pense évidemment à des groupes comme Dassault, et maintenant avec une autre génération avec Xavier Niel Pierre Bergé, Matthieu Pigasse, ou Patrick Drahi, on avait plutôt l’impression que ces gens-là étaient présents pour des raisons d’influence et moins pour vraiment valoriser l’activité de presse quotidienne, ce qui a laissé penser, ce qui est une particularité française, que la presse quotidienne était un secteur qui n’avait pas vocation à être rentable.
Là encore, on voit bien ce qu’on évoquait tout à l’heure, cette espèce de méconnaissance de ce qui existait à l’étranger, parce qu’il suffisait de franchir les Pyrénées, ou bien sûr le Rhin ou la Manche, pour trouver des presses qui étaient extrêmement rentables tout en étant quotidiennes. Et aux États-Unis c’est pareil, c’est un secteur très capitalistique et très rentable. Donc là il y a une spécificité de la presse française qui a conduit à ce que certains talents, à la fois en termes de créativité et en termes journalistiques, parfois même en termes entrepreneuriaux se tournent davantage vers des secteurs qui étaient plus dynamiques, la presse magazine en l’occurrence, et se détournent un peu de la presse quotidienne.
Vous décrivez très bien le déséquilibre structurel entre les grandes entreprises internationales comme Google et Facebook et les organes de presse français et européens, plus fragmentés. Est-ce que vous pensez que la presse européenne, parce que là, on est au-delà du cadre national de la presse française, est capable de s’unir pour créer des projets et pour affronter cette concurrence ?
Jean-Marie Charon : Là, disons qu’on est uniquement dans des hypothèses de travail. Parce qu’il n’y a pas du tout de tradition, d’entente…même pas d’entente, mais de réflexion commune, sur ce que pourrait être un cadre juridique qui serait plus favorable ou qui obligerait un certain nombre d’opérateurs, notamment Google, à accepter des règles de la concurrence qu’il n’applique pas. Vous avez aujourd’hui un embryon, avec ce qu’on appelle « L’Open Internet Project » qui est un regroupement dans lequel vous trouvez Lagardère, mais aussi Springer, et aussi CCM Benchmark, donc là aussi des nouveaux acteurs du côté éditorial, et leur cible, ce n’est pas tellement le gouvernement français, mais l’Europe, sur le thème qu’il faut imposer à ces groupes un certain nombre de règles, et notamment des règles de concurrence.
Dans le cas de Google, c’est quelque chose qu’on ne souligne pas suffisamment, le moteur de recherche à la fois est dans une position qui n’est pas générale, ni mondiale, mais en France, il est dans une position très dominante,
et il utilise cette position dominante pour privilégier les contenus qui concernent ses propres activités. Ce qui fait qu’à un certain moment, si on prend l’exemple d’une des activités de CCM Benchmark de conseil et de vote sur des questions de restauration, ce service-là fonctionnait extrêmement bien. Un beau jour, Google est intervenu dans ce domaine, et systématiquement, alors que ce n’était pas du tout la réalité à l’époque, le moteur de recherche faisait remonter son propre service dans le référencement, ce qui a permis effectivement à Google de surclasser tous les concurrents. Et ça c’est une pratique qui est souvent pointée du doigt et qui fait partie de ces règles de la concurrence.
Les éditeurs européens n’ont pas l'habitude de s’entendre entre eux
Mais pour revenir au cœur de la question, c’est vrai que les éditeurs européens n’ont pas cette habitude de s’entendre entre eux, alors qu’on pourrait dire qu’en matière de presse magazine il y avait quand même une dimension européenne qui passait par le fait qu’on avait quand même beaucoup des groupes européens, comme Bertelsmann, comme Mondadori, comme Lagardère, mais ceux-ci s’accordaient rarement sur des stratégies communes. C’est vrai que là il y a un enjeu, et je pense que certains commencent à se rendre compte que cette démarche est un peu incontournable, peut-être que c’est la réaction de Google à l’égard d’un certain nombre de pressions qui commencent à être européennes, le fait que par exemple la France et l’Allemagne commencent à être de concert sur les conditions à faire à Google. On voit là qu’ils commencent à avancer une idée d’aide au niveau européen, même si c’est un peu dérisoire par rapport à ce que sont les enjeux, mais il y a quand même une sensibilité de ces groupes dès que les dimensions arrivent au niveau des États, et en plus que plusieurs États sont concernés.
Actuellement les médias français se développent beaucoup en Afrique, c’est un peu le nouvel Eldorado de la presse et de l’audiovisuel : est-ce que vous pensez que c’est une alternative, comme la presse ne peut pas vraiment lutter contre Google, pour chercher de nouveaux marchés, de nouveaux relais de croissance ?
Jean-Marie Charon : Je ne pense pas que la référence soit directement celle des infomédiaires, mais en revanche, de la part d’un certain nombre de grands groupes, je pense évidemment par exemple au Monde, il y a certainement l’intégration d’une donnée qui n’existait pas jusqu’à présent, et qui est illustrée par la stratégie du Guardian. Là, on a un titre, un éditeur, qui partant de l’idée que la langue anglaise est partagée par toute une partie du monde, s’est engagé dans une stratégie vraiment à l’échelle du monde anglophone, avec des structures éditoriales qu’il a mises en place, avec une partie de sa rédaction aux États-Unis , une autre en Australie, et avec du coup, la constitution d’une audience qui n’est plus une audience du Guardian en Grande-Bretagne, mais qui est devenue une audience à l’échelle mondiale. Maintenant, il faut voir, parce que là on est, comme souvent sur l’Internet, dans la difficulté de ne pas confondre des orientations qui paraissent prometteuses pour des réussites. Parce qu’incontestablement le Guardian a réalisé quelque chose de prometteur, c'est-à-dire des audiences qui s’évaluent en dizaines de millions de visiteurs uniques, mais en même temps on ne peut pas dire qu’il ait réussi son pari économique, puisque de fait il reste déficitaire. Or, c’est quand même toujours le problème des stratégies mondiales qui visent le marché publicitaire.
La presse magazine a été un peu précurseur dans ce domaine. Je pense que des gens
comme CNN pourraient aussi nous raconter des choses aussi sur le sujet : souvent à partir des années 1980, on a eu le sentiment que des médias internationaux, voire à couverture mondiale, avaient plus de chances pour capter un marché publicitaire dans lequel on allait trouver un certain nombre de grandes marques mondiales. L’expérience n’est pas toujours automatique. Et quand on regarde les grandes régies publicitaires qui intervenaient sur ce marché-là, elles expliquaient que c’était souvent assez décevant, parce que les marques ont généralement des stratégies nationales, et que du coup, il n’y a pas toujours une valeur ajoutée à se mondialiser, donc il faut voir si l’Internet change vraiment la donne.
Après Google, parlons des réseaux sociaux, avec l’initiative de Facebook lancée la semaine dernière, Instant Article : à votre avis, est-ce que ça va accentuer le déséquilibre entre la presse et les grands acteurs du numérique ou est-ce que c’est au contraire une opportunité pour la presse ?
Jean-Marie Charon : Ma vision, ça a toujours été qu’à un moment ou à un autre, les infomédiaires qui ont un intérêt à avoir une offre de contenu de qualité pour que leur audience suive, ne peuvent pas complètement se désintéresser de ce qui se passe dans le secteur des contenus. C’est ailleurs un discours qui est tenu par certains fournisseurs d’accès, je pense à Orange par exemple, qui le dit explicitement, alors que c’était moins explicite du côté de Google, qui a toujours eu tendance à considérer que il faisait un cadeau aux fournisseurs de contenus tandis que Facebook reconnaissait depuis assez longtemps qu’il était intéressé par ce qui se passait en matière de production de contenus.
Il y a un risque d'un appauvrissement dans l’offre en matière d’information
J’ai toujours pensé qu’à un moment donné il y aurait une manière de rebattre un peu les cartes et où allait se poser la question des flux financiers entre les infomédiaires et les fournisseurs de contenus et les éditeurs. Je crois qu’on voit les choses se concrétiser, le problème en revanche, c’est la question de savoir si ces infomédiaires sont dans une logique de diversité et de pluralisme des contenus ? Ou est-ce qu’au contraire, ils sont dans une logique de pure opportunité en termes de réalisation de très grosses audiences ? Et on voit bien la manière dont ils opèrent pour Google,
et là, clairement pour Facebook, c'est-à-dire qu’ils font leurs courses quoi ! Ils choisissent les éditeurs qui leur paraissent être les meilleurs leviers d’audience. Alors, ça ne veut pas dire évidemment qu’ils feraient en sorte que de petits éditeurs ne puissent pas bénéficier de certains avantages, mais en revanche ils ne les aideront pas, alors que pour les gros éditeurs, ils sont prêts à passer des accords, à les aider à faire les évolutions nécessaires, et je pense qu’il y a un risque effectivement qu’on arrive à un marché, en termes de grands opérateurs, dans lequel il y aura un appauvrissement dans l’offre, notamment en matière d’information.
On parlait tout à l’heure du déclin du modèle économique de la presse, de la publicité et des abonnements, est-ce que vous avez en tête une initiative menée à l’étranger dont pourrait s’inspirer la presse française pour enrayer ce déclin?
Jean-Marie Charon : C’est le côté assez fascinant de la période actuelle, c’est qu’il y a un sentiment à la fois d’urgence, mais en même temps on n’est pas dans un contexte où tout le monde serait en train de se préparer à un repli général. En fait il y a énormément d’initiatives à l’étranger qui sont intéressantes. En matière de contenus, il y a beaucoup de choses qui se passent au
New York Times, on retient souvent son aspect commercial, et aussi la notion de
paywall, donc de mur payant, sa stratégie d’abonnement, qui est aujourd’hui une stratégie qui est fortement copiée, ou qui inspire beaucoup.
Si on prend un journal comme le Guardian, on va certainement retenir davantage le mode d’organisation qu’il est en train de mettre en place au niveau de sa rédaction, avec ce qu’on pourrait appeler un cycle de vingt-quatre heures, dans lequel la rédaction va servir successivement les smartphones, les ordinateurs, les tablettes, et l’imprimé. Cette notion de cycle de vingt-quatre heures, avec la manière dont une partie de la rédaction va être plutôt spécialisée dans la collecte d’informations alors qu’une autre va être davantage dans l’éditing, ça c’est un mode d’organisation qui aujourd’hui va faire référence je pense pour les quotidiens français, même s’ils ont beaucoup de mal, parce que les histoires des journalistes ne sont pas les mêmes [dans les deux pays NDLR], mais disons que ça va être une référence. Si vous prenez aujourd’hui Le Soir, un quotidien qui est assez proche de nous , où vous avez d’ailleurs des éditeurs français qui sont rattachés à son groupe, le groupe Rossel, c’est vraiment l’inspiration directe en termes d’organisation de la rédaction de ce qu’il se passe au Guardian, et par ailleurs à côté de ce cycle de vingt-quatre heures, il y a la mise en place de pôles spécialisés en vidéo, en data journalisme etc. Autre exemple qui a beaucoup influencé les éditeurs français, c’est l’utilisation que fait le quotidien canadien La Presse en matière de tablettes, et notamment l’importance qu’il a donnée dans ses applications à la vidéo et à l’image.
Sans chercher beaucoup, on voit toute une série et on peut dire que tout éditeur aujourd’hui qui réfléchit à sa stratégie,
comme Ouest-France, par exemple, qui peut paraître assez éloigné parce que c’est quotidien régional. En réalité, son édition sur tablette,
L’édition du soir, quelque part c’est la presse étrangère qui l’a poussé à aller vers ça, l’idée de ce cycle de vingt-quatre heures c’est quelque chose qu’il espère pouvoir mettre en place avec la nouvelle
newsroom qu’il est en train d’installer. Et de la même manière, la stratégie du
Guardian au niveau mondial c’est quelque chose qui incite aussi
Ouest-France, quand ils expliquent que leur stratégie n’est plus que locale, mais aussi nationale est internationale, grâce justement au numérique.
Que vous inspirent les propositions de Julia Cagé, dans son livre Sauver les médias ? Qu’est-ce que vous vous proposez de différent ?
Jean-Marie Charon :
Je pense que Julia Cagé fait un pari sur l’avenir qui est extrêmement gonflé
Je n’ai pas les mêmes ambitions que Julia Cagé. Je pense qu’elle prend un énorme risque quand même dans son livre. Elle fait à la fois un diagnostic que je trouve un peu excessif sur la manière dont le système basé sur la publicité serait complètement mort. Je pense qu’on ne peut pas ne pas intégrer la dimension du recul de la publicité, mais il me semble qu’on peut aussi compenser ce recul avec une participation plus forte des lecteurs, y compris par la vente de contenus. Je la rejoins relativement sur l’idée de
crowdfunding, mais pas avec l’amplitude qu’elle lui donne. Je pense que là elle fait un pari sur l’avenir qui est quand-même extrêmement gonflé : les quelques exemples qu’elle prend aux États-Unis sont des exemples de
pure players qui sont sur des registres d’information très particuliers, et on ne peut pas transposer directement ce qu’il se passe sur quelques
pure players sur des organes d’information qui eux, ont besoin d’avoir des moyens rédactionnels beaucoup plus importants. C’est là que j’ai un gros souci par rapport à son approche, et puis d’autre part il y a une disproportion ente les solutions qu’elle préconise et le diagnostic que je trouve beaucoup trop radical en terme de déclin.
En revanche, là où je la rejoins et je la cite d’ailleurs, c’est effectivement sur l’idée que l’État a certainement intérêt à réfléchir à des structures, des statuts d’entreprise où le public serait davantage partie prenante. Et puis, je pense qu’il y a certainement à réfléchir à la piste du crowdfunding, mais en France ce sera certainement beaucoup plus compliqué qu’aux États-Unis. Aux États-Unis l y a une histoire et une familiarité d à l’égard du financement via des fondations, notamment, qu’il s’agisse d’hôpitaux ou de centres de recherche etc., qu’on n’a pas en France. On n’a pas toujours les structures juridiques adaptées et puis surtout on n’a pas le même appétit ou la même culture dans ce domaine. Alors est-ce que les choses vont évoluer, on peut l’espérer, on peut y travailler, et ça fait partie effectivement des recommandations que je fais, mais en leur réservant une place moins centrale.
Vous parlez des aides à la presse et de leur affectation et vous expliquez dans votre rapport que ce sont essentiellement les publications destinées à un public privilégié, à niveau socioculturel élevé, donc à revenus élevés, qui bénéficient de la majorité des aides, tandis que la presse populaire qui est en déclin, a moins d’aides. Selon vous, les aides doivent être distribuées en fonction des contenus, ou plutôt par rapport à un lectorat ?
Jean-Marie Charon :
Plutôt qu’annoncer qu’on réorganise le système d’aides, il faudrait réfléchir à ce qu’est aujourd’hui le rôle de l’information
On ne peut pas y répondre comme ça tout de go, mais disons que plutôt qu’immédiatement annoncer qu’on réorganise le système d’aides avec plusieurs catégories nouvelles qui vont apparaître, ce que la ministre annonce aujourd’hui, notamment, il y aura toujours l’IPG, il y aura une catégorie culture et connaissance et une troisième qui serait divertissement, je pense qu’en fait, plutôt que de s’engager tout de suite dans cette typologie, il faudrait réfléchir à ce qu’est aujourd’hui le rôle de l’information. Et notamment ce qu’est le rôle de l’information pour le public le plus populaire. On voit bien d’ailleurs dans le débat public que ça reste très présent, vous avez vu les pétitions qui ont été signées contre
Closer qui gagnerait beaucoup trop d’argent.
Justement, la ministre de la Culture et de la Communication Fleur Pellerin, a fait publier un communiqué, dans lequel elle prenait position pour la suppression des aides publiques pour la presse récréative, ça va un petit peu à l’encontre en fait de …
Jean-Marie Charon : Oui, oui, tout à fait, ça va complètement à l’encontre de ce que je préconise, dans la mesure où je pense que ce qu’il faudrait commencer par faire, c’est identifier ce que sont les rôles importants des médias et notamment de la presse, aujourd’hui, dans une société telle que la nôtre. Et il me semble qu’on ne peut pas se référer uniquement à ce qu’étaient les fonctions traditionnelles de la presse, c'est-à-dire en gros le débat d’idées.
Comment est-ce qu’on continue à aider, au nom du rôle social joué par les médias ?
Je pense que dans notre société qui est devenue très médiatisée, les médias ont été amenés à occuper des tas de rôles qu’ils ne jouaient pas précédemment, que ce soit dans la vie pratique, des aides aux actions de tous les jours, que ce soit aussi dans la sociabilité, le fait de permettre aux gens d’échanger les uns avec les autres. Alors évidemment, aujourd’hui c’est peut-être plus sur le numérique que sur l’imprimé, mais c’est une fois qu’on a me semble-t-il un peu identifié ces différentes fonctions, qu’il serait intéressant de se dire : comment est-ce qu’on continue à aider, au nom de ce rôle social joué par les médias ? À ce moment-là on serait peut-être amenés à calmer un certain nombre de lobbys qui vont dire : « mais non c’est uniquement le débat d’idées qui compte, ou ce sont les bonnes idées » ou est-ce qu’au contraire on va dire : « Oui l’État a un rôle à jouer parce que la lecture c’est un enjeu aujourd’hui » ou l’accès à la connaissance c’est un enjeu, mais il y a aussi un certain nombre d’éléments de la vie pratique qui sont aussi des enjeux. Surtout je pense qu’on ne peut pas non plus disjoindre cette réflexion de ce que sont les lectorats, et de regarder très concrètement qui on aide en termes de lecteurs quand on aide telle forme de presse ou telle autre.
Vous expliquez dans votre rapport que le numérique change la presse, que ça change les métiers des journalistes, et vous parlez aussi du problème de l’attractivité de la presse, pour un métier qu’on n’associe pas forcément aux salles de rédaction, à savoir les développeurs. Et donc vous préconisez de repenser les statuts de journalistes, en association avec les partenaires sociaux. Selon vous, qu’est-ce qui pose problème actuellement dans les statuts actuels des journalistes ?
Jean-Marie Charon : De mon point de vue, le problème existait déjà mais disons qu’il avait toujours été un peu relativisé, et il existait beaucoup en presse magazine notamment, où vous aviez déjà cette espèce d’incongruité, qui était que dans la production des contenus des magazines, vous aviez des gens qui étaient spécialisés dans le texte, et dans la collecte d’informations mais sous la forme de texte, et puis vous en aviez d’autres qui étaient spécialisés dans la forme.
Alors hiérarchiquement ça démarrait par le directeur artistique, qui de fait, était souvent un rédacteur en chef bis, et ensuite on descendait avec des graphistes, les infographistes etc. Or, quand on regardait concrètement la conception et la réalisation des articles et de l’ensemble du chemin de fer etc. d’un magazine, on voyait bien qu’on ne pouvait pas faire cette séparation en disant les uns sont purement journalistes, et les autres sont purement des non-journalistes. Regardez ce qui vient de se passer à Grazia où c’est une styliste qui prend la direction de la rédaction. Donc le problème se posait déjà, mais ces professions-là, qui ne viennent pas de l’univers journalistique, puisqu’elles ne sont pas formées dans les écoles de journalistes, c’est davantage l’univers du ministère de la Culture. Ce n’était pas pour eux un enjeu absolument colossal. Aujourd’hui c’est la même question qui se pose mais à une autre échelle. Il y a toujours ces professions, graphiste, designer etc. mais si on entre dans l’univers du data journalisme par exemple, on va trouver aussi des statisticiens et puis ces fameux développeurs dont on vient de parler.
Si on prend le problème par le fond, en se disant, concrètement qu’est-ce que ça veut dire être producteur, contribuer à la production d’un contenu ? Pourquoi ça serait celui qui est uniquement à l’origine du texte qui serait journaliste ? Peut-on indéfiniment prétendre que seul le journaliste au sens traditionnel serait plus contributeur que les autres intervenants dans la production de l’information ? Quand vous regardez le développement d’un contenu très concret de data journalisme, vous voyez que parfois un développeur va jouer un rôle beaucoup plus important et significatif éditorialement. Vous avez quelqu’un comme Nicolas Kayser-Bril, qui a été à Owni et qui maintenant a une start-up qui s’appelle Journalisme++ c’est quelqu’un qui est un développeur, sa compétence d’origine c’est vraiment l’informatique, mais en même temps c’est quelqu’un qui a une appréhension des choses qui est complètement éditoriale et journalistique. Donc là il y a un sujet.
Qu’est-ce qui fait entreprise de presse aujourd’hui ?
Il y en a un autre qui peut-être est moins central, mais qui va aussi se poser, qui est qu’un certain nombre de journalistes, pour des raisons d’opportunité ou d’intérêt etc., aujourd’hui peuvent très bien privilégier de développer leur métier dans des univers qui ne sont pas directement en contact avec le public lui-même. Donc ils vont être dans des startups qui sont des sous-traitants des médias, mais qui de fait n’ont pas le statut d’entreprise de presse. Il y a aujourd’hui un certain nombre de journalistes qui travaillent dans des startups de data journalisme et qui ne se voient plus reconnaitre la carte de presse. Je pense que plus généralement la question est de savoir : qu’est-ce qui fait entreprise de presse aujourd’hui ? Est-ce qu’on y intègre uniquement ce qui faisait l’entreprise de presse traditionnellement ? Ou est-ce qu’on l’élargit ?
Aujourd’hui vous avez un secteur qui délibérément se maintient à l’extérieur du statut de l’entreprise de presse, que sont ce que j’ai appelé les
pure players de contenus c'est-à-dire les entreprises comme aufeminin.com ou CCM Benchmark ou Meltygroup . Ces gens-là, quand vous leur demandez d’expliquer comment sont produits les contenus, ils décrivent des fonctions de production de contenus qui sont effectivement en rupture ou décalés par rapport à ce qu’est le journalisme traditionnel. Par exemple chez CCM Benchmark, on dit que chez le responsable de contenus il doit y avoir une fonction d’identification, ou en tout cas de travail sur tous les outils d’identification de ce que sont les attentes du public.
Ça veut dire les algorithmes et de fait, ces entreprises-là ont développé d’énormes plateformes techniques. C’est vrai que dans la fonction traditionnelle du journaliste on peut toujours dire que ce n’était pas son boulot de se préoccuper des attentes, mais en même temps quand on regarde dans beaucoup de médias, et y compris en presse imprimée ou en audiovisuel, dire qu’un journaliste ou que certains journalistes ne se préoccupent pas du tout de ce que sont les attentes de leur public c’est quand même un peu exagéré. Et puis l’autre aspect, qui est encore plus problématique c’est que le journaliste aurait à s’intéresser aux marchés publicitaires, et à savoir si lorsqu’il développe tel ou tel type de contenu, il a intérêt à signaler à la régie [publicitaire NDLR]. C’est évidemment très dérogatoire par rapport à ce qu’est le journaliste traditionnel. Mais plutôt que de dire « on rejette » ou « on intègre », je pense que plus généralement il faut s’interroger sur ce qu’est aujourd’hui la définition du journalisme, au-delà même de la question du statut, et c’est d’ailleurs une piste que les écoles de journalisme intègrent elles-mêmes petit à petit.
Parmi les grandes ruptures, il y a la question que finalement, ce qui caractérisait le journaliste tel que les choses s’étaient développées depuis plusieurs décennies, c’était à la fois un rôle qui était joué, et ça depuis que le journalisme existe, donc un rôle de médiation entre la réalité et le public, et puis il y avait l’accumulation de toute une série de tours de mains, de savoir-faire…
Pour le journaliste, du XIXe siècle, l’essentiel de son savoir-faire c’était l’écriture, donc en dehors de ça, il y a un rôle qu’il jouait, mais c’est vrai qu’avec l’arrivée de l’audiovisuel, l’arrivée aussi de l’informatique dans les rédactions, donc de toute une série d’outils de plus en plus sophistiqués que mettaient en œuvre les journalistes, quand on était en école de journalisme, il y avait de plus en plus de temps qui était occupé à apprendre les technologies et l’usage des technologies.
Aujourd’hui, c’est un peu décalé dans la mesure où finalement les technologies sont beaucoup plus faciles à maîtriser, et puis surtout leur maîtrise s’est complètement banalisée, c'est-à-dire que toute une partie du public sait utiliser à la fois des moyens de captation d’image, de captation de son, sait faire des montages, de la même manière qu’intégrer des images avec des textes sur un support numérique, tout ça c’est quelque chose qui s’est généralisé. Donc on ne peut pas dire que la caractéristique du journalisme c’est savoir utiliser des outils. De la même manière, il y a une espèce d’acculturation d’une partie du public à des techniques de collecte d’informations, et c’est toute la notion de crowdsourcing. Là aussi, cette espèce d’éveil du public à l’idée de ce qui serait intéressant de voir dans l’information, et bien c’est une dimension qui a tendance à se banaliser.
En revanche, ce qui reste et qui est tout à fait central, c’est que chacun d’entre nous a besoin qu’une catégorie professionnelle fasse tout un travail à la fois de hiérarchisation, d’identification de ce que sont les sujets importants, et puis nous rende ces sujets intéressants, faciles d’accès etc.. Et c’est là cette question de rôle que j’évoquais tout à l’heure.
Pour finir, j’aimerais aborder un dernier aspect de ce rapport : la personnalisation de l’information. Vous citez notamment l’exemple d’Indigo. Si j’ai bien compris c’est quelque chose qui va au-delà des algorithmes ? C’est une personnalisation qui est effectuée par le lecteur ?
Jean-Marie Charon : Oui c’est la possibilité donnée au lecteur, donc en l’occurrence c’est une presse d’entreprise, de faire des choix. Par exemple, vous avez un certain nombre de lettres, - des newsletters - que produit Indigo et il y en a notamment qui sont internationales, [cette personnalisation NDLR] c’est la possibilité de choisir les pays que l’on veut voir davantage développés, c’est aussi la possibilité de faire évoluer les tarifs en fonction du type d’entreprise que l’on est. C’est-à-dire : si un lecteur unique c’est un type de tarif, si c’est une dizaine de lecteurs c’est un autre type de tarif, etc. C’est pour éviter ce qui existe souvent en matière de presse professionnelle, c’est de se dire : « à priori, il y a beaucoup de lecteurs, donc on a automatiquement une tarification élevée ». Là en fait, c’est une manière de permettre que chacun ait à la fois en termes de contenus et de relations commerciales, quelque chose qui lui convienne.
En revanche, l’enjeu de la personnalisation est me semble-t-il beaucoup plus important que ça, c'est-à-dire qu’aujourd’hui, il me semble que dans un certain nombre de formes de presse, son caractère extrêmement généraliste nuit à sa pertinence. Je pense particulièrement à la presse régionale aujourd’hui. Lorsqu’on est en zone urbaine, notamment, ce qui caractérise la presse régionale c’est de fournir une information très consensuelle, ce n’est pas du tout adapté aux zones urbaines. Je crois au contraire, dès qu’on est face à un public urbain, on a besoin de lui dire plus précisément, de lui proposer de resserrer son offre sur les choses qui l’intéressent, selon son âge, selon ses goûts, selon le type d’habitat qui est le sien, le type de quartier, etc.
Il me semble que là il y a un enjeu… Alors soit c’est une personnalisation « à priori » dans lequel le lecteur va devoir faire ses choix, soit c’est un système un peu comme on en connaît via des algorithmes, un peu sur le modèle d’Amazon, c'est-à-dire qu’en fonction de ce que sont vos habitudes de consultation, on va vous suggérer davantage de contenus similaires.
--
Crédit photo : Louis Monnier
Consulter le rapport
sur le site du ministère de la Culture et de la Communication