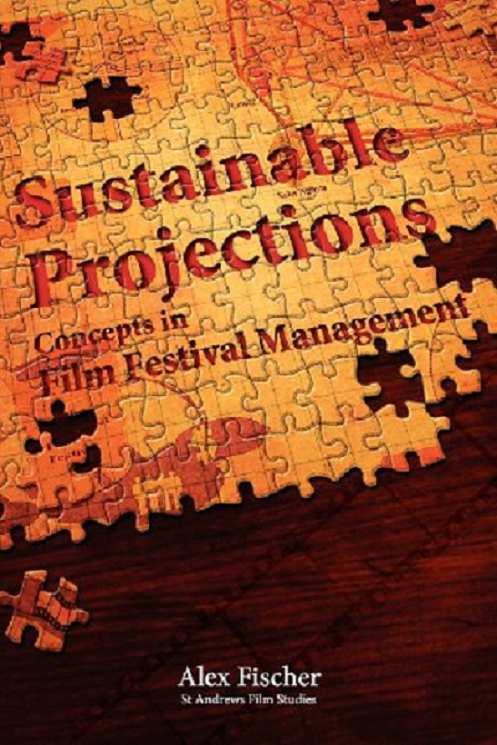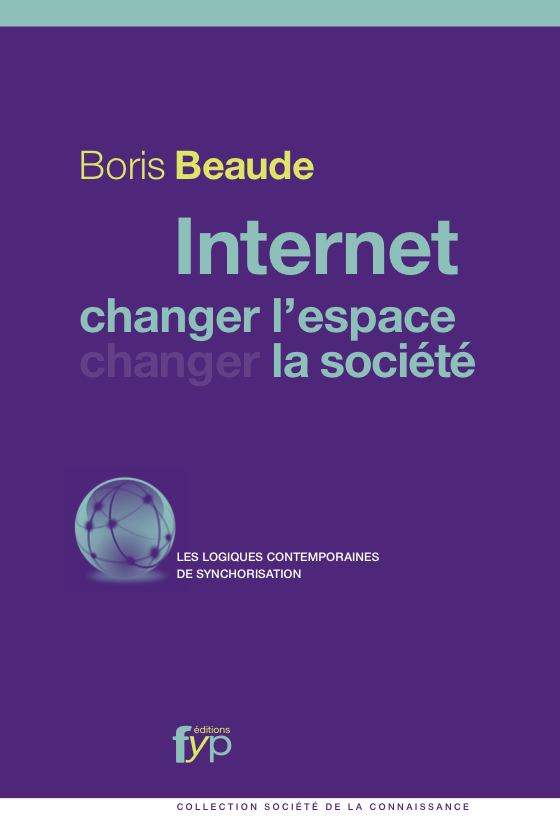Publié le 20 décembre 2011
L’adaptation de séries occidentales au monde arabe et musulman
Au cours du mois d’août 2011 était annoncée l’adaptation de la série britannique The Office pour la télévision afghane sous le nom de The Ministry (Le ministère). Comédie satirique, la version anglaise produite par la BBC met en scène la médiocrité et les échecs quotidiens d’employés de bureau dans une papeterie d’une petite ville du Sud de l’Angleterre. The Ministry prend place pour sa part dans un pays déchiré par la guerre, au ministère des Ordures de Hechland (« pays du rien » en dari), ministère dont la fonction est vaine, où la plupart des membres sont analphabètes et corrompus, et où le ministre a pour unique qualification professionnelle d’être le cousin du président.
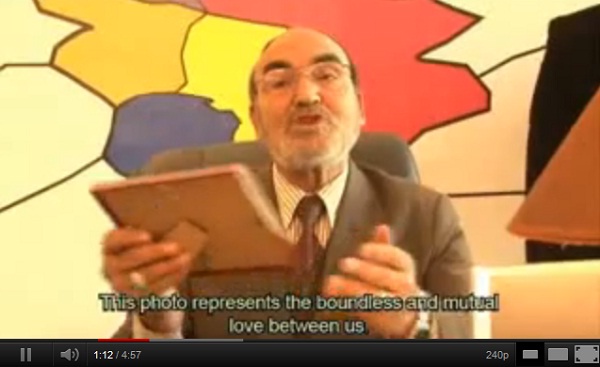
Bande-annonce de « The Ministry »,
adaptation afghane de la série britannique « The Office » via YouTube
Tournée selon le même format de documentaire fictif que la version originale, cette diatribe politique alterne des passages durant lesquels les personnages s’adressent directement à la caméra, avec des moments de vie quotidienne supposés être pris sur le vif. Si le scénario et la mise en scène se veulent ouvertement comiques, la série dénonce cependant l’incompétence gouvernementale et s’attaque à des problèmes auxquels la société afghane est confrontée tous les jours comme la corruption, la violence, le népotisme et le trafic de drogue.
Avec une diffusion prévue pour la fin de l’année sur Tolo TV, principale chaîne privée d’Afghanistan, ce type de série est une première et les producteurs attendent de voir comment l’audience nationale réagira. « Nous verrons bien si le public est réceptif à ce style de comédie » déclare Abazar Khayami un des producteurs de la série : « Si vous regardez aux États-Unis et en Europe, ils se moquent ouvertement de leurs gouvernements, mais faire ça ici, on ne sait vraiment pas à quoi s’attendre. »
Cet exemple d’adaptation d’une série occidentale à un pays du monde musulman n’est bien entendu pas le premier du genre. Il est le reflet de toute une industrie qui n’a cessé de se développer depuis le début des années 2000 avec l’explosion du marché des chaînes satellitaires au Moyen-Orient. Au-delà d’une simple redistribution n’impliquant que sous-titrage et censure, il s’agit d’un processus d’adaptation de scénarios originaux à des contextes culturels spécifiques par des maisons de production locales.
Au début du mois de septembre dernier, la branche turque de la compagnie Walt Disney annonçait le lancement de la version locale de Desperate Housewives sous le nom de Umutsuz Ev Kadinlari. La série, produite par Medyiapim et intégralement tournée à Istanbul où l’équipe a su dénicher l’équivalent local de Wisteria Lane, est diffusée sur Kanal D, une des chaînes privées les plus populaires en Turquie. Le casting est composé d’actrices turques déjà bien connues dans le pays comme Songül Öden. Celle qui joue Susan dans la série, fut le principal personnage féminin de Gümüs, une des séries turques les plus célèbres de ces dernières années puisqu’elle a rencontré un énorme succès dans le monde arabe (sous le titre Noor).
Fatih Aksoy, PDG de Medyapim a déclaré : « En adaptant [Desperate Housewives] pour le marché turc, nous allons faire en sorte de maintenir le niveau du scénario original et de garantir une production d’excellente qualité comme c’est le cas aux États-Unis. » De leur côté, les représentants de Disney ont également confirmé que la version turque de la série devrait rester fidèle aux grandes lignes de l’histoire, tout en ajoutant une « saveur turque bien particulière ». Alors que la première saison ne fait que commencer la série semble déjà partie pour être une réussite.

Affiche de « Umutsuz Ev Kadinlari », version turque de « Desperate Housewives »
Mais les tentatives d’adaptation ne se soldent pas toujours par un succès. En 2005, le groupe saoudien MBC (Middle East Broadcasting Corporation) entreprend d’arabiser le dessin animé Les Simpsons qui devient alors Al Shamshoon. Dans cette version, Homer s’appelle Omar, Marge est rebaptisée Mona, et Bart, Badr. À la différence des exemples cités plus haut, tous deux des productions locales à part entière, il s’agit plutôt ici d’un travail de montage et de doublage à partir de la version originale. Badih Fattouh, directeur des acquisitions pour MBC, et par conséquent responsable de ce projet, précise qu’il s’agit néanmoins d’un réel processus d’adaptation culturelle : « Il faut comprendre qu’il ne s’agit pas seulement de doubler la série, mais d’arabiser son concept, que nous avons d’ailleurs un peu tempéré. Nous avons modéré le langage et arabisé la série au sens culturel du terme ». Mais comme l’explique Amr Hosny, responsable de l’adaptation de scénarios occidentaux pour le monde arabe chez MBC, travailler sur Al Shamshoon est loin d’avoir été aussi évident : « Quand on a commencé, j’ai dû revenir sur la série originale pour l’étudier. J’ai réalisé qu’il s’agissait d’un produit typique de la culture populaire américaine, et j’ai alors compris qu’on ne pouvait pas faire ça comme ça. Il me fallait trouver des idées qui soient des équivalents évidents pour l’audience arabe. […] Ce type, Homer, il boit de la bière tout le temps, mais c’est un péché pour les Arabes. Je leur ai dit [aux directeurs de la chaîne] qu’il pourrait boire du sheer, une boisson au malt non alcoolisée dont la prononciation ressemble à celle du mot bière [beer en anglais], ce qui rendrait le doublage plus facile. Mais ils ont refusé. Ils m’ont dit que ça devrait être du jus. » Amr a également dû faire disparaître la taverne de Moe, les hot-dogs, les sandwichs au bacon, et transformer les églises en mosquées.
Avec une diffusion prévue sur les écrans saoudiens en prime time pour le premier soir du Ramadan 2005, l’enjeu était de taille. En effet, le mois de jeûne est la période la plus lucrative de l’année pour l’industrie du divertissement au Moyen-Orient, et les attentes du public sont très élevées. Mais dans une région où les dessins animés sont considérés comme étant pour les enfants, l’audience n’a pas accroché et a préféré changer de chaîne. À la fin du Ramadan, le projet a été définitivement abandonné.
En conclusion, certaines séries occidentales, notamment des dessins animés satiriques comme Les Simpsons, ne s’exportent pas facilement dans le monde arabe, à moins de perdre toute leur saveur, s’ils ne sont pas entièrement réadaptés pour l’audience locale. Les producteurs koweitiens de Block 13, la version arabisée de South Park, produite intégralement sur place, l’ont bien compris. Même s’il reste quelques similarités avec le modèle américain – l’équivalent de Kenny porte un keffieh, celui de Cartman une chéchia – tout, depuis les personnages jusqu’au sens de l’humour, a été recréé pour attirer un public arabe.
Toutefois, le secteur de l’industrie qui bénéficie le plus du marché de l’adaptation des produits occidentaux pour le petit écran du Moyen-Orient, reste celui des émissions de téléréalité.
L'arabisation de la téléréalité occidentale
La téléréalité a fait une entrée assez tardive dans le monde arabe. La révolution satellitaire à la fin des années 1990 et l’explosion du nombre de chaînes au début des années 2000, sont les facteurs qui ont permis à ce nouveau phénomène de s’établir sur le marché régional. Diffusés dans leur langue et format originaux tout d’abord, ces programmes ont ensuite été adaptés à l’audience locale.
L’émission pionnière de ce genre de divertissement dans le monde arabe a été Man Sayarbah Al Mallion ? (Qui veut gagner des millions ?). Lancée en 2000 par MBC et diffusée deux fois par semaine, la version arabe de l’émission britannique Who Wants to be a Millionnaire? a rencontré un franc succès, devenant le programme le plus regardé dans toute la région en 2000 et 2001. Avec des candidats originaires de tous les pays arabes, Man Sayarbah Al Mallion? a été la première émission à représenter la diversité du Moyen-Orient et à s’adresser à un public transnational en abordant des questions relatives à l’histoire arabe, au patrimoine islamique, et aux problématiques panarabes comme la question palestinienne. Le présentateur George Qerdahi a même déclaré en 2002 dans une interview : « Je ne pense pas exagérer si je vous dis que ce programme arrive à unir la totalité du monde arabe. […] Quelques mois plus tôt des statistiques ont révélé que 80 % des téléspectateurs de la région regardent l’émission, un audimat jamais atteint par aucun autre programme dans le monde »(1). Bien qu’il s’agisse d’un jeu télévisé, tous ces aspects ont fait que Man Sayarbah Al Mallion? a constitué un tournant majeur pour le développement de la téléréalité sur le marché satellitaire arabe.

George Qerdahi, présentateur de « Man Sayarbah Al Mallion? »,
version arabe de « Qui veut gagner des Millions ? »
Face au succès de MBC et de Man Sayarbah Al Mallion? la chaîne libanaise Future TV a voulu tirer parti de l’engouement nouveau pour les jeux télévisés occidentaux importés sur le petit écran arabe. Elle lance fin 2001 Al Halka Al Ad’af (Le maillon faible),version locale de l’émission The Weakest Link produite par la BBC. Imitant le concept original, la présentatrice du show, Rita Khoury, a du adopter non seulement la même personnalité acerbe et autoritaire que la présentatrice britannique, Anne Robinson, mais également la même apparence : cheveux courts, lunettes sévères et vêtements noirs. Reproduit sans aucune adaptation culturelle, le concept d’une femme délibérément masculine qui humilie les candidats en public n’est pas passé. Le show a provoqué un tollé et n’a pas été reconduit.
La téléréalité, au sens propre du terme, a réellement vu le jour dans la région avec Al Hawa Sawa, première production entièrement arabelancée fin 2003 par MBC. Inspirée de concepts occidentaux comme The Bachelorette mais adaptée à l’environnement culturel, cette émission offre à la gagnante un mariage arrangé. Dans un appartement de Beyrouth équipé de caméras, huit jeunes femmes passent en revue une série d’hommes célibataires et choisissent, avec les conseils de leur famille et le soutien des votes du public, leur futur époux. Les prétendants de leur coté peuvent observer les candidates 24h sur 24h et les contacter à n’importe quel moment pour obtenir un rendez-vous et faire leur demande en mariage. Les candidates étaient soumises à des codes vestimentaires et comportementaux très stricts imposés par MBC pour ne pas heurter les téléspectateurs les plus conservateurs. Ces règles ont au final éliminé les ingrédients majeurs sur lesquels repose le succès des versions occidentales (nudité, disputes, flirts...). L’émission s’est révélée être un échec et n’a pas été renouvelée, d’autant plus que la gagnante a refusé quelques heures avant la finale d’épouser celui qui avait été choisi pour elle.
Mais l’échec le plus cuisant essuyé par MBC reste celui de l’émission Al Ra’is, lancée en 2004 sur le concept de Big Brother. Dans une maison au Bahreïn, six jeunes hommes et six jeunes femmes vivent sous la surveillance constante des caméras. Tout comme Al Hawa Sawa, les règles de vie sont strictes. Les candidats ne sont filmés ni dans les chambres, ni dans les salles de bains, et seules les pièces de vie commune sont mixtes. Malgré toutes ces précautions, l’émission a rencontré de vives critiques. Lors du premier épisode, le candidat saoudien a accueilli avec une bise sur la joue la candidate tunisienne. Cet événement a suffi pour rallier les détracteurs du Bahreïn dénonçant le fait que des hommes et des femmes vivaient sous le même toit sans être mariés, allant même jusqu’à manifester et écrire au parlement pour demander le retrait de Al Ra’is des grilles de programmes. L’émission a été arrêtée moins de deux semaines après son lancement.
Après plusieurs expériences malheureuses, MBC a finalement opté pour la diffusion d’émissions de téléréalité dans leur version et langue d’origine. L’idée étant qu’il est plus facile pour les téléspectateurs de la région de tolérer des comportements considérés comme choquants s’ils sont ceux d’individus étrangers, que s’ils sont le fait de personnes de culture arabe ou musulmane. « Ça reste acceptable aux États-Unis parce que vous regarder la culture de quelqu’un d’autre. Vous n’importez pas [ces comportements] dans votre propre culture » explique Tim Riordan, directeur des chaines du groupe MBC(2).
La téléréalité arabe a finalement trouvé la recette du succès lorsque les producteurs ont décidé de croiser ce genre de programme avec un autre phénomène extrêmement populaire dans la région : les clips musicaux mettant en scène des chanteuses sexy.

La sulfureuse chanteuse égyptienne Ruby dans son clip « Enta ‘aref leh »
Fin 2002, Future TV annonce l’achat du concept britannique de Pop Idol, émission dont la finale quelques mois auparavant a attiré plus de 13 millions de téléspectateurs et enregistré un record de 9 millions de votes. Intitulée Super Star, ce nouveau programme de téléréalité a été annoncé en 2003 comme la plus grosse production de divertissement télévisé dans le monde arabe. Dans cette émission de téléréalité musicale, la culture arabe est à l’honneur : tout est chanté et jugé par des candidats et jurys arabes. Super Star rencontre le succès escompté. Lors de la dernière semaine, l’émission enregistre plus de 4,8 millions de votes pour la première saison en 2003, près de 10 millions l’année d’après, et, toujours pour cette même semaine, plus de 15 millions de votes en 2005(3). Désireux d’exploiter cette réussite, le groupe libanais LBC (Lebanese Broadcasting Corporation) décide à son tour d’acheter un concept de téléréalité musicale, celui de Star Academy en septembre 2003. Dans sa version arabe, l’émission devient Star Academy, Al Acadimiya et rencontre elle aussi un succès immédiat. La neuvième saison annoncée pour 2012 est actuellement en préparation. La popularité de ces programmes n’ayant cessé d’augmenter, les chaînes ont établi des accords commerciaux avec les compagnies nationales de télécom et de téléphonie mobile dans les pays où l’émission est diffusée, (comme le Maroc, la Tunisie, l’Égypte, la Syrie, le Liban, la Jordanie, l’Irak, l’Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, et le Bahreïn) pour bénéficier des revenus considérables générés par les votes du public.
Clip promotionnel de « Star Academy », « Al Acadimiya » saison 8
Contrairement au groupe saoudien MBC, les chaînes libanaises LBC et Future TV n’ont aucun problème avec les femmes qui montrent leur peau et leur corps. En 2005, LBC trouve la synergie parfaite entre téléréalité et clip vidéo en lançant Al Wadi inspiré de l’émission françaiseLa Ferme des célébrités. Quatorze célébrités s’installent dans une ferme au Nord de Beyrouth pour y vivre et effectuer les tâches quotidiennes. Le concept n’est pas très différent de celui des autres programmes de téléréalité. Mais l’idée qui fera basculer Al Wadi dans la catégorie des émissions à succès est d’avoir nommé Haif Wehbe – star libanaise à sensation extrêmement populaire pour ses vidéos clips assez osés – comme présentatrice permanente, s’installant chaque nouvelle saison à la ferme avec les candidats. Avec Haifa aux commandes, Al Wadi est apparu comme la synthèse parfaite entre les deux phénomènes les plus populaires dans l’industrie du divertissement télévisé arabe, la rencontre ultime entre téléréalité et clips sexy.
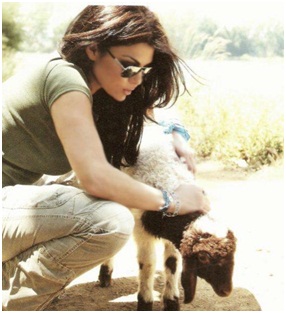
Haifa Wehbe, présentatrice de « Al Wadi » version arabe de « La Ferme des Célébrités »
Les émissions de téléréalité musicales ou mettant en scène des artistes arabes se sont donc révélées être le secret de la réussite pour l’industrie de la région. Jusqu’à 80% des Libanais entre 18 et 35 ans(4) ont suivi les premières saisons de Star Academy, Al Acadimiya. Les primes de l’émission, ainsi que ceux de Super Star et de Al Wadi, sont aujourd’hui devenus des événements régionaux dominant les conversations. Selon le groupe de conseil Arab Advisors Group, les tarifs publicitaires sur les chaînes satellitaires arabes lors de ces émissions augmentent de plus de 130 % par rapport aux tarifs en vigueur lors d’autres primes(5). Et lorsque le site internet de la chaîne d’information Al Arabiya publie un article sur une de ces trois émissions, il est généralement le plus lu et le plus partagé de la journée. Par conséquent, la téléréalité arabe est aujourd’hui bien plus qu’une pâle copie des programmes occidentaux et l’industrie a su développer une identité régionale forte et singulière.
L'importation de séries et de films occidentaux sur les écrans arabes
Le troisième volet de ce marché des produits occidentaux pour le petit écran arabe est celui de l’importation de films et de séries en langues et formats originaux, sous-titrés en arabe et partiellement censurés dans la plupart des pays. Les chaînes qui les diffusent ciblent une audience transnationale de 18 à 35 ans, moderne et attirée par les programmes de styles occidentaux. Mais ce processus d’importation, aussi simple qu’il paraisse, a cependant un impact sur la créativité locale et l’évolution de l’industrie régionale.
Fin 2008, les groupes Fox International, propriété du magnat des médias Rupert Murdoch, et Rotana Media Services, appartenant au prince saoudien Al Waleed Bin Talal , ont annoncé le lancement de la chaîne Fox Series au Moyen-Orient. Première chaîne de la région à ne diffuser que des séries américaines dans leur langue d’origine en continu, Fox Series est la seconde chaîne en anglais issue d’un accord entre Fox et Rotana. La première, Fox Movies, a été lancée quelques mois auparavant, sur le même concept de diffusion de films américains en version originale sous-titrée en arabe. Ces deux chaînes, qui appliquent toutes deux la censure de scènes explicites et de nudité, diffusent uniquement des blockbusters hollywoodiens et des séries à succès.
Désireuse d’étendre son marché à d’autres segments d’audience, Fox Series décide, en avril dernier, de doubler ses programmes en arabe et d’offrir aux téléspectateurs le choix des deux langues. Au lieu de proposer le doublage des séries en langue classique, ce qui crée une certaine distance et décourage souvent une partie du public, Fox Series a opté pour différents dialectes. Ainsi par exemple, la série Glee est doublée en libanais, Desperate Housewives en syrien, et Modern Family en égyptien. La chaîne a également supprimé les sous-titres arabes des versions originales.
Les réactions ne sont pas unanimes. Mazen, fan de la série Les Experts depuis le lancement de la chaîne désapprouve et publie sur son blog : « Je ne peux pas supporter cette nouveauté de doubler les séries. C’est très compliqué de comprendre tous les trucs techniques qui se passent dans le scénario sans les sous-titres. Et je ne peux pas supporter les voix prétentieuses de ces acteurs arabes qui gâchent la série. » Cependant, Mark, designer chez Fox Series pense que le but de la chaîne est d’attirer de nouveaux téléspectateurs : « Ils essayent de renouveler leur audience. Un grand nombre de gens vont arrêter de regarder la chaîne, mais d’autres en revanche, comme les femmes au foyer, prendront le relais. Cela veut dire plus de publicité ciblée sur ce groupe de personnes, ce qui signifie plus d’argent pour la chaîne. »

La chaîne Fox Series diffuse en continu des séries américaines sous-titrées en arabe
Un câble WikiLeaks datant de mai 2009 révèle que des séries américaines comme Desperate Housewives ou Friends sont plus susceptibles de convaincre la jeunesse saoudienne de rejeter la violence et le terrorisme, que les millions de dollars investis chaque année par les États-Unis en propagande pro-américaine. En effet, dans ce câble, deux directeurs exécutifs de médias saoudiens ont déclaré que des chaînes comme celles des partenariats Fox-Rotana et du groupe MBC (notamment MBC4 et MBC5), étaient devenues extrêmement populaires dans le royaume. Même dans les endroits les plus reculés du pays les gens sont « fascinés par la culture américaine comme jamais auparavant (…). On ne voit plus de Bédouins, mais des gamins habillés à l’occidentale, intéressés par le monde extérieur. »
Réduire les risques de pertes financières est une des premières motivations derrière l’importation de séries télévisées occidentales sur le marché arabe. Lorsqu’un programme est choisi pour être diffusé dans la région, il a déjà fait ses preuves auprès d’audiences étrangères et les chaînes qui les retransmettent s’attendent donc à un succès à peu près similaire. En plus de limiter les risques, ce processus permet également de limiter les coûts de production, avantage considérable sur le marché arabe par rapport au prix que couterait une série produite localement (aujourd’hui un épisode peut couter jusqu’à 2 millions de dollars notamment lorsqu’il s’agit de séries produites pour le Ramadan). L’industrie et la créativité régionales ont été assez durement affectées par ce processus d’importation, qui n’a cessé de s’intensifier depuis le début des années 2000. Même la production de « Musalsalat », ou séries du Ramadan, a été touchée alors qu’il s’agit pourtant d’un des secteurs majeurs de l’industrie arabe du divertissement télévisé.
La taille du marché du Moyen-Orient, plus de 300 millions de téléspectateurs, et l’arrivée du satellite au début des années 2000 dans la région sont deux facteurs qui permettent aujourd’hui aux chaînes d’amortir les dépenses et les pertes auxquelles elles sont susceptibles de faire face lorsqu’elles se lancent dans de nouvelles productions. Cette minimisation des risques aurait pu encourager les groupes médiatiques régionaux à soutenir la créativité locale et les initiatives indépendantes. Cependant, l’augmentation rapide d’importation de programmes s’est traduite par une perte progressive d’originalité artistique dans le paysage audiovisuel arabe. Abdel Bibi, consultant médiatique explique que « la nouvelle génération importe des contenus comme elle importe des voitures. Ils devraient former des gens créatifs et offrir aux maisons de production d’ici plus d’opportunités de créer des formats susceptibles de vraiment toucher les gens de la région »(6).
Les chaînes MBC2 et MBC Max diffusent en continu des blockbusters hollywoodiens
C’est en 2003, avec l’évolution de MBC en un consortium de chaînes, que les séries et films étrangers avec des sous-titres en arabe ont été introduits dans la région. Ciblant une audience transnationale de 18 à 35 ans, MBC2 s’est spécialisée dans la diffusion de films hollywoodiens et MBC4 dans celle de sitcoms et talk-shows américains. En décembre 2004, la chaîne émiratie One-TV arrive sur le marché avec la promesse de diffuser 27 blockbusters par semaines, ainsi que des séries et des jeux télévisés américains. Le lancement de cette chaîne est le fruit d’un accord établi entre DMI (Dubaï Media Incorporated) et Warner Bros International Television Distribution qui décrit ce deal, dont la durée est pour l’instant toujours indéterminée, comme le plus important jamais signé par la compagnie avec une chaîne du Moyen-Orient.
En temps normal, les droits sur des films récents pour des chaînes de télévision sont assez chers. Ces prix élevés contraignent généralement les chaînes à limiter l’importation et la diffusion de films étrangers, et à accorder une place assez importante dans leurs grilles de programmes à des productions locales traitant de sujets nationaux et régionaux. Mais des chaînes comme celles des groupes MBC, Fox, et DMI, dépendent de fortunes privées, de financements des multinationales, et de partenariats sur le long terme avec les studios hollywoodiens. Cette formule permet au final à ces chaînes d’échapper aux mécanismes de marché qui pourraient les contraindre à investir dans l’industrie locale.
--
Crédits photos :
- Bande annonce de The Ministry disponible sur YouTube
--
Crédits photos :
- Bande annonce de The Ministry disponible sur YouTube
- Image extraite de la page Facebook de la série Umutsuz Ev Kadinlari
- Générique de Block 13 disponible sur YouTube
- Image extraite de la vidéo de l’émission Man Sayarbah Al Mallion disponible sur YouTube
- Image extraite du vidéo clip « Enta ‘aref leh » de Ruby disponible sur YouTube
- Clip promotionnel de Star Academy, Al Acadimiya, saison 8 disponible sur YouTube
- Image extraite de la page Facebook de Haifa Wehbe
- Image extraite du site de la chaîne Fox Series
- Vidéo promotionnelle des chaînes MBC2 et MBC Max disponible sur YouTube
Références
Andrew HAMMOND, Pop Culture Arab World!: Media, Arts, and Lifestyle, Library of Congress Cataloging-in-Publication, 2005
Naomi SAKR, Arab Television Today, I.B. Tauris, 2007
Marc LYNCH, « Reality is Not Enough. The Politics of Arab Reality TV » in Transnational Broadcasting Studies: The Real (Arab) world. Is Reality TV Democratizing the Middle East?, Vol. 1, n°2, AUC Press, 2006
À lire également
Internet, un espace bien réel
Boris Beaude décrit Internet comme un espace bien réel, avec des particularismes géographiques propres. Mais au-delà d'un simple exercice conceptuel, l'auteur décrypte les enjeux sous-jacents à la maîtrise du net par les acteurs mondiaux majeurs et appelle à une politisation de cet espace commun.