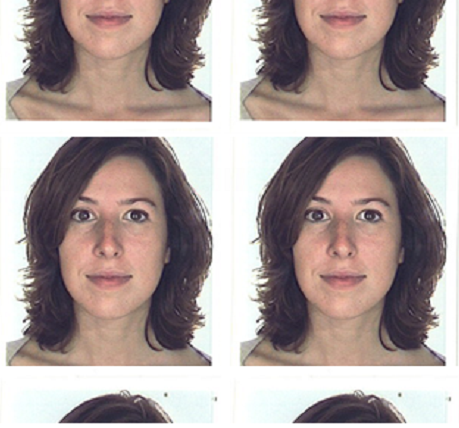Cet entretien a été mené en juin 2014. Joël Ronez, alors directeur des nouveaux médias, a quitté ses fonctions au mois d’août dernier. Nous publions cette discussion, complétée par une dernière question, car elle apporte un éclairage précieux sur les récentes évolutions numériques de Radio France.
Commençons par revenir sur la création de la direction des nouveaux médias. À quel besoin répondait-elle ? A-t-elle profondément changé la culture d’entreprise à Radio France ?
Joël Ronez : La création de la DNM s’est faite dans un contexte, en 2011. Elle n’a pas été créée
ex nihilo, il y a toujours eu à
Radio France, depuis que le numérique existe, une direction transversale plus ou moins étoffée qui s’est occupée, avec des stratégies et des mandats différents, de la question numérique. Il y a eu un DPM, département des productions multimédia, à l’époque il y avait une rédaction, dirigée par Michel Polaco, avec des webreporters, de nouvelles offres avaient été lancées. Par exemple, une web radio sur la gastronomie, sur le sport, etc. Ensuite, il y a eu une époque durant laquelle ces offres-là sont revenues à l’intérieur, les journalistes ont été répartis dans les différentes chaînes et où la direction transversale s’est réduite comme peau de chagrin. Puis, il y a eu une période où les infrastructures et les outils techniques des sites étaient développés à la direction des systèmes d’information, etc. Ça a fluctué. Mais il y a toujours eu une direction transversale, comme dans toutes les entreprises. La nouveauté en 2011, c’était tout d’abord un constat : « on n'a pas suffisamment investi durant la dernière décennie, de 2000 à 2010, sur nos offres numériques ». Quand je dis « offres numériques », j’entends à la fois sur les contenus et la qualité, le nombre, le volume et le degré d’innovation des productions, et à la fois sur le contenant, les sites et applications, la question de la distribution. Je pense au corrolaire : les hommes et les femmes, les compétences qui sont là pour faire fonctionner l’ensemble. Ces personnes ont à la fois une double fonction : celle de produire des contenus à destination d’un nouveau public mais également de participer à la culture du changement numérique et à l’évangélisation au sein de l’entreprise dans les différentes chaînes. Alors, on a donc donné en 2011 une nouvelle impulsion à cette DMP, devenue entre temps la DDM, direction du multimédia. On l’a renommée, DNM, direction des nouveaux médias. Ce changement de nom accompagnait bien une ambition : prendre pied dans le numérique et accompagner l’entreprise vers le numérique, conquérir de nouveaux publics. Ça ne marche que dans le cas où on a une direction transversale forte – sur laquelle on investit – et lorsqu’au sein de chaque chaîne il y a de l’offre, et que chacune de ces chaînes (Radio France en compte 7, ou même 50 si l’on compte 6 chaînes et 44 France Bleu) produit un effort multimédia, pour créer de nouveaux contenus.
À la DNM, on est passé de 17 personnes à une cinquantaine. On a créé 4 pôles : un pôle projets et exploitation – qui gère la refonte des sites et applications (notamment la partie spécifications, ce pôle qualifie et structure les besoins des chaînes, les fait entrer dans un référentiel stratégique, marketing, éditorial commun et il gère en sous-traitance les projets) –, un pôle marketing, pour conquérir et fidéliser l’audience, augmenter le nombre d’internautes, un pôle éditorial, car il n’y a pas que le technique qui est transversal, l’éditorial l’est aussi. Le contenu est produit dans les chaînes, mais on a besoin d’une équipe au centre pour pouvoir mutualiser un certain nombre de choses. C’est bien là la difficulté et notamment dans une maison comme Radio France, où il y a une culture de l’éditorial ancrée dans les chaînes et où l’on ne sait pas travailler en mode projet. On travaille assez peu en transversal, c’est très vertical et pyramidal. Mais je tenais à un pôle éditorial, car on avait aussi besoin de faire des économies d’échelle, on avait besoin de transversaliser, de mutualiser des choses. Par exemple, si on fait un site pour la Coupe du Monde, on ne va pas faire 3 sites pour chacune des chaînes, avec les mêmes informations. Si on fait un site sur le Tour de France pour France Bleu, je vais pas en faire un autre pour France Info, puis encore un autre pour France Inter, alors que ce sont les mêmes reporters qui interviennent sur les trois chaînes. Il faut être logique !
Il y avait un autre problème sous-estimé : la nécessité de transcender un peu les habitudes éditoriales et d’aller au-delà du simple traitement et délinératisation de l’antenne, de ne pas seulement se laisser porter par le flux de l’antenne et de voir plus loin. L’objectif de cette petite équipe éditoriale, c’est aussi d’arriver à faire le lien et de donner envie d’explorer de nouvelles formes d’écritures, les
webdocus, les fictions web, l’image, la vidéo, les productions multimédias, bimédias,
native web, etc. Parce que dans un groupe de service public, on ne peut pas exister que par la distribution, il faut exister également par la production.
Un groupe de service public ne peut pas exister que par la distribution, il doit aussi exister par la production.
Sinon, on ne sert à rien, soyons clairs là-dessus. Mais ce faisant, on entre en contradiction avec une culture du média radio qui est un média de flux, alors que la production dans le sens audiovisuel du terme (par audiovisuel, je l’entends au sens de la TV ou du web), et c’est une culture de l’anticipation, du travail en commun, en mettant en relation plusieurs savoirs-faire comme le design web, la photo, le son, la vidéo. Dans une maison comme Radio France, où l’on travaille avec du son, un produit économique, rapide, pas cher, où l’on travaille dans l’instant, où l’on décide la veille pour le lendemain, c’est compliqué. Mais on a augmenté la qualité et le nombre de ces traitements, et notamment en actus prévisibles, en événementiel, etc. Dans ce pôle éditorial, outre les personnes dédiées aux chaînes pour encourager de nouvelles écritures, il y a des personnes dédiées à la production numérique, vidéo et son. Ils font de la production et de la post-production pour les sites web des chaînes et gèrent un budget vidéo important (1 million d’euros) dans lequel on a mis tout ce qui est production vidéo, notamment captation de concerts, sessions acoustiques, productions déléguées, coproductions avec un plan de financement CNC avec Arte par exemple.
Enfin, dernier pôle, le pôle technique dans lequel on a tout ce qui est lié au développement, métiers d’administrateurs systèmes, développeurs. On a souhaité internaliser la conception et le savoir-faire, la maintenance des sites. Pas encore des applications mobiles, mais on le fera.
Bilan ? On est passé de 70 emplois dédiés à la DNM à 150 (certains sont déployés dans les chaînes). Évidemment, il a fallu recruter un peu plus de 85 personnes, c’est du temps, de la structuration, de l’organisation. Dans ce cadre, le bilan chiffré est positif : on a doublé (2 fois et demi, précisément) les audiences, on a refondu les sites et applications, on a créé
ex-nihilo deux sites comme
Nouvoson (multicanal) et
RF8 sur la musique. On a mis en place des budgets, des compétences, des moyens, des structures. Maintenant, ça se consolide. Parce qu’on est allé assez vite sur deux ans…Les limites, c’est bien sûr que tout ce qui est transversal est toujours un peu suspect dans une maison comme Radio France.
Quelles résistances rencontrez-vous encore en interne ?
Joël Ronez : Alors, c’est plus au niveau technique qu’humain. On a pas le problème de scepticisme, ou de manque d’envies : les gens veulent, ils souhaitent faire de nouvelles choses. Il y a 3 ans, le discours était un peu différent, dans certains cas, on pouvait entendre « nous, notre métier, c’est la radio ». Maintenant, c’est « on souhaite que les sites obtiennent davantage de moyens et que ça marche mieux ». Ce serait presque plutôt : « Qu’est-ce que vous faites à la DNM ? ça marche pas assez bien ! ». Ça veut bien dire qu’on a réussi quelque chose, qu’on a suscité des attentes, qu’on a clairement gagné la bataille de la légitimité de ce développement. J’ai toujours dit notamment au personnel sur ce point que je faisais bien de la radio. Quand on me disait « mon m&eaeacute;tier, c’est la radio », je répondais « ça tombe bien, moi aussi j’en fais ». Les développeurs font de la radio, mes chefs de projet fonctionnels font de la radio, mes webmarketeurs aussi, mes journalistes web font de la radio. Sauf que la radio a changé. On était producteurs et diffuseurs de flux audio linéaires, on est aujourd’hui producteurs et diffuseurs de flux audio linéaires mais aussi non linéaires avec le podcast, producteurs de données associées pour ces podcasts, producteurs d’image pour illustrer, d’images fixes, de la photo et de la vidéo. Finalement, la radio filmée est une réponse à la demande du public, qui la réclame. On gère des services d’interactivité. C’est tout ça, faire de la radio aujourd’hui. La bataille de la légitimité a été gagnée de mon point de vue. En revanche, celle qu’il faut encore mener, c’est celle de la qualité technique et il y a encore du chemin.
Qu’entendez-vous par qualité technique ? Sur quoi Radio France doit-elle s’améliorer ?
Joël Ronez : Il nous faut encore du temps pour avoir des sites et des applications qui marchent aussi bien qu’on le souhaiterait. Pour l’écoute de la radio sur mobile, les défis aujourd’hui, c’est la distribution sonore (quel format utiliser, améliorer la qualité des données associées) et notamment la qualité des interfaces, du design, la maîtrise de ces projets. Dans un contexte où les sous-traitants sont peu nombreux et très demandés, le cycle d’évolution et de contrôle est complexe. En fait, on a mis 2 ans et demi à rétablir une qualité correcte sur France Info, France Inter et sur une appli générique Radio France. Il faut maintenant faire la même chose sur 5 chaînes restantes. Ça c’est encore un travail important. On est soumis à des cycles, à des délais liés à la mise en concurrence aux achats qui évidemment sont nécessaires et légitimes – pas de doute là-dessus –, mais qui ont tendance à complexifier le processus de passation de marché et donc qui nous borde, nous contraint. On s’y est fait, on l’a intégré dans nos pratiques, et les dernières applications qu’on a mises en ligne, sont d’une qualité très compétitive, elles sont largement au niveau du marché. De même sur la question du marketing, pour le lancement et la promotion de ces applications, on est aussi à la pointe. On a bien fait le tour des questions possibles, on est enfin en mesure de se projeter, on est moins dans le gros-œuvre.
Y a-t-il encore des besoins en compétences à Radio France ?
Joël Ronez : Oui, en fait, on aurait besoin de plus de ressources sur la partie technique et on a des besoins importants sur les sujets « interface utilisateur », « ergonomie ». Aujourd’hui, on sous-traite ces aspects-là, mais il faut qu’on puisse les internaliser. Il faudrait aussi qu’on puisse intégrer la direction artistique. On a créé un pôle édition et qualité, direction artistique, mais ce pôle doit être un peu plus étoffé.
Quelle complémentarité y a-t-il entre l’offre linéaire et l’offre non linéaire ?
Joël Ronez : 12 % des utilisateurs écoutent la radio sur un terminal numérique mais ce n’est qu’une migration de consommation, ou un complément, c’est de la radio, c’est du podcast. En revanche, en non-linéaire, les formats qui se consomment le plus en podcast, ce sont d’une part les formats radiophoniques de stock, plutôt documentaires, entretiens, fictions, reportages, émissions liées à la connaissance et au savoir. C’est pour que ça que France Culture, ou même France Inter, marchent très bien en podcast. Nos top podcasts, c’est Les nouveaux chemins de la connaissance, La marche de l’histoire. Les chroniques aussi fonctionnent bien, des petits formats, les chroniques courtes, bien éditées. Également des formats – et on en a fait l’expérience avec Le Mouv’ – conçus pour être podcastés. Le premier des podcasts de la chaîne en règle générale, ce sont Les playlists du Mouv’, format musical de 30 minutes, diffusé la nuit, qui ne cible donc pas d’auditeurs, mais qui fait le record des podcasts sur le site et sur iTunes parce que cela a été conçu pour être podcasté, et toucher un public en non-linéaire. La qualité du succès, c’est toujours pareil, tient à la qualité du contenu et à l’exigence qu’on y met, ainsi qu’à la qualité de l’édition des données associées.
Qu’en est-il justement des données associées ?
Joël Ronez : C’est un défi ! Si vous avez 900 podcasts, vous devez créer des données d’accompagnement mais ça n’obéissait pas une fiche de poste, un workflow, un savoir-faire, etc. Au début, on décrivait les données autour des programmes pour 2 raisons : premièrement, pour les faire entrer dans une conduite numérique média, mais ça en fait il suffit de mettre sujet sport par exemple, car en fait c’est le technicien, le journaliste qui le lit et ils savent de quoi ça parle, ce sont des notions internes ; et deuxièmement, pour l’archivage notamment vers l’Ina. À ce moment-là, des équipes le faisaient en aval, soit pendant le processus de numérisation, soit maintenant postérieurement à la diffusion mais avec une nomenclature documentaire en conformité avec l’archivage Ina. Mais tout cela n’est pas pensé pour l’utilisateur qui a besoin de données éditoriales. L’indexation doit être faite pour comprendre ce qu’il y a à l’intérieur du sujet, pour pouvoir trouver le contenu via des moteurs de recherche.
La radio du futur, celle du numérique, il faudra qu’elle soit indexable, partageable et sécable.
La radio du futur, celle du numérique, devra être indexable, partageable et sécable.
Évidemment, ces 3 notions sont intimement liées. Vous ne pouvez pas partager si ce n’est pas sécable, vous ne pouvez pas indexer si ce n’est pas sécable, etc. Aujourd’hui, on fait nous-mêmes les coupes, et on décrit. Déjà pour cela, il a fallu créer un
workflow de production. C’est compliqué. Tantôt il faut que ce soit le technicien, tantôt l’attaché de production, tantôt le producteur, ou le journaliste : tout un tas de gens à qui on a donné mandat de le faire, préalablement, postérieurement, pendant. La qualité de nos données n’est pas encore là. Mais on va y arriver, parce qu’on va créer des référentiels, on va former. Si le podcast est mal édité, si la notice utilisateur est ratée, la qualité ressentie baisse et l’auditeur potentiel ne clique pas. La confiance que met l’utilisateur dans un produit est intimement liée à cette notion-là. Et là-dessus, il y a encore beaucoup de travail.
Quels sont les axes de travail sur la question du partage ?
Joël Ronez : À terme, il faudra que l’utilisateur puisse faire ses coupes lui-même, il faudra pouvoir personnaliser la découpe des contenus. Pour l’instant, l’utilisateur est obligé de recommander un contenu en précisant « écoute ça, à partir de 2 min 30 » ! C’est un peu le Moyen Âge. L’idée, c’est qu’il puisse choisir un point d’entrée et un point de sortie, le partager sur les réseaux sociaux et l’écouter sur ces réseaux sociaux. Le succès du partage sera aussi lié à notre capacité à faire vivre la radio dans un univers non-linéaire de recommandation, de partage et d’échange. Or la radio par définition c’est un média linéaire sonore, du coup on a enrichi cela d’images, de données associées, de capacité de coupes, des fonctions de partage.
Est-ce la DNM qui pilote les stratégies réseaux sociaux de chacune des chaînes ?
Joël Ronez : On pilote oui, si vous voulez, on oriente en tout cas, et on accompagne la croissance pour l’instant parce que l’intérêt des réseaux sociaux c’est qu’il s’agit d’une pratique assez répandue et qu’il est assez facile dans le savoir-faire d’un éditeur, d’un animateur, de l’intégrer dans sa pratique régulière avec une dose minimale de consignes. Ce qu’on fait c’est qu’on donne des consignes de charte typographique, on a nous une visibilité au pôle marketing sur l’ensemble des performances de toutes ces pages et on abonde avec des budgets d’achats de visibilité. Ça ne vous a pas échappé : on a un problème en ce moment, le
reach, la capacité de toucher les utilisateurs avec du contenu, avec la seule visibilité organique, a tendance à baisser. L’agorithme de
Facebook limite la visibilité. On était obligé, avant, à des fins de conquête d’audience, et on l’est maintenant, à des fins d’efficacité, d’acheter la visibilité pour pouvoir toucher ses propres fans. De manière organique, vous ne touchez que 7 à 8 % de vos fans. Quand vous avez 2 millions et demi de fans non dupliqués, ça fait déjà du monde, d’accord. Mais parfois, vous êtes quand même obligés de forcer un peu le destin. Il va falloir d’une manière ou d’une autre continuer dans ce sens, cela fait partie du marketing et de la distribution.
Profitez-vous de Facebook et Twitter pour augmenter l’interactivité des chaînes avec leurs auditeurs ? Comment intégrez-vous les réseaux sociaux dans les stratégies éditoriales, en mettant par exemple « les podcasts les plus partagés » en avant sur les home pages des sites ?
Joël Ronez : Le service public, c’est le marketing de l’offre. Donc si vous mettez en avant ce qui est déjà demandé, en règle générale, vous avez peu de surprises. Ce sera de l’insolite, « un castor a mordu un évêque », du grivois, « des photos des dessous de jupe des tenniswomen quand elles font leur service », ce sera ce genre de choses. Faut pas rêver. Après, si je sors de cette posture de provocation, il y a des centres d’intérêts réels. Les gens s’intéressent aux faits divers, aux sujets scientifiques, sur France Info par exemple, marchent bien les sujets volcans et planètes…La demande n’est pas composée que de bas instincts. Néanmoins, mettre en exergue ce qui fonctionne déjà, c’est quelque chose qu’on ne fait pas assez. C’est paradoxal, parce qu’il y a une culture de la performance à Radio France, les chaînes doivent faire de l’audience, et dans le même temps, il y a une culture qui fait que le succès est éminemment suspect. En fait, il faut trouver un juste milieu. Toutefois, sans être provocateur, je dirais que notre travail ça n’est quand même pas nécessairement de mettre en avant ce qui marche déjà. C’est de mettre en avant des choses auxquelles on croit et qui répondent à un cahier des charges. On va proposer des choses, c’est tout l’art et la difficulté pour faire nos programmes, que ce soit en radio ou en web. Il faut faire de l’audience avec des contenus qui ne sont pas une réponse à la demande, qui sont de l’offre pure, qui répondent à un cahier des charges. C’est pour cela que nos meilleurs podcasts, c’est de la philo, de l’histoire, etc. On va plutôt chercher à mettre ces points forts en avant, ce qui nous définit. Ça ne veut pas dire qu’on ne doit pas valoriser ce qui est populaire, sur France Info par exemple à la Une, vous avez les top 3 podcasts, sur la colonne de droite. Mais l’audience n’est pas le seul critère : il y a la notoriété, la longévité, la qualité du sujet de ce jour-là. Ça n’est pas seulement : plus le contenu est demandé, plus il est mis en avant. Car cela, ça a un effet pervers, c’est qu’évidemment cela fait toujours émerger les mêmes choses. On est obligé de maintenir un équilibre entre l’offre et la demande, en sachant que le service public c’est d’abord une question d’offre.
Ne pensez-vous pas que le numérique, c’est quand même aussi une opportunité de se rapprocher des auditeurs ?
Joël Ronez : On a 14 millions d’auditeurs par jour, on ne s’en éloigne pas ! Ce n’est pas parce qu’on va chercher des auditeurs avec nos programmes qu’on leur demande de nous dire ce qu’on doit faire. Dans la relation avec les auditeurs, on est quand même « plus égal » que les auditeurs, si je peux me permettre. Ça n’est pas une relation d’égal à égal, c’est une relation qui reste malgré tout celle d’un produit à son consommateur, celle d’un programme à son auditeur. Le participatif, ça compte beaucoup et la radio a toujours été interactive. Mais les gens attendent avant tout qu’on leur propose des contenus finis, qu’ils peuvent consommer de manière passive, que ce soit sur les sites, sur les applications ou à l’antenne. Quand vous allez au restaurant, ce n’est pas pour faire à manger. Quand vous allez au cinéma, vous voulez voir une œuvre finie, vous n’avez pas envie de faire le scénario. C’est pareil avec la radio. Tout l’art de la radio, qu’elle soit web ou hertzienne, consiste à concevoir un programme fédérateur,
Tout l’art de la radio, qu’elle soit web ou hertzienne, consiste à concevoir un programme fédérateur
qui rassemble le plus grand nombre de gens possibles, et – dans le cas du service public – qui respecte un cahier des charges et qui fasse découvrir des choses qui ne coïncident pas forcément avec la demande des gens. C’est ce qu’on fait avec la musique. La prescription, c’est le fait de faire découvrir.
La radio est-elle encore un média de découverte musicale ? Les plateformes YouTube, Deezer, Spotify et les réseaux sociaux ne sont-ils pas plus puissants sur la recommandation ?
Joël Ronez : Il y a une idée à laquelle je ne souscris pas, c’est l’idée selon laquelle le voisinage social pourrait remplacer aisément la compétence, le talent ou le savoir-faire. On parle de recommandation sur la musique, c’est un métier que celui de recommander de la musique. On parle de médias participatifs, mais on a jamais parlé de dentistes participatifs, ou de cordonniers citoyens. Il faut être sérieux. Ça ne veut pas dire que la mise en relation sociale ne peut pas être un point d’accès vers autre chose, comme dans la vie. Quand j’avais 14 ans, on s’échangeait des cassettes avec des amis, c’était le marché des doubles-cassettes, avec REC Play et des enregistreurs de cassettes rapides, c’était déjà de la recommandation sociale. Si on rapporte ça au numérique, la pratique demeure. Mais cela ne suffit pas. Mes amis m’ont fait découvrir leur discothèque, c’est bien, mais c’est limité et par ailleurs, ça ne remplacera jamais la capacité de quelqu’un de compétent, d’instruit, de professionnel qui peut proposer autre chose, il peut proposer un angle, une ouverture, un corpus d’explication, une mise en perspective. Avec un savoir-faire lié à la découverte. Tonton Roger peut vous faire découvrir Chostakovitch mais c’est vrai que Frédéric Lodéon est plus qualifié pour le faire.
Tonton Roger peut vous faire découvrir Chostakovitch mais c’est vrai que Frédéric Lodéon est plus qualifié pour le faire.
Ce n’est pas grave de se le dire ! Moi je ne crois pas à l’idée que le réseau social, que la proximité sociale vient à supplanter en qualité et tout court la recommandation. La recommandation c’est aussi une affaire de professionnels. C’est aussi pour cela qu’on va encore en centre-ville dans les librairies. Parce qu’outre la disponibilité, il y a un conseil. Dans le numérique, l’art c’est de faire vivre cette recommandation dans un nouvel univers. Le commerce en règle général, ça n’est pas que de disposer d’un stock, dans lequel des gens se promènent, c’est aussi être capable de faire le lien entre le produit et le consommateur. Là, il faut réinventer de nouvelles formes de prescription. La recommandation sociale et la découverte ne s’opposent pas mais ce sont des choses distinctes et complémentaires. Sur Spotify, super, je vois ce que les gens écoutent et les playlists qu’ils composent. En faisant cela, rien de nouveau, la recommandation de l’époque des K7 est juste déplacée dans l’univers du web. En revanche, cela ne suffit toujours pas, si je n’ai pas FIP pour découvrir des artistes. Il y a un circuit professionnel qui organise de la prescription. Il faut être capable de sélectionner. Savoir ce qui est bon et moins bon, et fabriquer une offre éditoriale destinée à fédérer, c’est un travail, ça ne s’improvise pas. C’est pour cela que le cinéma est supérieur à la vidéo du tonton des mariages. Parce qu’en fait c’est être capable de concevoir un produit fini, il s’agit bien d’un savoir-faire professionnel.
Aujourd’hui, comment faites-vous pour retenir les gens qui découvrent de la musique sur Deezer et Spotify plutôt que via FIP ?
Joël Ronez : Attention, avec
Deezer et Spotify, il y a deux dimensions : il y a le fichier, la disponibilité de la musique – leur catalogue en fait –, et vous avez ensuite la partie « recommandation sociale ». Idem avec
YouTube – aujourd’hui, premier prescripteur en musique. Je crois qu’il peut exister un autre modèle. D’abord vos amis peuvent avoir des goûts qui diffèrent des vôtres. Et il y a un autre souci, une partie de l’offre qui est de la webradio avec algorithme est souvent pensée pour qualifier les goûts d’une personne et pour essayer de la comprendre en rapprochant des thématiques. Si vous aimez le reggae, vous n’allez écouter que du reggae ou musique avoisinante, du dubstep, du dancehall, du ragga. Mais un amateur de reggae peut aimer les Clash et de la musique classique. Le goût ne peut pas uniquement se qualifier à travers une homogénéité thématique. Vous devez être capable de créer une rupture. C’est pour cela que sur FIP vous avez de la chanson française, du jazz, de la pop, de l’électro, du funk, du classique. La force du broadcast, c’est de proposer des choses à des gens qui ne les attendent pas. Faut être capable de faire vivre cela. Si vous allez sur des webradios, des smartradios algorithmiques, au bout d’un moment quand vous avez skippé ce que vous n’aimez pas, il tient compte de cela pour vous reconstruire un programme et vous êtes dans un environnement fermé qui ne vous donne plus que ce que vous aimez. Et vous tournez en rond. C’est comme si vous preniez perpétuellement le même plat au restaurant. Vous n’avez plus de goût.
Ceux qui concoivent aujourd’hui les algorithmes de recommandation tentent justement d’affiner le service pour qu’il soit le moins fermé possible, et que les contenus soient plus finement indexés.
Joël Ronez : Oui mais il y a une part d’irrationnel qu’on ne peut pas réduire avec un algorithme.
La prescription n’est pas réductible à la programmation.
La prescription n’est pas réductible à la programmation.
Vous avez aussi l’accompagnement, la capacité de percevoir un environnement culturel et des références, et d’enrichir la prescription en mettant le contenu en perspective. C’est cela qui crée la surprise et la rupture. Et pour cela, malheureusement les ordinateurs sont moins doués que les humains. Sauf sur la pure sérendipité, alors là, vous enchaînez des choses totalement contradictoires. Mais je crois tout de même que dans un monde d’abondance d’infos et de contenus, l’accès aux fichiers sonores et à l’archive n’est pas le problème. Entre YouTube, Spotify et Deezer, vous avez une bonne part du patrimoine musical, de l’ère des CD au moins, à disposition. Grosso modo, vous avez presque tout. En revanche, qu’est-ce que je vais chercher ? Je suis devant Deezer, qu’est-ce que je tape ? C’est là où la radio amène quelque chose de spécifique : la capacité de choisir et de proposer une sélection, avec la rareté. C’est une chose à la fois, ou sur le web mettons, c’est un petit nombre de choses à la fois. En radio, vous ne pouvez passer qu’un titre sur un canal. En web, la réponse a été RF8 : on passe huit titres sur une playlist, avec un nombre limité de playlists thématisées et arrangées.
Est-ce qu’il y a des exemples pour la radio web à l’étranger qui vous ont inspiré ?
Joël Ronez : Quand on innove, le principe consiste à inventer ce qui ne s’est pas fait. Donc je crois assez peu à la veille des concurrents pour savoir ce qu’on va faire soi-même. Il faut aussi puiser dans ses propres ressources et idées. Il faut d’abord partir de la compréhension du terrain sur lequel on se trouve, de la compréhension globale du marché et de notre cahier des charges. Intéressant en revanche, on est arrivé par exemple, sur certains sujets, aux mêmes résultats avec la
BBC, simultanément. Mais sans se concerter. On a découvert qu’on avait travaillé les uns et les autres sur des offres similaires. Ils ont lancé Playlister, c’est un RF8 mais sans l’écoute, à peu près en même temps que nous. En distribution, ils bénéficient d’investissements assez lourds qui ont été faits sur le i-player ; c’est un modèle inspirant. Parce que de notre côté sur la distribution, on a du mal à rationnaliser les coûts techniques, et à s’accorder sur des standards ergonomiques. Pour la vidéo, c’est simple, le standard est clair, c’est YouTube. Tandis que sur le son, il y a beaucoup de choses. Le iPlayer BBC et le radioplayer.uk (commun à toutes les radios) ont eu le mérite de créer un standard commun. Le radioplayer.uk, c’est un des projets les plus intéressants qui soient sur la distribution dans le secteur radio. On peut aussi citer ce qu’avait fait la RTBF avec PureFM (Pure Vision), qui est en fait un programme vidéo 24 heures sur 24, c’est l’équivalent du Mouv’. Ils fournissent un flux vidéo avec les clips synchronisés et la radio filmée automatique dans les studios. On a aussi beaucoup travaillé autour de ce projet-là qu’on trouve intéressant. On le fera au Mouv’ l’an prochain, du 24 heures sur 24 puis peut-être sur d’autres chaînes, en commençant par certaines tranches comme le 7/9 puis en élargissant au fur et à mesure.
Ensuite, je pense à un programme de la radio publique américaine NPR, This American Life, c’est le numéro 1 de la radio en syndication, c’est-à-dire que c’est repris après par les chaînes locales, et elle est numéro 1 sur iTunes. C’est un programme documentaire sur la société américaine, un exemple de contenu très inspirant qu’on aimerait refaire ici. Sur Nouvoson, l’offre Radio France en multicanal, en binaural, c’est une première mondiale dont on peut être fiers, car jusque-là, il n’existait rien d’équivalent.
Vous avez quitté Radio France en août dernier, quelles en sont les raisons ?
Joël Ronez : J'étais venu à la demande de Jean-Luc Hees pour une mission, celle de mettre l'entreprise sur les rails du numérique. J'estime que cette mission est accomplie, et qu'il appartient maintenant aux patrons des chaînes d'incarner le numérique, avec l'appui d'une direction support toujours centrale, cela va de soi. Cette réflexion est aussi valable pour moi : après avoir rempli le rôle de « M. Numérique » dans les médias « analogiques » depuis quelques années, je pense que l'on incarne jamais mieux le changement numérique que quand on est décideur d'un périmètre plus large que celui du numérique... Je vais donc à l'avenir plutôt m'employer à agir sur un spectre plus large que la seule question numérique.
--
Crédits photo :
Richard Trois / Flickr