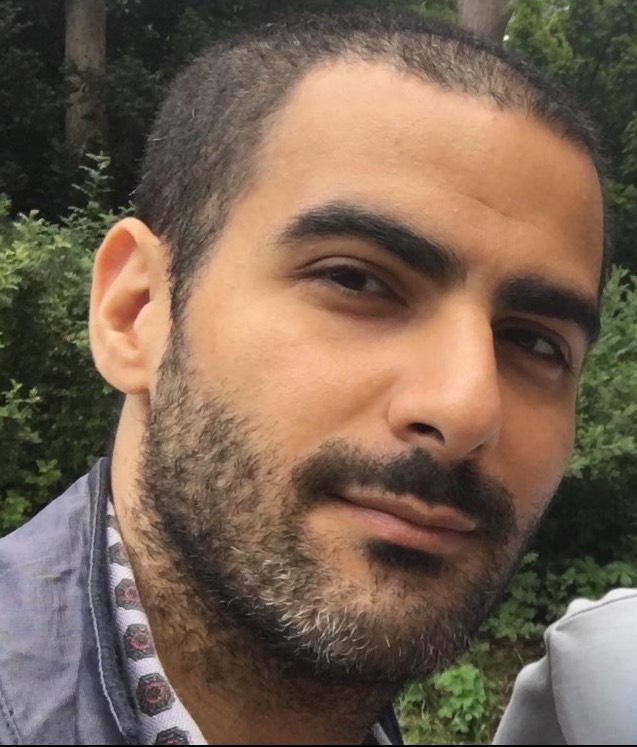Que ce soit dans la presse généraliste ou dans des débats universitaires, il est désormais impossible d’évoquer les technologies de l’information et de la communication sans parler d’ « usages » ou encore de « pratiques ». Employés le plus souvent comme synonymes, ces termes, qui renvoient à des approches différentes, ont récemment fait l’objet de tentatives d’articulation. Ainsi, Yves Jeanneret, professeur en sciences de l’information et de la communication au Celsa (Paris-IV), proposait en 2007 cette distinction entre l’« usage » et la « pratique » : « l'usage est un espace où s'ajustent les programmes d'activité développés par les sujets sociaux (individuels, mais socialisés, ou collectifs), avec les programmes d'activité sémiotisés dans les écrits : programmes inscrits dans les propriétés de l'architexte, programmes véhiculés par les réécritures dont ils se chargent, d'où se forment des traces d'usages (conservés, publicisés, anticipés). Mais si le travail d'écriture peut représenter des pratiques et donc les intégrer aux sphères de l'usage, il est loin de pouvoir saisir la totalité des pratiques. Si bien que tous les usages se comprennent par rapport à d'autres catégories, normes, valeurs. » .
Comprise ainsi, la pratique est l’actualisation de l’usage ; elle est ce qui échappe aux tentatives pour tracer les manipulations effectuées à partir d’un dispositif informatique. L’usage, lui, est ce qui s’inscrit dans ce dispositif, une fois qu’il est manipulé (soit les traces d’usage). Cette tension est à l’origine d’un chassé-croisé entre les concepteurs des logiciels et leurs usagers, qui peuvent manipuler différemment les fonctions canoniques d’un dispositif (un logiciel de présentation comme Prezi peut ainsi faire l’objet de
détournements créatifs ).
Chez d’autres auteurs, pourtant, l’usage remplit la fonction de la pratique. Elle se caractérise alors comme un ensemble d’activités stabilisées autour d’une même thématique (la pratique scripturale, par exemple), susceptible d’être déplacée par l’« usage », c’est-à-dire par la confrontation entre un individu et un objet technique (et ainsi, l’
usage du clavier et de l’ordinateur étend le sceptre de compétences de la
pratique d’écriture). Enfin, d’autres distinctions font de la pratique un principe d’émancipation de l’individu, quand l’usage, lui, ne ferait que réduire ce dernier à l’utilisateur, contraint par les «
modalités d’usage ». Or, dans la synthèse qu’il a consacrée à la notion d’ « usage » dans les études universitaires, Mathieu Potte-Bonneville fait au contraire remarquer qu’elle a plutôt servi jusque-là à rendre compte du degré d’appropriation des individus, capables de détourner les dispositifs.
Usages, pratiques : deux notions pour deux traditions disciplinaires
On voit ainsi combien les tentatives d’articulation entre les deux notions semblent hasardeuses tant elles sont contradictoires. Le recours à l’une ou l’autre trahit en fait, plus fondamentalement, des appartenances disciplinaires. En conclusion d’un livre sur l’écriture, auquel collaborèrent plusieurs chercheurs, Yves Jeanneret note ainsi :
Nous avons utilisé plusieurs terminologies, au fil du livre, pour caractériser ces échanges entre l'univers des pratiques et celui des écritures. Cela tient aux différences de parcours entre les tuteurs impliqués dans la recherche, qui ont construit leurs questionnements selon d'autres itinéraires. Certains risquent plus volontiers des “pratiques”, d'autres des “activités”, d'autres encore des “usages”.
La réversibilité des termes, qui n’a ici aucune conséquence (ils semblent synonymes), a cependant bénéficié de rapprochements entre les traditions d’analyse des « manières de faire », répartissables entre les « études d’usages » et les « études praxéologiques ». Or, l’une comme l’autre ont leurs propres méthodologies, leurs problématiques et leurs partis pris.
Comme le remarque Marcela Patrascu, plutôt favorable au second courant, « [o]n s’intéresse [avec les études d’usages] à ce que les usagers font avec les objets techniques, à leur “arts de faire”, à leur capacité à détourner les usages prescrits, etc. » Yves Jeanneret déplore cependant le caractère prévisible des résultats qui en découlent, inévitablement partagés entre les mécanismes panoptiques et les « ruses » de l’usager : « ce processus de reformulation aboutit à un usage extrêmement répétitif et prédictible de la théorie, à l’opposé du style d’investigation de Certeau. On vérifiera, au bénéfice de multiples intérêts, que décidément, les usagers sont incroyablement inventifs et qu’ils parviennent à s’affranchir des dispositifs. »
La problématique de l’usage est le sujet par excellence de la philosophie foucaldienne
Cette dialectique, qui a survécu, est surtout propre à une première étape dans l’histoire des études d’usages, qui articulèrent les travaux de Michel de Certeau sur les « arts de faire » et ceux de Michel Foucault. La problématique de l’usage est en effet le sujet par excellence de la philosophie foucaldienne. Si la notion est devenue un lieu commun, elle désigne chez le penseur une « pratique réglée, fondamentalement contrainte ». Mais l’usage est en même temps « un espace de liberté vis-à-vis de ce que je trouve ». C’est « ce que j’ai sous la main » mais « jamais entièrement défini par ce dont il est fait usage ». Or, « [l]es origines de la sociologie des usages se sont [en effet] inscrites dans l’effervescence des nouvelles sociologies de l’après 68, de la critique des phénomènes de domination sociale et de l’accent mis sur l’émancipation des individus. » selon Josiane Jouët. Ainsi, la plupart des premières études d’usages (1980-1995) ont consisté à mesurer un écart entre l’usage prescrit (par un logiciel, par exemple) et l’usage effectif (ce que l’utilisateur fait vraiment). La « configuration de l’usager » de Steve Woolgar trouva ainsi en France des développements proches à travers le « cadre de fonctionnement » de Patrice Flichy, l’utilisation « disciplinée » de Laurent Thévenot, la «
double médiation » de Josiane Jouët (l’outil structure l’usage mais la pratique se ressource dans le corps social) ou encore le «
script » de Madeleine Akrich (un scénario anticipe les usages du dispositif). Enfin, à l’inverse de Woolgar, la fameuse notion d’ «
affordance » de Gibson actualisée par Thierry Bardini refuse de faire d’un dispositif un texte qu’il suffirait de lire : elle accorde au contraire à l’usager la capacité d’interprétation, c’est-à-dire la possibilité d’utilisations très variées selon des buts. C’est ainsi dans un jeu permanent de réglages entre l’usager imaginé par le concepteur et le concepteur imaginé par l’usager qu’émerge le dispositif technique.
Les études d’usages durant cette période (1980-1995) opposèrent également aux discours euphorisants sur la technologie, une critique universitaire distanciée. D’où la promotion d’une alphabétisation informatique « comme une source possible d’autonomie pour les personnes et d’émancipation sociale et politique pour les groupes ». La critique se poursuit manifestement aujourd’hui à travers la mise au jour de l’idéologie capitaliste néo-libérale et de celle du « Web 2.0 » (notamment en sciences de l’information et de la communication).
L’usager est toujours capable de déplacement, d’adaptation, de détournement
La seconde étape (1995-2010) repérée par Jaureguiberry et Proulx hérita manifestement des travaux de la première. Pour le « HCI » (Human-Computer Interaction), les usages sont par exemple contraints par l’offre industrielle qui suggère un mode d’emploi et impose des normes. Mais l’usager est toujours capable de déplacement, d’adaptation, de détournement, comme l’ont bien montré les travaux de
Madeleine Akrich. Si les approches se sont diversifiées depuis les années 1980 (le dispositif est ainsi plutôt considéré aujourd’hui comme une « ressource pour l’action » et ne fait plus systématiquement l’objet de critiques), elles continuent de mettre au centre de leurs analyses cette figure de l’usager, « actif, [qui] bricole, développe des stratégies pour contourner la “
toute puissance” des informations médiatisées. »
En se focalisant sur l’usager, on ne regarde qu’un côté des choses
Marcela Patrascu regrettait ainsi en 2011 que le projecteur soit encore essentiellement braqué sur l’usager : « on ne regarde que la moitié des phénomènes, qu’un côté des choses » . La tradition pratique traite alors les « manières de faire » selon d’autres axes méthodologiques et en évitant, comme le souhaitait Bourdieu en 1994, les oppositions binaires (sujet/objet, individu/société, objectif/subjectif, etc.). Plusieurs synthèses ont été proposées sur sa généalogie et ses lieux actuels d’exercice dont rend compte Barbara Simpson (professeur à Strathclyde Business School) dans
un article récent. Ainsi, selon Richard J. Bernstein, c’est à la fin du XIX
e siècle et au début du XX
e siècle que s’élabore une théorie moderne de la pratique, à partir du marxisme, de l’existentialisme, du pragmatisme et de la philosophie analytique. La réélaboration de l’héritage philosophique par les sciences humaines se serait néanmoins d’abord faite à partir du dualisme précédemment rencontré (liberté et volonté de l’acteur d’une part, déterminisme et contraintes d’autre part). Mais un véritable « tournant pratique » a irrigué les recherches depuis une vingtaine d’années qui a permis de sortir de cette ligne de partage. Selon Theodore R. Schatzki, l’un des directeurs de l’ouvrage
The practice Turn in Contemporary Theory (2001), trois catégories de travaux ont bénéficié des apports des théories pratiques : la science des organisations (comment les structures sociales assurent-elles leur durabilité et leur stabilité ?), la micro-analyse de l’activité humaine (comment des acteurs avec des représentations différentes parviennent à coopérer ?), le constructivisme et les «
science and technology studies » (comment les objets interviennent dans les interactions entre acteurs ?).
Dans cette perspective, les pratiques sont comprises comme des processus ou des mouvements dynamiques tiraillés entre l’individu, le social et des entités non humaines. L’usager n’est donc plus au centre des analyses, mais envisagé dans une situation où interagissent entre eux des acteurs de nature différente (la molécule que manipule le scientifique pourra ainsi être dotée d’une « agentivité », c’est-à-dire d’un pouvoir d’action qui amène tout un laboratoire à mobiliser des moyens et à s’organiser à partir de sa manipulation). Or, ce « simple » déplacement épistémologique (qui est aussi un saut cognitif) peut conduire à d’heureuses découvertures. En se focalisant par exemple sur le « mode d’existence » des annotations d’un groupe d’étudiants en humanités, Marie-Ève Bélanger a pu mettre au jour l’ensemble des opérations (intellectuelles, sociales, matérielles) et des instruments nécessaires à leur production, à leur circulation et à leur archivage, alors qu’elles étaient jusque-là analysées sous un angle essentiellement formel. L’attention donnée à la temporalité de l’action permet ainsi de penser les objets de la connaissance dans un cycle de transformations. Agir, c’est donc organiser ces objets en leur appliquant un ensemble de procédures qui permettent d’anticiper les formes qu’elles prendront successivement selon les buts envisagés.
Le nomadisme conceptuel, qui conduit une discipline universitaire à emprunter une notion à une autre discipline, atténue cependant la frontière entre les études d’usages et les études praxéologiques. Ainsi le livre Lire, écrire, récrire, qui se réclame pourtant des premières, en vient à réfléchir à la transformation des objets et à comprendre l’usage comme une « notion hétérogène, complexe, qui a le mérite de saisir des processus hétérogènes et complexes ». S’ils se rapprochent, les deux termes devraient cependant faire l’objet de réélaborations, en vertu d’un champ universitaire dont la survie dépend du dynamisme de ses controverses.
--
Crédit photo
Fabien Artus /
Flickr