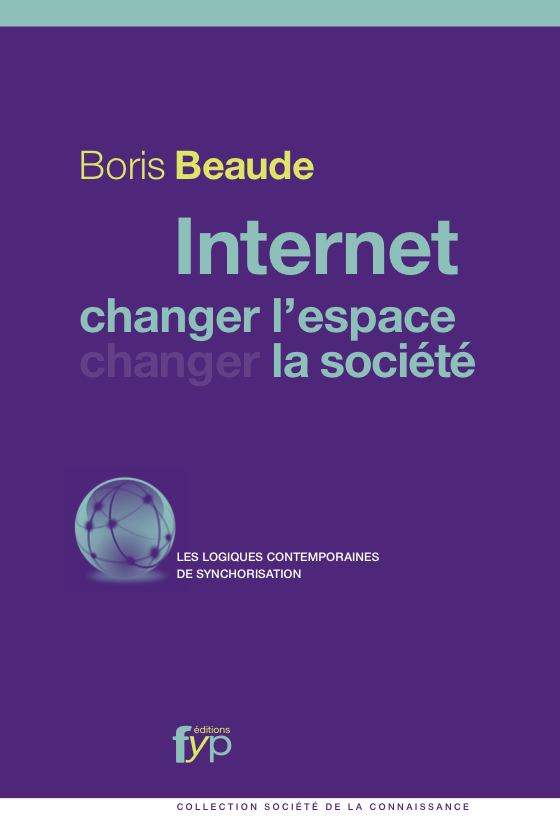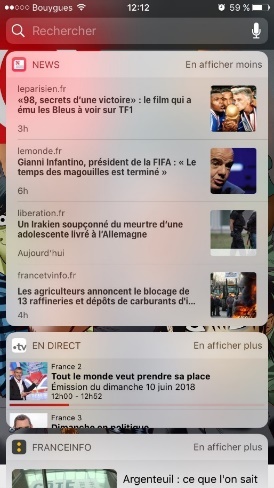
Un crédo : opacité et arbitraire
L’intégration verticale des contenus pour s’assurer une clientèle captive
De quoi Apple News France est-il le symptôme ?
Paris Match voit fondre ses audiences de 25 %Suivant la même logique, sans savoir exactement comment et pourquoi ils avaient été référencés par la plateforme à son lancement, Marianne, Paris Match et France 24 ont bénéficié de la puissance de feu d’Apple News. Installée sur tous les écrans d’accueil d’iPhone et d’iPad, elle vise une audience potentielle – en France – de plus de dix millions d’utilisateurs ; « autant de personnes que Tf1, France 2, et M6 réunies, à une heure de grande écoute » précise la vitupération du journaliste de Marianne. Une aubaine pour la vingtaine de « happy few » ; les visites engendrées par la présence d’articles dans ce widget ont pu représenter 30 à 40 % de l’audience de certains médias. Mais le cadeau est empoisonné. Après quelques mois de dolce vita, en octobre 2017, Apple décide unilatéralement et sans explication de revoir la composition de sa liste des médias. C’est l’hécatombe. Moins 35 % de trafic en un mois pour France 24, même chose pour Marianne, Paris Match voit fondre ses audiences de 25 %. Et les revenus publicitaires suivent évidemment la même courbe. De Marianne à Little Things, ces cas sont symptomatiques de la dépendance et de l’asservissement des médias aux plateformes mobiles et socionumériques.
Apple, Google et la presse : des outils partiaux, révélateurs de visions stratégiques divergentes
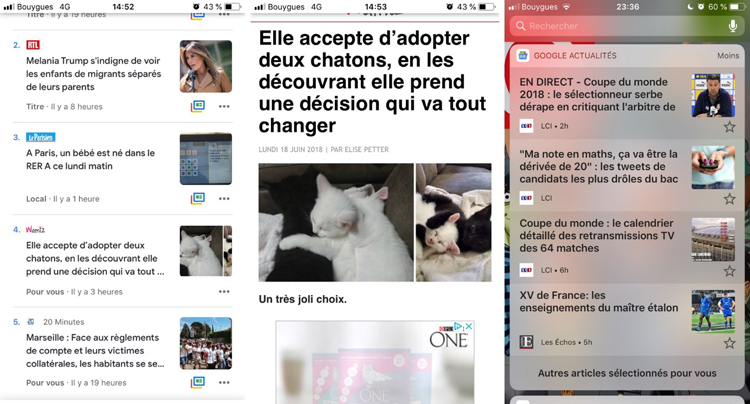
On peut s’interroger sur le débat qui pourrait s’engager autour du problème que soulève l’adoption de chatons inséparablesAu-delà de la duplication éditoriale, la même opacité sur les modalités de curation et de référencement est appliquée par les deux acteurs. Opacité qui s’applique par ailleurs aussi bien aux médias qu’aux utilisateurs. En effet, dans les deux cas, il est impossible pour l’utilisateur de paramétrer ces applications ou le widget, par exemple pour choisir les titres desquels il souhaite se voir proposer des articles. Pas de personnalisation, pas de recherche non plus dans ces outils fermés. Apple News n’introduit qu’une variable, celle de la géolocalisation qui active l’affichage d’un article issu de la PQR. Google justifie cela par une volonté d’éviter la fameuse bulle de filtres que l’on a tant reprochée à Netflix et aux réseaux socionumériques. Offrir le même résultat de curation à tous permettrait ainsi d’élargir le débat. Si on leur pardonne de réinventer le concept de médias de masse, on peut s’interroger sur la teneur du débat qui pourrait s’engager autour du problème public que soulève l’adoption inopinée de chatons inséparables…
La tentation de l’éditorialisation
--
Crédit photo :
Ina - Didier Allard

L’article de Marianne conclut par exemple sur « la peur de déplaire » et expose la propension des grands cadres des groupes de presse à ne concéder à critiquer ces méthodes que sous couvert d’anonymat. Nos travaux de thèse avaient également permis de recueillir des témoignages du même ordre s’agissant de la publication d’applications.

L’accord permet aux éditeurs d’accéder aux outils de Google dans des conditions attractives et prévoit un fond de modernisation et d’innovation pour la presse en ligne d’un montant de 60 millions d’euros. Cet accord a été conclu après que les éditeurs ont réclamé l’établissement d’un droit voisin, c’est-à-dire un reversement aux éditeurs et journalistes d’une part des revenus récoltés par Google, grâce à l’indexation des contenus de presse auxquels le moteur de recherche ne contribue pas financièrement.

La tentative d’effraction d’Apple dans le domaine de la publicité a échoué. Apple lance iAd en 2010, une régie publicitaire « premium » visant à proposer aux annonceurs sur iPhone des formules publicitaires dignes de la télévision et intégrant une forte interactivité avec l’utilisateur. Quelques marques de luxe s’y sont essayées, aux prix d’un ticket d’entrée fixé à 1 million de dollars, d’un CPM (Coût Pour Mille) à 10$ et d’un clic facturé 2$. Les factures étant deux à trois fois plus élevées que la moyenne du web mobile, la régie n’a pas dépassé les 2,6 % de part de marché et a cessé ses activités en 2016.
À lire également
Internet, un espace bien réel
Boris Beaude décrit Internet comme un espace bien réel, avec des particularismes géographiques propres. Mais au-delà d'un simple exercice conceptuel, l'auteur décrypte les enjeux sous-jacents à la maîtrise du net par les acteurs mondiaux majeurs et appelle à une politisation de cet espace commun.
Facebook, ami public numéro 1 - épisode /8
Je like, tu comment, il share : comment se partage l'info sur Facebook ?
Comment discute-t-on de l'actualité sur Facebook ? Le clic est-il une prise de parole ? Irène Bastard étudie ces questions dans le cadre de sa thèse chez Orange Labs et Télécom ParisTech.