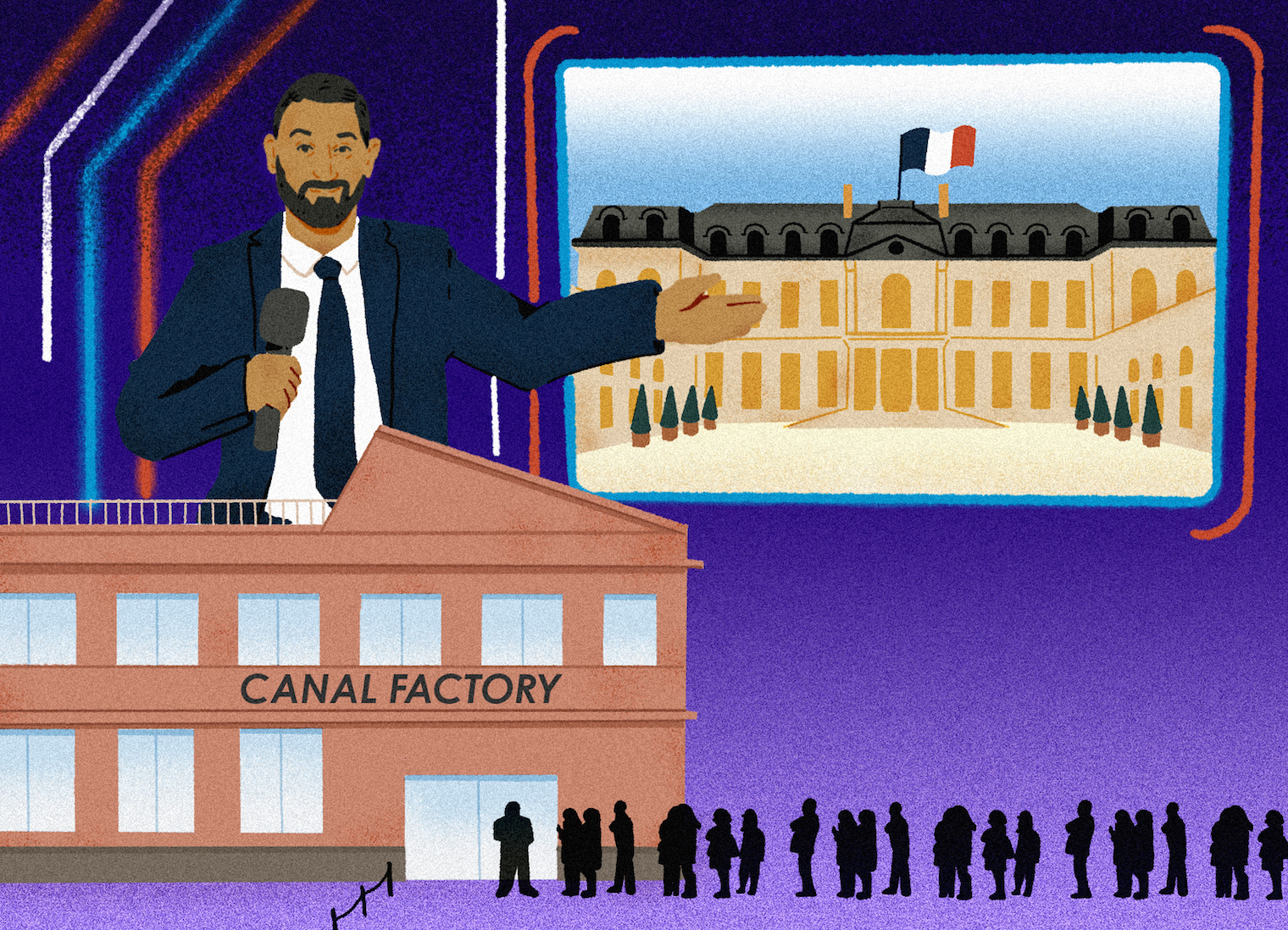Le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein ? The New York Times, créé en 1851 dans la bataille pour l’abolition de l’esclavage, est-il sur la voie du succès, ou vient-il de s’engager dans une voie sans issue ? Quand « la vieille dame grise » tousse, c’est toute la profession qui est malade. Mais si elle reprend des couleurs, les patrons de presse recommencent à espérer.
Au mois de mai, le limogeage de la directrice de sa rédaction, Jill Abramson, et la divulgation d’un rapport interne alarmiste ont envoyé des signaux négatifs, mais, par ailleurs, les résultats de sa transition vers le numérique sont encourageants. Ils sont du moins parmi les meilleurs que l’on connaisse pour ce type de publication. L’éviction brutale de la patronne du journal est-elle due à l’autoritarisme qu’on lui reprochait ? Au sexisme indécrottable qui suscite souvent ce genre de critique à l’encontre des femmes de caractère ? Ou à un désaccord stratégique avec le patron, Arthur O. Sulzberger Jr., sur la nécessité d’un tournant radical ? Pour beaucoup, la mise à l’écart d’une journaliste trop « traditionnelle » a été le révélateur des problèmes d’un journal qui ne peut pas se permettre de rester au milieu du gué.
Un bilan exceptionnel
De toute façon, en 2014, le quotidien le plus prestigieux du monde a vécu son année de tous les dangers, et de tous les espoirs. Les espoirs, d’abord : ils se nourrissent de bons résultats. Non seulement le NYT a raflé quatre prix Pulitzer en 2013 (un record depuis 2009), mais surtout, pour la première fois, au début de cette année, le nombre de ses abonnés en ligne a dépassé celui des abonnés au journal papier (731 000 abonnés « print » contre 799 000 abonnés web fin 2013). En juillet 2014, on compte même 831 000 abonnés numériques, dont 12 % d’abonnés étrangers (35 % des visiteurs uniques sont d’ailleurs hors États-Unis). De plus, 90 % des lecteurs papier ont aussi choisi l’option digitale, ce qui constitue un moyen d’identifier avec précision les choix et les habitudes de ces lecteurs. Grâce à News Analytics, un système mis au point en avril 2013, les responsables du marketing peuvent savoir avec précision comment les lecteurs lisent et naviguent, combien de temps ils passent sur un article, etc. La moyenne d’âge des lecteurs, si elle ne traduit pas un jeunisme exceptionnel, reste assez bonne : 52 ans pour le print et 47 ans pour le numérique (beaucoup d’éditeurs de journaux français s’en féliciteraient).
Le chiffre d’affaires provenant de la diffusion continue de croître grâce à l’augmentation du prix de vente du journal papier (il a été doublé en dix ans, 2,50 dollars en semaine et 5 ou 6 dollars pour l’édition dominicale), même si le chiffre d’affaires global se contracte du fait de la baisse des revenus de la publicité. Fin 2013, 56 % du chiffre d’affaires provenaient des lecteurs, signalant que le vieux modèle fondé essentiellement sur la publicité était peut-être dépassé. Certains analystes de l’évolution des médias estiment que le NYT pourrait bien être le premier quotidien à avoir réussi sa transition vers le numérique.
Au bord du gouffre
Il faut dire que le journal revient de loin. En dix ans, le groupe de presse, dont la valeur était estimée à 6 milliards de dollars, s’est délesté de la plupart de ses activités pour ne conserver que le quotidien dont la valeur est estimée à 1 milliard (chiffre qui peut être discuté si on se rappelle que son concurrent, The Washington Post, a été racheté, en août 2013, par Jeff Bezos, pour seulement 250 millions de dollars). Pendant cette décennie noire, le NYT lui-même s’est séparé de dix pour cent de son personnel (il compte encore près de 1 200 journalistes) et a revendu ses autres activités, notamment le groupe du Boston Globe pour 70 millions de dollars (il l’avait acheté 1,1 milliard en 1993. Une extraordinaire perte de valeur).
Comme tous ses confrères il a constaté l’effritement de son lectorat (entre 2009 et 2012, le journal papier a perdu 100 000 acheteurs) et l’effondrement des revenus publicitaires. Au point que pour boucler ses fins de mois en 2009, il a dû emprunter 250 millions de dollars au taux usuraire de 14 % l’an au milliardaire mexicain Carlos Slim, qui a rêvé, un temps, de prendre le contrôle du quotidien. Suprême humiliation, le NYT a même dû revendre son magnifique immeuble, commandé au temps de sa splendeur à l’architecte Renzo Piano, en plein coeur de Manhattan, pour n’en relouer que quelques étages.
Mais la famille Sulzberger, qui possède toujours la majorité de contrôle, a tenu bon dans la tempête. Refusant de sacrifier sa rédaction comme l’ont fait nombre de ses confrères, elle a choisi de tout faire pour que le Times demeure le principal journal de référence au monde (on estime que son lectorat total approche les 50 millions d’individus !), un quotidien dont la forte valeur ajoutée est liée à la qualité du travail journalistique. Encore a-t-il dû, pour cela, savoir changer de modèle économique, technologique et peut-être journalistique. Il fallait que tout change pour que rien ne change.
Le pari gagné du paywall
Le premier pari a été celui de l’Internet payant. Le paywall, système de paiement au compteur (metered) lancé il y a sept ans, à un moment où la plupart des « experts » ne juraient encore que par le gratuit et la course à l’audience, s’est révélé la meilleure des initiatives. Avec ce système, le lecteur a droit à vingt articles gratuits par mois (aujourd’hui ce n’est plus que dix), ensuite il doit s’abonner s’il veut continuer à lire le journal. Les chiffres ci-dessus montrent que le pari a été gagné. L’offre d’abonnement est sensiblement moins chère que pour le journal papier et, surtout, elle est diversifiée. On peut s’abonner à différents tarifs (de 15 à 35 dollars par mois) ou à des offres limitées (comme le tout récent NYTNow qui vise un public jeune, avec une application pour mobiles à 2 dollars par semaine ou NYTOpinions, pour ne recevoir que les Op. Ed., les tribunes, qui ont fait une part de la renommée du journal). Un site premium, Times Premier, pour ceux qui sont prêts à payer 45 dollars pour quatre semaines afin d’être considérés comme des VIP, offre quelques privilèges comme les vidéos des débats organisés par le journal (TimesTalk), l’utilisation de Times Insider qui fournit un accès à l’activité de la rédaction ou à tous les contenus sur n’importe quel support. Des offres plus ciblées, comme le site consacré à la cuisine (Food and dining) ou The Scoop, dédié à la vie new-yorkaise dans tous ses aspects, doivent diversifier l’offre et attirer les annonceurs (NYTNow a inauguré la pratique des native ads, ce qu’on appelait traditionnellement le publirédactionnel ou le sponsoring).
Enfin, les différents abonnements offrent, via Times Machine, un accès, plus ou moins ouvert selon le tarif, à l’une des richesses du journal, ses archives, 14,7 millions d’articles publiés depuis 1851.
Une autre particularité, qui a contribué au succès de la stratégie digitale du NYT, tient au fait que, contrairement à celui de la plupart de ses concurrents, son mur est relativement poreux. Ainsi, en passant par un moteur de recherche, l’internaute peut-il contourner le paywall et accéder gratuitement à la plupart des articles.
En passant par un moteur de recherche, l’internaute peut contourner le paywall et accéder gratuitement à la plupart des articles.
De même il est facile de se procurer les articles sans rien payer sur les réseaux sociaux. Beaucoup de lecteurs du Times trichent de cette manière, mais les équipes marketing du quotidien, qui le savent très bien, ne font rien pour l’empêcher. Au contraire, semble-t-il. Elles parient sur le fait que ces visiteurs « pirates », qui constituent une audience utile pour vendre le site aux annonceurs, finiront aussi par s’abonner. Elles savent aussi qu’un journal peut difficilement se fermer complètement sous peine d’être oublié par les internautes (le Financial Times a fait le pari inverse avec succès, mais la moitié de ses abonnés sont « corporate »).
Une grande visibilité sur l’Internet est un moyen, somme toute peu onéreux, de recruter de nouveaux abonnés. À l’occasion d’événements exceptionnels – tornade ou élection présidentielle – le mur a même été complètement abaissé pendant quelques jours. Cette porosité permet de garder une audience globale importante, que le journal prenait le risque de voir s’effondrer en abandonnant le tout-gratuit, et ainsi de justifier des tarifs publicitaires élevés. C’est la stratégie de l’entonnoir : l’ouverture est suffisamment large pour attirer beaucoup de gens vers le goulot de l’abonnement.
Des mots aux images
Le Times a également fait un effort remarquable pour développer son offre vidéo. Paradoxalement, ce quotidien qui a toujours valorisé le texte (il a été un des derniers, aux États-Unis, à publier des photos en couleur) a su investir lourdement dans ce secteur. Il a fait sensation, en décembre 2012, avec un long documentaire, Snow Fall, consacré au récit d’un accident de montagne et d’une avalanche, mêlant texte, photos et vidéos. Le résultat est spectaculaire, très beau et très documenté, même s’il a fallu six mois de travail à une équipe d’une quinzaine de personnes pour le réaliser. Cette année-là, ce « chef-d’œuvre du journalisme multimédia » a remporté un prix Pulitzer. Depuis, d’autres productions semblables ont vu le jour comme The Jockey, remarquable enquête-portrait de Russell Blaze, premier Nord-Américain à avoir participé à 50 000 courses. Et, cette fois, le reportage multimédia est sponsorisé par le constructeur automobile BMW.
The New York Times offre aussi chaque jour plusieurs petits reportages vidéo – 430 vidéos par mois en 2014 – signalant que l’avenir du prestigieux quotidien passera de plus en plus par l’image. Dans le même esprit, il développe encore une stratégie tablet first, produisant une série de documentaires en plusieurs épisodes conçus spécialement pour les tablettes avec lesquels le lecteur – le terme a-t-il encore un sens? – peut interagir au moyen de l’écran tactile.
À la pointe de l’innovation
Depuis de nombreuses années, le NYT a consacré beaucoup d’efforts et de moyens à la recherche et aux innovations technologiques. Dans les années 1980, il est un des tout premiers journaux à inaugurer une transmission électronique de ses contenus… par fax. Puis il expérimente les visiotextes, envoyant le journal sur des terminaux installés dans les grands hôtels et dans quelques entreprises et, en 1983, avec The New York Pulse, il inaugure les premières transmissions via Internet. Il recrute une rédaction de 25 journalistes et d’une douzaine de techniciens, mais le Pulse n’aura jamais plus de 250 abonnés et il cessera de paraître en 1986.
Il faudra attendre encore dix ans pour voir le lancement du premier site en ligne, le 22 juin 1996, qui produit très vite des contenus originaux. En 1999, le NYT lance le Continuous News Desk, premier véritable effort pour associer les deux rédactions, web et print, une association qui fera la démonstration de son efficacité lors des attentats du 11 septembre 2001. Mais la rédaction du quotidien demeure encore réticente et beaucoup de journalistes refusent de collaborer au site. C’est seulement en 2005 que Bill Keller, alors à la tête du journal, réussit à imposer la fusion des deux rédactions qui devient totalement effective en 2007, après le déménagement du journal dans ses nouveaux locaux de la Huitième Avenue.
La philosophie du Times en matière d’innovation correspond à l’approche dite « fail fast » qui vise à repérer rapidement les erreurs et à abandonner ce qui ne marche pas. Ainsi, en 2008, il lance Times Extra, un système d’agrégation des informations scoops d’autres sites qui, ne décollant pas, est arrêté au bout d’un an. De même, il multiplie les expériences avec les blogs, stimulant le blogging hyperlocal, avant de l’abandonner. Une première tentative pour faire payer les lecteurs en ligne des Op. Ed., est stoppée au bout d’un an. Au début de l’été 2014, il a également annoncé qu’il allait diminuer, probablement de moitié, le nombre des blogs qu’il accueille sur son site, en raison du nombre trop faible de visiteurs.
Ces échecs ne l’empêchent pas de multiplier les initiatives. Au contraire. En 2011, il a lancé un site d’annonces matrimoniales en vidéo produites par les internautes, puis un show télévisé hebdomadaire, un lifestyle pour New York, des miniséries d’informations quotidiennes, etc.
Il consacre parallèlement beaucoup d’efforts à la recherche technologique. Son Research and Development Group travaille notamment à l’adaptation de ses productions aux nouveaux appareils et aux nouvelles ressources (écrans tactiles, réalité augmentée, nouveaux écrans de télévision, recherche sémantique ou nouvelles technologies publicitaires). En 2013, il inaugure TimeSpace, une pépinière de médias start-up, et il vient de lancer une plateforme de native advertising (en assurant que la rédaction n’y serait impliquée en aucune manière) conçue par Brand Studio, une nouvelle unité dédiée à la réalisation de ce genre de publicité pour les annonceurs. Décidé à inventer de nouvelles sources de financement, il a détaché de son centre Recherche et Développement une équipe spéciale, Idea Lab, regroupée au seizième étage de son immeuble et chargée de créer de nouveaux produits pour les annonceurs.
Dernière innovation en date : une collaboration avec un de ses concurrents directs. En effet, le Times s’est associé, au printemps dernier, au projet baptisé OpenNews, visant à créer une nouvelle plateforme de commentaires, une « plateforme pour les lecteurs » dont la moindre originalité n’est pas son développement en collaboration avec The Washington Post et Mozilla financé par la Knight Foundation à hauteur de 3,89 millions de dollars.
Des ombres au tableau
Les excellents résultats des abonnements sur Internet font donc espérer une transition heureuse du papier vers le numérique, et du vieux modèle fondé sur la publicité à un nouveau modèle alimenté par l’argent des lecteurs. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres.
En effet, les résultats de 2014 ont envoyé quelques signaux inquiétants. Non seulement la diffusion du journal imprimé continue régulièrement de décroître, non seulement le chiffre d’affaires publicitaire print se tasse, mais des signes de faiblesse apparaissent du côté du digital. La croissance des abonnements en ligne, spectaculaire au début, ralentit. Pis, les nouvelles offres d’abonnement et les nouveaux services lancés en 2013-2014 n’ont pas donné les résultats escomptés, même si la direction du Times demeure discrète sur le sujet. Mais, quand le PDG du groupe, Mark Thomson déclare, en juillet 2014 : « Bien que nous nous attendions à ce que le portefeuille mette du temps à se constituer, nous voulons accélérer le rythme de croissance des abonnements, et donc, dans les prochains mois, nous allons redéfinir nos offres et la manière de markéter le portefeuille pour y arriver», les analystes traduisent cette langue de bois managériale par : « c’est raté » La question est désormais de savoir si les abonnements en ligne sont eux aussi en train d’atteindre un plafond.
Et ce n’est pas tout. Le chiffre d’affaires de la publicité stagne sur le papier mais aussi, et c’est plus grave, sur Internet. Le site du Times a beau être parmi les leaders mondiaux en termes de fréquentation, il souffre de la concurrence des « géants » du Net et des sites commerciaux qui se multiplient. Cette extension du domaine de la pub en ligne a une autre conséquence négative : une baisse tendancielle des tarifs. En dépit d’une croissance en volume (3 % au premier semestre 2014) le chiffre d’affaires ne suit pas. Une bonne nouvelle pour les annonceurs, une mauvaise pour les médias.
La baisse de la diffusion du journal papier est une autre source d’alarme. Elle semble indiquer que la politique d’augmentation des prix a atteint un seuil. Il ne va bientôt plus être possible d’y recourir pour rééquilibrer le chiffre d’affaires. Du moins, pour l’instant. « Les revenus générés par les augmentations de tarif ne compensent pas le déclin de la diffusion, écrit Ryan Chittum, et les profits du digital ne sont pas suffisants pour rééquilibrer. »
Un rapport qui effraie la profession
Est-ce un hasard ? Quelques jours seulement avant le limogeage de Jill Abramson, un rapport interne du New York Times fuite sur le site BuzzFeed. Une centaine de pages plutôt inquiètes, sinon inquiétantes, consacrées à la question de l’innovation et aux retards qu’enregistrerait le quotidien. Il a été rédigé par une petite équipe au sein de laquelle on retrouve Arthur Gregg Sulzberger, le propre fils du patron, ce qui accentue son importance.
Dès les premières pages, les auteurs insistent sur le fait que le NYT en dépit de tous ses efforts, demeure plombé par ses vieilles habitudes, trop lent dans ses transformations et marqué par une culture du journalisme traditionnel, un « frein culturel » qui l’empêche de prendre le tournant complet vers le numérique. Quand on a vu tous les efforts accomplis, on reste un peu étonné d’un tel constat. Si The New York Times est en retard, alors que dire des autres ?
D’autant qu’on connaît peu d’autres groupes médiatiques capables d’une telle introspection, d’un tel regard critique sur leurs activités. Et même, en vérité, on n’en connaît pas. Et l’existence de ce rapport prouve, au moins, que ce journal a encore du ressort et des ambitions.
L’idée générale de ce travail est celle-ci : « Au cours des prochaines années, The New York Times a besoin d’accélérer sa transition, du statut de journal produisant également une information numérique riche et de qualité, à celui de publication numérique produisant aussi un journal riche et de qualité. Ce n’est pas un jeu de mots. C’est une transformation radicale, difficile et, parfois, douloureuse qui implique que nous repensions beaucoup de ce que nous faisons quotidiennement » (p. 81). Gregg Sulzberger ajoute que les concurrents du NYT « le devancent nettement pour fournir des systèmes efficients aux journalistes numériques, et [que] le fossé va vite s’élargir si nous n’améliorons pas très vite nos performances. D’autant que notre avantage journalistique se réduit » face à des pure players qui recrutent de véritables rédactions. « Nous n’avançons pas avec un sentiment d’urgence suffisant », conclut le fils du patron.
Comme illustration des bouleversements nécessaires, le rapport souligne que la homepage, la une du site, a perdu de son importance, car les internautes, pour les deux tiers d’entre eux, n’arrivent plus sur le site par cette porte. Et ceux qui y passent y restent de moins en moins longtemps. Et pourtant, au sein de la rédaction, la homepage reste encore le mètre-étalon de la hiérarchie de l’information.
Autre signe du retard : la faiblesse du recrutement de journalistes rodés aux nouvelles technologies et, pis, le départ de quelques-uns des meilleurs d’entre eux, désespérés de ne pouvoir se faire une place dans une hiérarchie toujours organisée selon les mérites du journalisme traditionnel. Les auteurs estiment que c’est à cause de cette atonie, illustrée par une sous-utilisation des réseaux sociaux ou des tags, que les excellentes informations de la rédaction peinent à se faire une place sur Internet. Cette lenteur et ces faiblesses techniques permettent à des sites concurrents, comme le Huffington Post, d’avoir plus de visiteurs sur des informations qu’ils ont pourtant reprises du New York Times.
Ces constats inquiétants mériteraient quelques nuances. Ainsi, même si l’audience de sites comme le Huffington Post croît plus vite que celle du Times, son chiffre d’affaires ne pèse encore que les trois quarts du chiffre d’affaires des seuls abonnements de celui-ci. Ils ne jouent pas encore dans la même division.
Le rapport aborde, avec un peu plus de pincettes, un autre aspect du «retard» diagnostiqué: l’absence quasi totale de relations entre l’éditorial et le commercial. Affaire délicate puisque la « religion » du Times a toujours été de maintenir une « muraille de Chine » entre la rédaction et les services commerciaux, en particulier la publicité. Le rapport suggère pourtant de valoriser le département « expérience client », on dirait le marketing, et de le faire coopérer vraiment avec la rédaction pour éviter, comme cela s’est produit, que le marketing ne soit pas prévenu de la mise en ligne d’importants dossiers.
Le spectre du native advertisement
Derrière ces analyses, on devine l’envie de donner plus de place au native advertisement, ces publicités qui se distinguent mal du rédactionnel et sont la nouvelle mode – le nouvel espoir? – des patrons de presse. C’est clairement un objectif pour le PDG, Mark Thomson, recruté à la BBC en 2012 et moins sensible à la « muraille de Chine » des journalistes américains. Il n’hésite pas à se mêler de la stratégie du journal, y compris d’un point de vue rédactionnel et il est à l’initiative de la plupart des nouveaux produits lancés par le journal. Il semble avoir l’appui d’Arthur Sulzberger avec qui il a signé, en mars dernier, un mémo pour le personnel soulignant la nécessité d’une plus grande proximité entre la rédaction et le business.
L’engouement des groupes de presse pour le native advertisement est peut-être une solution pour certains mais, plus qu’une nouvelle opportunité, il est d’abord le résultat d’un échec. En effet, pendant longtemps la presse a voulu croire que les annonceurs attachaient une importance stratégique à l’endroit, au « support », où ils faisaient paraître leurs publicités : un journal haut de gamme pour les produits à forte valeur ajoutée, une rubrique médicale pour les annonces santé, une revue de voyages pour le tourisme, etc. Malheureusement, avec la loi des algorithmes et la multiplication des sites, les annonceurs privilégient désormais le meilleur rapport qualité/prix et ignorent souvent où paraissent leurs publicités. Le native advertisement devient ainsi une tentative désespérée pour les récupérer au prix d’une perte de crédibilité du journalisme qui pourrait faire fuir les lecteurs. Ce pari faustien est risqué.
Avec la loi des algorithmes et la multiplication des sites, les annonceurs privilégient désormais le meilleur rapport qualité/prix.
Enfin, le rapport insiste sur l’urgence de recruter des journalistes formés aux nouvelles technologies et digital oriented, y compris, et peut-être surtout, au sommet de la hiérarchie. Le fait que le nouveau patron des rédactions, l’excellent Dean Baquet, n’avait pas de compte Twitter au moment de sa nomination, indique qu’il y a encore un bout de chemin à parcourir.
So what ?
Aucun journal généraliste n’aura autant essayé, innové ou même osé. Aucun journal n’a su conserver une telle influence dans les débats américains et parfois mondiaux. Ses prises de position pèsent encore d’un poids considérable. En témoigne l’impact de son éditorial en faveur de la dépénalisation de la marijuana. Et le succès de ses abonnements sur Internet prouve que beaucoup de gens accordent un véritable prix à ses informations.
Pour autant, rien n’est garanti. The New York Times est peut-être sur une bonne voie, mais il n’a toujours pas trouvé la formule magique, le modèle économique que cherchent tous les éditeurs de journaux. Personne ne peut jurer qu’il a assuré sa survie, même si on a du mal à envisager sa disparition. Le défi sera en effet de devenir de plus en plus numérique tout en gardant une présence sur le papier aussi longtemps que cela sera économiquement nécessaire. Car le passage au tout-numérique, proposé par certains, semble encore prématuré. Ryan Chittum le démontre en expliquant qu’en devenant tout-digital, le NYT passerait d’un bénéfice d’exploitation de 156 millions à une perte de 150 millions par an. Très vite, il faudrait songer à arrêter ou à vendre le journal. D’autres « experts » envisagent qu’il arrête de paraître en semaine pour ne conserver que la très rentable édition du dimanche. Ce n’est pour l’instant pas la solution choisie. Le temps des expérimentations, des opérations par essais et erreurs, n’est pas achevé.
Finalement, l’histoire se terminera peut-être comme l’annonçait Epic 2014, une vidéo, encore prophétique aujourd’hui, imaginée par deux étudiants de Stanford en 2006 : dans cette fiction qui flirte avec la réalité, The New York Times n’est plus publié qu’en ligne à l’exception d’une lettre confidentielle sur papier, pour des abonnés riches, curieux et probablement un peu âgés.