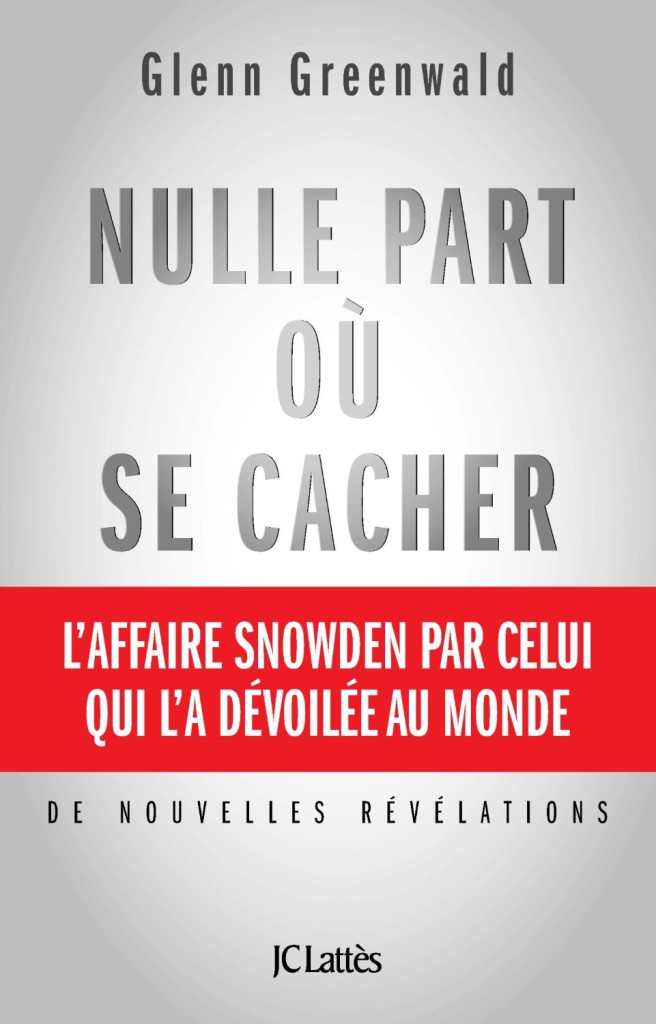L’attribution d’un visa constitue une décision administrative susceptible d’être contestée devant la juridiction administrative. C’est ce type de recours (en l’occurrence un recours d’urgence) qui a été effectué par une association catholique proche de l’extrême droite contre les visas attribués aux deux parties du film Nymphomaniac. La ministre avait attribué un visa assorti d’une restriction aux moins de 12 ans pour le premier opus et un visa assorti d’une restriction aux moins de 16 ans pour le second. Constatant dans les deux cas une erreur d’appréciation, le Tribunal administratif de Paris a suspendu les deux visas. Afin de ne pas contrarier l’exploitation du film, la ministre a immédiatement réagi et a attribué de nouveaux visas aux films en conformité avec les observations du juge : moins de 16 ans pour la première partie et moins de 18 ans pour la seconde.
La modification des visas de Nymphomaniac constitue-t-elle une « censure » ?
Une consultation des dictionnaires permet de constater que l’utilisation du terme « censure » n’est pas en l’espèce erronée(1). Pour autant, ce terme, lorsqu’on l’utilise au sujet d’une œuvre artistique, revêt une connotation négative particulière qui laisse à penser immédiatement qu’il est porté gravement atteinte à la liberté d’expression. L’utilisation de ce terme connoté semble complètement inadaptée à la situation de Nymphomaniac. Soyons clairs : le film n’a pas été coupé, modifié ou interdit sur le territoire français. En réalité, le juge a tout simplement décidé que certaines tranches d’âge ne pourront pas voir le film de Lars Von Trier en salles. Peut-on réellement dans ces conditions parler de censure et sérieusement comparer cet état de fait aux pratiques iraniennes ou chinoises en la matière ? Rappelons qu’en Iran et en Chine des cinéastes sont emprisonnés ou exilés pour avoir réalisé ce que le pouvoir politique ne veut pas voir. On est loin du simple objectif de protection de la jeunesse ici recherché. N’y a-t-il pas un peu d’excès à comparer l’élévation d’une restriction aux mineurs à ces situations ? En réalité, plus qu’une censure, la pratique du visa d’exploitation constitue une régulation de l’accès aux salles des mineurs comme on la trouve dans l’intégralité des pays démocratiques de la planète. La pratique française en la matière est une des plus souples que l’on puisse trouver. Les États-Unis ou le Royaume-Uni sont beaucoup plus stricts. La première partie du film Nymphomaniac est ainsi interdite aux moins de 16 ans en Allemagne et aux Pays-Bas. Le film est interdit aux moins de 18 ans dans la plupart des autres pays européens. Seule la Suède est plus souple avec une interdiction aux moins de 15 ans. Tous ces pays seraient-ils également d’affreux censeurs qui se fondent sur des éléments « archaïques » ? Pour finir, rappelons que la Cour européenne des droits de l’homme elle-même juge la pratique de ces restrictions parfaitement compatible avec la liberté d’expression (CEDH, 25 novembre 1996, Wingrove c. Royaume-Uni, Rec. 1996-V).
Pourquoi le juge devrait-il intervenir dans le domaine des visas d’exploitation ?
Permettre à la commission et au ministre de la Culture d’attribuer un visa sans contrôle du juge est la proposition la plus attentatoire aux libertés que l’on puisse proposer
On peut également noter que ce sont les mêmes qui aujourd’hui défendent la commission de classification qui la critiquaient hier lorsqu’une de ses décisions était jugée défavorable à l’un ou l’autre (v. par exemple le cas des film Martyr et Only god forgives). La commission de classification paraît donc intouchable mais seulement dans certains cas. En réalité, la logique affichée est toujours la même : si une décision juridictionnelle m’est défavorable, c’est que le juge est illégitime et que la décision est mauvaise…
Le juge n’est-il pas incompétent en matière artistique ?
Le juge est un spécialiste…du droit et c’est tout ce qu’on lui demande
Ainsi, la juridiction administrative serait exclusivement constituée de vieux schnocks complètement ignares quand on en vient à parler d’art… Inutile de s’attarder sur ces clichés caricaturaux. L’idée serait donc qu’un juge n’a pas à intervenir dans le domaine artistique faute d’être compétent. Avec ce type de raisonnement on se demande comment un juge peut intervenir sur des questions de bioéthique, de médecine, d’urbanisme ou dans toute autre matière s’il n’est pas démontré qu’il est un spécialiste. En réalité le juge est un spécialiste…du droit et c’est tout ce qu’on lui demande. En matière de visas d’exploitation, le juge applique les textes préalablement édictés par les chambres législatives et le pouvoir réglementaire. Le rôle d’un juge est d’appliquer le droit de façon neutre et dépassionnée. Le juge ne prend à aucun moment en compte les qualités artistiques du film, il se contente de déterminer s’il contient des images nuisibles pour la jeunesse. Les décisions rendues par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris sont tout à fait en phase avec la jurisprudence constante du Conseil d’État en matière de visa. Ces décisions ne sont pas particulièrement originales et ne changent rien à la jurisprudence. On peut même noter que le juge a été un peu plus souple qu’à son habitude sur la première partie de Nymphomaniac.
Les textes ne sont pas précis sur les justifications entrainant les restrictions d’âge. Seules les classifications X (tombée en désuétude au cinéma) et la classification moins de 18 ans sont un minimum détaillées par les textes qui ne disent par contre rien sur les différences entre une interdiction aux moins de 12 ans et de 16 ans. L’absence de précision permet aux juges d’être plus souples sur l’interprétation des textes. La jurisprudence établie par la juridiction administrative permet par contre d’avoir une grille de lecture assez précise sur les différentes restrictions. À la lecture de cette grille, la sous-classification de la première partie de Nymphomaniac apparaissait manifeste. Pour ce qui est de la seconde partie, quoique moins manifeste, la sous-classification apparaissait également logique quand on connait la jurisprudence en la matière. Nymphomaniac n’a pas subi un régime spécial mais le même régime que tous les autres films.
Est-il légitime qu’un juge fasse droit à une requête déposée par une association proche de l’extrême droite ?
Il est de la responsabilité d’un juge de rendre une solution de façon neutre et dépassionnée. Depuis quand, dans un État de droit, les juges rendent-ils des décisions au vu du pédigrée du demandeur ? Prendre en compte la personnalité des requérants pour rendre une décision de justice est inenvisageable. Il est beaucoup plus pertinent d’expliquer qu’il est étonnant que les recours visant les sous-classifications de films sortis au cinéma soient quasi-exclusivement effectués par une seule association en France. En d’autres termes, les classifications de films ne semblent pas intéresser ni déranger grand monde en France si ce n’est une ou deux associations. Les distributeurs effectuent parfois des recours pour contester la classification d’un de leurs films mais toujours pour demander aux juges une classification moins restrictive. Doit-on pour autant abandonner la classification des films ? Rien ne le justifie. La protection de la jeunesse reste un objectif louable et nécessaire auquel s’attachent plusieurs autorités publiques (ministre de la Culture, CSA) ou organismes privés (classification PEGI pour les jeux vidéo). Pour ce qui est de l’association Promouvoir, elle n’effectue qu’un à deux recours par an au maximum. La plupart du temps elle n’obtient pas gain de cause (le Tribunal administratif vient par exemple de rejetter ses requêtes concernant le visa d’exploitation de La vie d’Adèle). Lorsqu’il est fait droit à ses requêtes c’est uniquement parce que les juges estiment qu’il y a eu une erreur de classification.
Les décisions de suspendre les visas de Nymphomaniac sont-elles inadmissibles et injustifiées ?
Les décisions Nymphomaniac n’ont rien d’originalEn effet, jusqu’à présent, le Conseil d’État a toujours considéré qu’un film comportant une ou des scènes de sexe non simulées devait être interdit au minimum aux moins de 16 ans. Le contrôle de cet élément permet au ministre (et au juge) d’évaluer ce qui est porté à l’écran c’est-à-dire ce qui est visible pour les mineurs. Au vu de la teneur des images le ministre peut moduler sa décision de restriction sous contrôle du juge en cas de recours juridictionnel. Le visa doit donc correspondre à ce qui est vu à l’écran. Le visionnage de la première partie du film Nymphomaniac permet de comprendre qu’une restriction aux moins de 12 ans était incompatible avec le contenu du film. Soyons sérieux : est-ce si scandaleux et inadmissible de considérer qu’il est excessif pour un enfant de 12 ans de voir Nymphomaniac ? Le juge ne fait en la matière que reprendre l’état du droit positif. Si Nymphomaniac vol. 1 mérite une classification moins de 12 ans, quel film mérite alors une classification « moins de 16 ans » ou « moins de 18 ans » ?
Pour ce qui est de la seconde partie, les juges ont estimé que la classification « moins de 16 ans » était inadaptée et qu’une restriction « moins de 18 ans » était plus pertinente. Si l’erreur paraît pour cette seconde partie du film moins grossière que pour la première, la position du juge nous semble néanmoins tout à fait justifiée. La teneur de la seconde partie du film n’a rien à voir avec la première ce qui justifie le recours à une restriction à l’ensemble des mineurs. Comprenons bien qu’une interdiction aux moins de 18 ans n’a rien à voir avec une classification X. Cette dernière classification ne concerne que les films pornographiques. Si les deux types de films comportent des scènes de sexe non simulées, le film pornographique est un film à vertu masturbatoire. Cette distinction découle de l’interprétation classique du terme pornographique par le Conseil d’État.
Quelles sont les conséquences des décisions des juges ?
Les décisions rendues par le Tribunal administratif de Paris permettent la suspension des visas attribués aux deux parties du film. La suspension intervient en théorie jusqu’à ce que le juge statue sur l’affaire au fond. Les premières décisions sont des décisions rendues en urgence en raison d’un doute sérieux sur la légalité des visas. Les décisions au fond seront des décisions définitives (sauf appel et cassation) rendues sans urgence de façon plus détaillée. Les visas étant suspendus, les deux parties de Nymphomaniac ne pouvaient plus être exploitées en salles. Cela explique que la ministre ait réagi rapidement en attribuant deux nouveaux visas conformes aux indications du Tribunal administratif de Paris. Si la ministre ne l’avait pas fait, les deux films de Lars Van Trier n’auraient plus pu être exploités en salles.
Si la ministre n'avait pas agi rapidement, les deux films de Lars Van Trier n’auraient plus pu être exploités en sallesL’exploitation en salles n’a donc été perturbée qu’en ce qu’elle n’a empêché un certain nombre de mineurs de voir le film pendant les dernières semaines d’exploitation en salles (les décisions du juge ont été rendues alors que le film était déjà exploité depuis plusieurs semaines). Les effets sur la diffusion télévisuelle du film sont également assez limités. La première partie du film, qui passe d’un visa moins de 12 ans à un visa moins de 16 ans, ne pourra être diffusée qu’après 22h30 sur les chaînes traditionnelles (hors chaînes cinéma et Canal+). Une interdiction aux moins de 12 ans lui imposait déjà d’être diffusée après 22h. Pour la deuxième partie, la restriction aux moins de 18 ans empêche une diffusion du film sur les chaînes traditionnelles. En effet, le CSA interdit aux chaînes de télévision de passer des films interdits aux moins de 18 ans. Les seules chaînes habilitées à passer ce type de films sont Canal+, Ciné+Frisson et OCS. De façon critiquable, la télévision ne peut pas distinguer parmi les interdictions aux moins de 18 ans comme cela se pratique au cinéma avec la restriction moins de 18 ans et la classification X. Que le film soit interdit aux moins de 18 ans en salles ou reçoive un visa X, il sera de toute façon insusceptible d’être diffusé sur les chaînes traditionnelles. Les chaînes doivent reprendre les visas attribués au cinéma pour classifier les films et doivent même sur-classifier le film si la diffusion à la télévision le justifie. Il fait peu de doute que les deux parties de Nymphomaniac auraient été de toute façon sur-classifiées à « moins de 18 ans » par les chaînes lors de leur diffusion quand bien même leurs visas n’auraient pas été modifiés. On peut tout de même affirmer que les nouveaux visas du film le pénalisent financièrement dans la mesure où la diffusion à la télévision sera particulièrement limitée et donc peu rétributrice pour les producteurs. Gageons que ces derniers avaient vraisemblablement pris en compte le fait que la diffusion télévisée de ce film serait, au vu du sujet et de son traitement, très limitée.
Références
--
Crédit photo : Christian Geisnaes (visuel presse)
À lire également
JO de Paris : les sportifs se préparent à la déferlante médiatique
Pour répondre aux 26 000 journalistes accrédités aux Jeux olympiques, du 26 juillet au 11 août 2024, les athlètes français travaillent de différentes façons. Spontanés ou réservés, ils espèrent en tirer le meilleur et éviter le bad buzz.