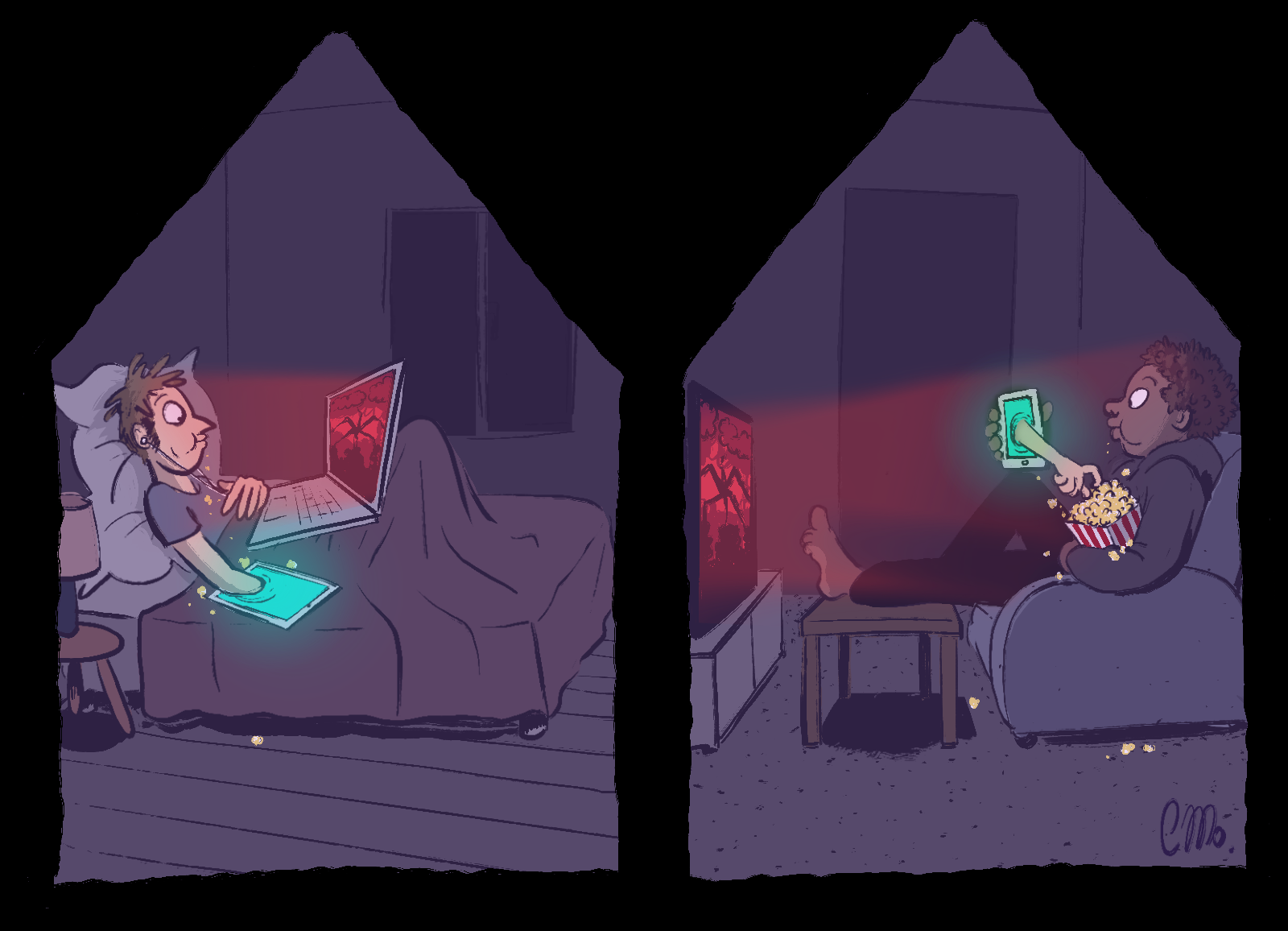Ancien chef du bureau des correspondants de France 2 à Jérusalem, Charles Enderlin a publié De notre correspondant à Jérusalem. Le journalisme comme identité (Seuil, 2021). L'entretien qu'il avait accordé à La Revue des médias à l'occasion de la parution de son livre revient aujourd'hui dans l'actualité, après l'attaque surprise du Hamas en Israël et le début d'une nouvelle guerre.
Le 15 mai 2021, l’armée israélienne a bombardé l’immeuble abritant les locaux d’Al Jazeera et Associated Press (AP). Plusieurs bureaux de médias locaux ou internationaux avaient aussi été détruits au cours des jours précédents. Comment peut-on expliquer que des médias soient visés en particulier ?
Charles Enderlin : Selon l’armée, le Hamas avait des installations dans ces locaux. Est-ce que cela justifiait la destruction totale de l'immeuble, alors que l'on sait que les techniques militaires permettent de détruire un seul appartement ou quelques pièces grâce à des missiles guidés ? Je ne sais pas, mais cela montre un manque d'intérêt pour la presse internationale de la part d'Israël.
Il faut relier cela à la déclaration d'un porte-parole militaire israélien qui avait annoncé une incursion terrestre le 14 mai à Gaza. C'était faux, et la presse israélienne a révélé par la suite qu’il s'agissait d'une opération d'intox [ce que l’armée israélienne dément, NDLR] destinée à pousser les combattants du Hamas vers des tunnels qui seraient ensuite bombardés. Le New York Times en avait fait son titre principal, et a protesté ensuite contre une utilisation de la communication israélienne à des fins militaires auprès des grands médias internationaux.
Ceci dit, AP et Al-Jazeera ont continué à couvrir le terrain. Les autres médias palestiniens, qui étaient dans les immeubles détruits, ont poursuivi leur travail envers et contre tout, tout en montrant l'absence de considération de la part de l'armée israélienne pour leurs lieux de travail.
Au sujet de « l’intox » militaire, comment analyser ce type de communication de l'armée et son impact sur le traitement médiatique du conflit ?
Aujourd’hui, on ne peut pas accorder une crédibilité absolue à cette communication. Il faut vérifier et avoir une autre source pour tout communiqué officiel israélien, en particulier militaire. Il y a un département au ministère des Affaires étrangères, et un ministère des Affaires stratégiques et de l’information, qui influent notamment sur les réseaux sociaux. Des départements qui font de la « public diplomacy », de la diplomatie publique, pour défendre l'image du pays. Des bots existent, qui envoient automatiquement des éléments de langage officiels. La bataille pour l'image des uns et des autres se fait sur les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle il faut regarder cela avec la plus grande prudence.
« Le journalisme, c'est donner des explications, montrer la réalité »
Les publics, notamment les communautés musulmanes et juives dans les pays occidentaux, ont le droit d’avoir accès à une information professionnelle, équilibrée, allant au-delà de ce que les réseaux sociaux, les chaînes et certains médias partisans envoient.
Jusqu’à la reprise du conflit en mai, on n’entendait plus tellement parler du conflit israélo-palestinien dans les médias, notamment en France. Vous écrivez dans votre livre qu’il « n’intéressait plus personne ». Pourquoi ?
D'abord, ce sont des décisions des directeurs de rédactions, qui reposent sur l'impression que le conflit israélo-palestinien a perdu de son importance. Ce qui les intéresse en Israël, c'est l'aspect haute technologie. On a eu au début de l'année une véritable fête médiatique autour de la vaccination de masse, Israël étant présenté comme l'un des rares États ayant réussi à se débarrasser du virus.
Le reste n'est plus important et la preuve en a été les accords de normalisation conclus avec deux États du golfe Persique, le Maroc et le Soudan. Si les États arabes peuvent conclure ces accords, eh bien, il n'y a aucune raison pour que l'on parle d’un conflit dont tout le monde se moque. C'est à mon avis un des grands succès de la politique de Benjamin Netanyahou : faire oublier qu'il y a toujours un problème avec les Palestiniens, que 60 % de la Cisjordanie est totalement sous contrôle israélien, où se poursuit la colonisation depuis des décennies. Très peu de médias français, américains ou allemands ont fait des reportages sur ces développements au cours des dernières années.
D'autres facteurs ont-ils pu jouer ?
Oui, il y a aussi les pressions sur les rédactions. Dès qu'un reportage ou la couverture d'un événement risque de porter atteinte à l'image d'Israël auprès du public français, des organisations pro-israéliennes et de grandes institutions juives françaises interviennent auprès des rédactions pour que ce ne soit pas le cas. Par exemple, avant même la diffusion d’un reportage d'Envoyé spécial sur France 2 en 2018, sur les « estropiés de Gaza », l'ambassade d'Israël est intervenue auprès de la présidence de France Télévisions pour que ce ne soit pas retransmis. L’ambassade, le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) ou le Consistoire central israélite argumentaient que cela produirait de l'antisémitisme, alors que personne n'avait encore vu le reportage.
Finalement, il a été diffusé. C'était à propos de jeunes Palestiniens qui avaient perdu une jambe ou un bras après des tirs de snipers israéliens lors de la « Marche du retour » à Gaza. Il y avait des images effectivement très fortes, mais c'était tout à fait équilibré, avec les réactions du porte-parole de l'armée israélienne.
Vu le scandale et les pressions qui ont eu lieu, je vous garantis que pendant les années suivantes, tout le monde hésitait dans les rédactions à faire un nouveau reportage de ce genre à Gaza. Sans compter les milliers d’e-mails, de critiques, d’insultes ou de menaces pour les journalistes. Il existe une crainte de se retrouver face à des réactions extrêmes, de la part des deux camps. Pourquoi se casser la tête, si ce n'est pas indispensable ? Autant ne pas faire des sujets qui vous attirent des problèmes.
Est-ce pour ces raisons-là que plusieurs grands médias occidentaux ont fermé leurs bureaux de correspondants sur place ?
ABC News, CBS, NBC les ont fermés depuis longtemps. Perte d'intérêt, pressions… TF1 a fermé en 2019 à Jérusalem, mais déjà depuis des années, la chaîne ne couvrait plus le conflit. De même pour le bureau de France 2 : depuis mon départ en 2015, c’est essentiellement des sujets sur le tourisme dans la région, de la mer Morte aux grands hôtels du golfe Persique.
Quand il y avait une nécessité absolue de parler de l'actualité brûlante, le correspondant le faisait mais ensuite revenait à l'autre activité du bureau.
Le manque de budget peut-il aussi expliquer ce désinvestissement médiatique ?
Quand les chaînes veulent dépenser pour couvrir quelque chose, elles mettent le budget. Maintenant que nous avons un grand retour du conflit israélo-palestinien dans l'actualité, les budgets sont là, les équipes tournent, les médias envoient des renforts. On dépense quand ça intéresse. Je trouve que les grands médias français, quand ils en parlent, sont très professionnels dans leur couverture du conflit.
Vous avez exercé de 1981 à 2015 comme correspondant de France 2. Dans votre livre, vous racontez que, dans les années 2010, la chaîne a commencé à refuser régulièrement vos reportages. Pourquoi, selon vous ?
La volonté de changement : on voulait avoir des gens plus jeunes. Le style aussi ne plaît plus, ne correspond plus à ce que veulent les journaux. D'ailleurs, ils ont bien changé aujourd'hui. À 13 heures sur France 2, il n'y a quasiment plus de politique étrangère. Dans les 20 heures, c'est uniquement lorsque c'est absolument indispensable et qu’un événement ou un conflit se retrouve en une dans l'ensemble des médias, sinon, on passe à autre chose.
Vous n'aurez pas dans le journal télévisé du soir une explication complète sur ce qui se passe autour de tel ou tel évènement. Durant les dix dernières années, sur le conflit israélo-palestinien par exemple, il n'y a eu que quelques très rares reportages sur la colonisation à Jérusalem-Est, en Cisjordanie.
Selon les descriptions que vous rapportez, votre rédaction ne s’intéresse pas toujours aux événements que vous souhaitez couvrir, prétextant parfois que « ça commence à faire feuilleton ». De quelles manières peut-on couvrir un conflit qui a l’air insoluble, en évitant la lassitude des téléspectateurs et des rédactions ?
Cela dépend entièrement de la direction du média et de la rédaction en chef, qui seuls décident de commander tel ou tel sujet. Bien sûr, on peut argumenter mais, en fin de compte la décision est prise par ceux qui décident où et comment est dépensé le budget. Tout n'est pas insoluble. Il y a un moment où quelque chose arrive et, au Proche-Orient, les choses sont souvent surprenantes. Il faut travailler, il faut pousser, continuer à couvrir.
En tout cas, je n'ai jamais aimé quand on m'appelait en me disant « Donne-nous de l'émotion ». Le journalisme, c'est donner des explications, montrer la réalité et non pas jouer sur l'émotion du téléspectateur.
Concrètement, comment s’organisait votre travail avec les fixeurs, les cameramen, etc. ? Comment ce réseau s’est-il construit ?
Étant chef de bureau, avec des événements qui se déroulaient dans des endroits éloignés, il me fallait des images différentes de celles filmées par les agences. Que ce soit à Gaza, à Bethléem, ou à Hébron, j’ai fait appel à des cameramen palestiniens reconnus pour leur professionnalisme et surtout avec la certitude qu’ils n’appartenaient pas à une organisation politique quelconque. Je n’avais pas de fixeur, mais, au bureau, un assistant palestinien de Jérusalem-Est. Talal Abou Rahmeh, employé par France 2, suivait l’actualité en Cisjordanie et à Gaza. Les autres cameramen avaient des cartes de presse du bureau de presse gouvernemental israélien. Parlant l’hébreu, je n’avais pas besoin de fixeur ou de traducteur pour couvrir l’actualité israélienne.
Comment faire, quand on travaille sur un conflit comme celui-là, pour parler à toutes les parties, pour entretenir ses sources des deux côtés, y compris dans les extrêmes ?
Étant juif, israélien et français, il a fallu que je me mette dans une position où mes interlocuteurs ne me considéraient non pas à travers une identité nationale ou religieuse, mais tout simplement comme un journaliste professionnel.
C’est pour ça que le sous-titre de mon livre, c'est « Le journalisme comme identité ». Et là, ce n'est pas un succès personnel, je dois surtout saluer les gens qui, en face de moi, ont considéré qu'ils pouvaient parler à un journaliste en mettant de côté l'identité juive, israélienne ou française. Tout en sachant parfaitement quelles étaient mes positions personnelles, notamment contre la violence.
Vous pensez à une interview en particulier ?
Je me suis retrouvé face à un imam du Djihad islamique en 1995, qui venait d'envoyer deux jeunes Gazaouis avec des ceintures d'explosifs se faire sauter dans une cafétéria de soldats israéliens au nord de Tel-Aviv. Je lui ai fait comprendre que pour moi, c'était condamnable. Mais je ne pouvais pas le lui dire en face, donc j'ai trouvé une autre formule. Je lui ai demandé s'il mettait du sang juif dans son thé, il m'a regardé et il m'a dit « Finalement, vous êtes un drôle de Juif, vous. » Et j'ai gardé contact avec cet imam. Il savait quelle était ma position, mais j'ai relayé ses paroles. Je pense qu'il fallait montrer aux téléspectateurs français le danger de l'islam djihadiste. Ça n'a pas toujours été facile, les rédactions ne l'ont pas toujours compris.
Reportage de Charles Enderlin au lendemain de l'attentat suicide intervenu au nord de Tel-Aviv. Extrait du journal de 20h de France 2, le 23 janvier 1995.
Posez-vous une limite quelque part ? Y a t’il des gens que vous refusez d'interviewer ?
Je refuse s'il s'agit de quelqu'un qui vous propose de commettre un crime devant vous. À Naplouse par exemple, on m’a proposé de montrer des exécutions de « collaborateurs » devant la caméra. J’ai refusé de diffuser des appels à la violence ou au meurtre. J'interviewe les extrêmes des deux camps, pour qu'ils m'expliquent leur pensée, leurs idéologies, leurs actes. Mais justifier ces actes de violence, non.
Les militants palestiniens interrogés par Charles Enderlin et son équipe évoquent leur rôle dans les exécutions de « collaborateurs ». Extrait d'Envoyé Spécial sur Antenne 2, le 1 mars 1990.
Pourquoi est-ce important d’interviewer directement ces personnes, y compris celles qui commanditent un attentat ?
J’ai couvert la plupart des attentats, ou des opérations militaires israéliennes qui produisent des « dégâts collatéraux » de nombreux civils. Et là, on a souvent des images terribles. Il faut montrer l'ambiance, ce qu’il se passe. Mais la meilleure explication, c’est d’avoir la personne devant vous qui fait part de sa vision du monde, son idéologie…
Par exemple, lorsque des responsables du Hamas ou du Djihad islamique palestinien expliquent qu'il n'y a pas de place pour un État d'Israël en terre d'islam. Je veux montrer qu'il ne s'agit pas simplement d'un mouvement de résistance, que c’est un mouvement théologique, religieux qui a un but précis. De même, côté israélien, lorsqu'on interviewe un responsable du mouvement messianique religieux, qui pense que les Arabes n'ont aucun droit de rester en terre d’Israël. Il s'agit d’exposer aussi ce niveau-là du conflit.
Est-ce qu’il y a des sujets que vous avez choisi de ne pas traiter pour ne pas vous mettre à dos des sources, ou des gens avec qui vous travailliez ?
Je n’ai pas été à l’enterrement de Hafaaz Al-Assad en 2000. On m’avait proposé de venir, avec mon passeport français. J’ai décliné car en tant qu’Israélien, journaliste accrédité en Israël, débarquant sans autorisation à Damas, j’imagine que cela m’aurait valu des explications avec les autorités israéliennes.
« Il y a une perte de liberté éditoriale certaine dans le travail des journalistes sur le terrain »
Par ailleurs, il faut toujours se demander si on risque de mettre en danger la personne qu’on interviewe. J’ai filmé pendant la première intifada le chef du comité populaire d’un village palestinien. Un jeune homme brillant, qui nous lance : « Vous pouvez dire à l'armée que s'ils viennent ici pour m'arrêter, je ne serai pas armé et je ne résisterai pas. » Je lui demande s’il est sûr de vouloir montrer son visage. Quelques jours plus tard, il a été tué dans une opération militaire. Les Palestiniens m'ont d'ailleurs accusé à ce moment-là d'être responsable de sa mort. Depuis, même avec son accord, je n'ai plus jamais montré le visage d'un responsable d'un mouvement palestinien clandestin, qu'il soit militaire ou politique.
Au début de la seconde intifada en 2000, un de vos cameraman filme la mort de Mohammed al-Durah, un enfant palestinien, dans les bras de son père, images que vous commentez ensuite sur France 2. Pendant des années, certains ont argué que les soldats israéliens n’étaient pas responsables de cette mort, voire qu’il s’agissait d’une mise en scène, jusqu’à vous mener en Cour de cassation pour diffamation. Pourquoi ce reportage a pris une telle ampleur ?
À mon avis, cela a pris de l’ampleur car un certain de nombre de personnes, d’organisations pro-israéliennes voulaient porter atteinte à la crédibilité de mon travail. L’essentiel de ces attaques est arrivé au moment où j’avais publié mon livre Le Rêve brisé en 2002, où je démontais la version israélienne de l’échec du sommet de Camp David en juillet 2000, qui l’attribuait entièrement à Yasser Arafat, également accusé d’avoir déclenché la seconde intifada.
Les images de la mort de Mohammed al-Durah. Extrait du journal de 20h de France 2, le 30 septembre 2000.
Est-ce que les retombées de cette affaire ont eu une influence sur votre travail, ou sur celui d’autres journalistes ?
Cette affaire ne m’a jamais gêné dans mon travail. Je n’ai perdu aucune source, des personnes qui m’avaient attaqué ont accepté de m’accorder de longues interviews pour mon livre et mon film Au Nom du Temple. On oublie ce genre d’accusations. La seule manière d’y faire face, c’est de les ignorer et de rester le plus professionnel possible.
Cela dit, les attaques contre le travail des envoyés spéciaux et des correspondants ont certainement, à certains stades, pu avoir un effet dissuasif sur des rédactions.
Vous évoquez dans votre livre une perte d’autonomie des journalistes depuis quelques années. Comment expliquer ce phénomène ?
C’’est le problème du nouveau journalisme, avec les smartphones, Internet partout, etc. Je voyais des journalistes arriver pendant les tournages ou les interviews, en liaison complète avec leur rédaction à Paris. La rédaction leur dit quelles questions poser, veut vérifier l'image par leur smartphone... Ensuite, au montage, ils reçoivent des instructions. Je crois qu'il y a une perte de liberté éditoriale certaine dans le travail des journalistes sur le terrain. Ça dépend des rédactions, mais dans l'ensemble, c’est un véritable problème.
Il y a eu quelques périodes bénies : avant l'arrivée d'Internet, pour avoir une liaison avec Paris, il fallait s'arrêter sur la route, trouver une cabine téléphonique, et puis demander un appel en frais virés. C’était aussi le cas pendant la révolution contre Moubarak. Les autorités avaient bloqué Internet et le réseau mobile en Égypte. Pendant quelques jours, les envoyés spéciaux partaient le matin, appelaient sur une ligne fixe au retour, en disant simplement « voilà ce qui a été tourné ».
Comment choisissez-vous les mots que vous employez en tant que journaliste, quand ils sont aussi sensibles, qu’ils peuvent signifier prendre parti pour un côté ou l'autre ?
Pour moi, par exemple, les territoires palestiniens étaient occupés. C'est le langage de la communauté internationale, utilisé par le Conseil de sécurité de l’ONU dans ses résolutions. Effectivement, ça ne plaisait pas à la droite et à l'extrême droite israélienne qui voulaient que j'utilise autre chose.
À propos de l’esplanade des mosquées sur le mont du Temple, dans chaque sujet, je rappelais qu'il s'agit du troisième lieu saint de l'islam, mais aussi du mont du Temple pour le judaïsme. Systématiquement.
Et comment aborder des sujets complexes dans un journal télévisé, où les formats sont courts, sans abandonner les explications de contexte ?
Être journaliste ou rédacteur en chef professionnel, cela veut dire savoir donner à l’avance des éléments de compréhension de conflits qui risquent à tout moment d'éclater. Au contraire, je reçois des appels ces dernierès semaines, depuis le début de la crise à Gaza, pour me dire : « Qu'est ce qui vient d'arriver ? Tout allait si bien, Israël avait réussi la vaccination, et faisait même la paix avec le monde arabe. » Je rappelle qu’il y avait toujours le problème palestinien. « Ah bon ? Ce n’était pas réglé, ça ? » Les gens qui ne font pas l'effort de se brancher sur RFI, France 24 ou d’aller lire un peu la presse israélienne ou la presse arabe ne savent pas pourquoi, tout à coup, tout a explosé à nouveau.
De notre correspondant à Jérusalem. Le journalisme comme identité, Charles Enderlin, Seuil, 2021, 352 pages, 20 euros