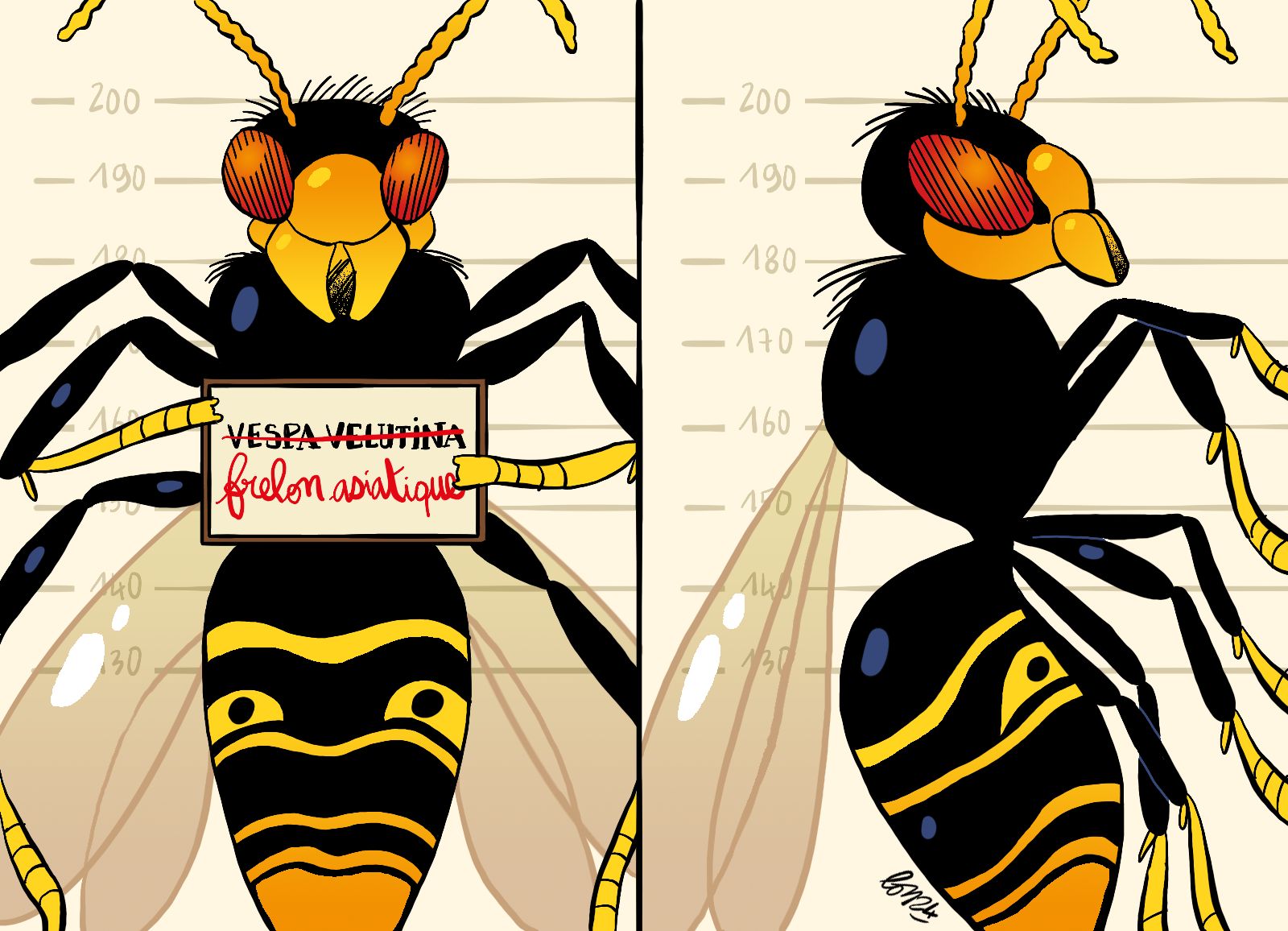Dans un village près de Montpellier, Mathilde invite Sarah chez elle pour déjeuner en famille. Inspirées par les histoires d’horreur créées sur internet [les creepy pasta, NDLR], les deux collégiennes de 13 ans tuent le père de Mathilde à coups d’armes blanches en plein thorax.
Tout est vrai dans cette affaire, publiée par Midi Libre et reprise par BFMTV. Tout, à l’exception de leurs identités, comme l’indique la mention « les prénoms ont été modifiés ». Lorsqu’il s’agit d’évoquer des faits graves susceptibles de conduire les protagonistes devant les tribunaux, des faits litigieux, ou même chaque fois que des journalistes souhaitent protéger des sources, ils cherchent une façon de nommer les personnes sans nécessairement révéler leur identité.
La loi impose d’anonymiser les mineurs, et toute victime d’infractions sexuelles quel que soit son âge. Mais si le nom des enfants est réellement protégé, pourquoi connaissons-nous celui de Maëlys de Araujo, 8 ans, tuée par Nordahl Lelandais en 2017 ? Ou de Lola Daviet, dont le corps a été retrouvé dans une malle en octobre dernier ? L’identité du « petit Grégory » Villemin n’a pas plus été préservée. Une interdiction pénale sanctionne pourtant la révélation du nom des mineurs. Mais les nommer permet aux journalistes de capter l’attention des lecteurs, et d'identifier une histoire. Un paradoxe relevé par Guillaume Sauvage, avocat spécialiste du droit de la presse : « Certains faits divers connaissent un tel retentissement national qu’il semblerait que les digues cèdent, avec une diffusion généralisée du nom ». Cette diffusion est sanctionnable jusqu’à 15 000 euros d’amende (art. 39bis, loi 1881). Même lorsque les victimes sont décédées. Et quand un média diffuse une alerte enlèvement — avec photo, nom et prénom — puis que l’enfant est retrouvé, il a l’obligation de retirer ces informations et de flouter son visage.
Dans les cas d’inceste qui impliquent une personnalité, il est d’usage de porter son nom à la connaissance du public. Et d’anonymiser le nom de famille d’un accusé ordinaire lorsqu’il a un lien de parenté avec une victime.
Le poids de la notoriété
D’une manière générale, l’identité de la personne mise en cause peut être exposée par la fonction qu’il exerce. Des innocents peuvent se retrouver pris dans ce piège, comme l’ex-maire de Vence Christian Iacono, qui a passé seize ans derrière les barreaux et subi vingt ans de procédure avant d’être acquitté du viol de son petit-fils, qui s’est retracté. « Il n’y a eu aucune présomption d’innocence, livre-t-il dans une interview au site Enquêtes de vérité. Et quand vous êtes maire d’une ville, les nouvelles vont très vite. Le lendemain de mon arrestation, l’affaire faisait la une de Nice matin, les gens commençaient déjà à dire « il n’y a pas de fumée sans feu… C’était très difficile. »
L’anonymisation suscite, dans une partie du public, une irrépressible envie de connaître l’identité réelle des suspects. On interpelle les journalistes sur les réseaux sociaux, qui se retrouvent ainsi sous pression. En cherchant simplement le nom de Lola sur Facebook, l’algorithme facilite l’identification de ses parents en suggérant leurs profils. Idem pour « Lucas L. », dont l’espace des commentaires sous ses photos Facebook et Instagram a été inondé d’insultes en réaction au meurtre d’une jeune mère de famille, Justine Vayrac, qui n’est jamais rentrée de sa nuit en discothèque en octobre 2022.
Chartes
Pour aiguiller les faits-diversiers et leur permettre de trancher la question épineuse de l’anonymat, certains médias, souvent ceux de la presse quotidienne régionale, se fixent une ligne de conduite dans le cadre de leur charte déontologique. Ouest-France est en train d’actualiser la sienne, qui date de 1990 et s’applique à ses 63 rédactions et à ses quelque 2 700 correspondants locaux bien implantés. Être aussi nombreux les place dans l’obligation de se coordonner. Une quinzaine de journalistes spécialisés planchent sur la révision de cette charte, dont des secrétaires de rédaction — « notre dernier garde-fou », précise Philippe Boissonnat, rédacteur en chef du titre. L’une des propositions en cours d’examen consiste à en finir avec « la facilité du pseudonyme » pour le réserver aux témoignages sensibles, allant des victimes de délits (cambriolages, agression…) à des récits de choix de vie (comme celui du recours à l’euthanasie). Dans les comptes-rendus d’audience, les noms d'emprunt et les prénoms avec initiale du nom, c'est-à-dire l’usage standard, devraient être remplacés par « le justiciable » ou « le prévenu »... « Il est préférable de se donner cette complication pour éviter des confusions et apporter du respect à une personne mise en cause, en ne la diminuant pas par un prénom quand on écrit un “président” pour celui qui la juge ».
Un autre paramètre compte dans la révélation ou non d’une identité : la gravité des faits, jugée à l’aune de la durée de la condamnation. Pour Ouest-France, le curseur est placé à douze mois ferme et placement en détention « pour éviter d’infliger une peine supplémentaire à l’image sociale » d’un condamné. En revanche, l’anonymisation est requise pour un bracelet électronique ou un feu rouge grillé : « ce n’est pas à nous d’en rajouter », affirme Philippe Boissonnat.
À La Voix du Nord, on ne dévoile l’identité qu’à partir d’une condamnation de deux ans. Sauf pour certaines professions (médecin, boulanger...) en milieu rural, pour lesquelles le journal estime que l’anonymisation d’une mise en examen peut « jeter l'opprobre » sur des confrères ou consœurs alentours.
Hors presse de proximité, à Paris, l’Association de la Presse Judiciaire (APJ, créée en 1887), qui regroupe environ 200 journalistes spécialistes de la justice, se propose de coordonner les pratiques et de jouer un rôle d’aiguillon. La « presse ju », comme la profession l’appelle, a appris des couacs du passé. Le chroniqueur judiciaire du Figaro, Stéphane Durand-Souffland, qui en a été le président, voit dans le procès public du « réseau pédocriminel » d’Outreau en 2004 « un révélateur des failles des médias ». À l'époque, nous précise-t-il, les journalistes avaient donné les vrais prénoms des enfants.
Concertation
Et comment s’y prend-on pour en donner d’autres ? L’actuel président de l’APJ et chef du service police-justice de France Inter, Jean-Philippe Deniau, fait partie des journalistes qui se sont concertés avec la cour d’appel lors du procès dit du “réseau pédophile d’Angers”, un an après Outreau, pour, cette fois, protéger l’identité des mineurs. « Nous avons donné pour pseudonymes aux enfants le nom du saint correspondant au jour de leur naissance », explique-t-il. Une harmonisation entre journalistes qui rend l’actualité plus lisible. Et tout récemment, pour l’affaire Yanis (un enfant de deux ans victime de sévices infligés par un couple auquel il avait été confié) dont le procès se tient jusqu’au 24 janvier 2023 à la cour d’assises de Douai, c’est la cour qui a recommandé aux journalistes, à l’occasion de leur demande d'accréditation, une liste de noms aux sonorités proches de celles d’origine. Et libre à eux de s’en servir, raconte Jean-Philippe Deniau.
En se concertant sur le choix des pseudonymes, les journalistes de l’APJ cherchent à limiter les erreurs d’appréciation. Mais rien ne contraint ses membres à s’aligner. Dominique Simonnot, ancienne journaliste de Libération et du Canard Enchaîné, devenue contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, raconte les échanges que des membres de l’APJ ont eu sur leur « chat » pour finalement renoncer à citer le nom de témoins dans une affaire. Ceux-ci « étaient sortis de prison après avoir été condamnés pour un braquage, vingt ans auparavant. Ils avaient changé de vie. On trouvait ça salaud de donner leurs noms. Un seul journal y avait dérogé, en indiquant le prénom, l'initiale du nom et même le métier ». Au bout de dix ans pourtant, le droit oubli s’impose : ils ne devaient plus être associés à ces faits. « L’horreur, c’est qu’avec internet, le droit à l’oubli n’existe plus », assène l’ancienne journaliste.
« On évoquait un attentat turc et le fait que le tueur se nommerait Mehmet. Donc nous avons décidé de révéler son nom : Malet »
Mais il existe des situations inverses, où les journalistes décident de révéler une identité pour mettre un terme à des spéculations sur les réseaux sociaux. Le meurtre de trois Kurdes à Paris en décembre 2022, par un certain William M., avait suscité l’indignation au sein de cette communauté. « On évoquait un attentat turc et le fait que le tueur se nommerait Mehmet, raconte Jean-Philippe Deniau. Donc nous avons décidé de révéler son nom : Malet ».
Contexte
Parfois aussi, face à la tentative de récupération raciste, la tentation peut exister de brouiller l’origine des mis en cause. « Pour des prénoms musulmans, je prends des pseudos qui peuvent à la fois être portés par des croyants et des personnes sans lien avec ce milieu culturel, comme “Nadia” ou “Myriam” », indique Nicolas Goinard, du Parisien. « Il serait ridicule d’appeler un Mohammed, Marc », soutient Dominique Simonnot. Cette modification gommerait la compréhension du contexte dans une affaire. « Je n’ai pas voulu être suspectée de lisser les choses, donc je gardais toujours un pseudo de la même origine que le prénom, celui qui m’inspirait le plus », poursuit-elle. Même analyse pour Antoine Blanchet, qui travaille pour le site actu.fr et anonymise toujours ses récits, quel que soit le contexte. « Quand les gens viennent d’un milieu culturel spécifique, je tiens à garder cet aspect dans le choix du pseudonyme, dit-il. Faire autrement me dérangerait ». Par le passé, il s’en tenait au vrai prénom suivi de l’initiale du nom. Mais il lui est arrivé qu’une personne citée dans une audience (ce qui rend mécaniquement les identités publiques) soit identifiée par ses lecteurs car elle portait un prénom très peu courant. Depuis, par précaution, il préfère toujours modifier les noms.
Nicolas Goinard, au Parisien, préfère demander aux victimes de choisir elles-mêmes leurs pseudos, tout en veillant à ce qu’il ne corresponde pas au nom d'une autre personne dans la même affaire. Pour les infractions sexuelles ou les victimes mineures, il s’est fixé pour règle de chercher un pseudonyme qui garde la première lettre du prénom d’origine.
Chacun a donc sa façon de faire. Et quand ce n’est pas le journaliste qui renomme, c’est parfois l’avocat ou ses clients qui décident du prénom d’emprunt, comme le raconte maître Guillaume Sauvage : « Je laisse le choix du pseudonyme à mes clients en m’assurant qu’il n’est pas transparent ».
Témoignages
Parfois, ce sont les victimes qui exigent l’anonymat. Le cas s’est posé récemment à Nicolas Azam, Anthony Derestiat et Maxime Dubernet de Boscq. Ces trois jeunes journalistes, tout juste sortis d’école (IJBA), ont révélé la garde à vue de Norman Thavaud début décembre 2022 à la suite des accusations de corruption de mineurs et de viols qui visent le troisième youtubeur français. « Des jeunes journalistes comme nous n’étaient pas censés tomber aussi vite sur une telle affaire », s’étonne encore Maxime Dubernet de Boscq. Leur longue enquête a été publiée par Libération trois jours plus tard, fruit d’une année de travail à trois. Leur responsabilité : anonymiser trois témoignages de femmes, sur huit. « L’une d’entre elles était si apeurée que le pseudonyme était sa condition pour qu’elle apparaisse dans l'article », poursuit Maxime Dubernet de Boscq. Une autre, dont le métier l’expose sur le web, ne voulait pas être associée à l’article. La dernière craignait le jugement familial. Entre changer les prénoms ou couper un contexte trop précis, qui pourrait rendre identifiables leurs interlocutrices, les trois journalistes ont dû trancher. « Notre méthode est assez triviale : dans la liste des prénoms les plus donnés en 2021, nous avons exclu ceux qui font âgé et ceux de connaissances que nous avions en commun ». Pour lui, avoir publié des témoignages à visage découvert a donné du poids à ceux sous pseudonymes.
Malgré les cas de conscience, les casse-têtes, les efforts de concertation, les désaccords, le choix du bon pseudonyme suffit-il à préserver une identité ? C’est tout un ensemble assure Nicolas Goinard. « Il faut veiller à ne pas laisser un faisceau d’indices qui révélera l’identité des gens à l’insu du journaliste ».